« Vices de forme ».
Traductions (extraits) : Marc Ulrich.
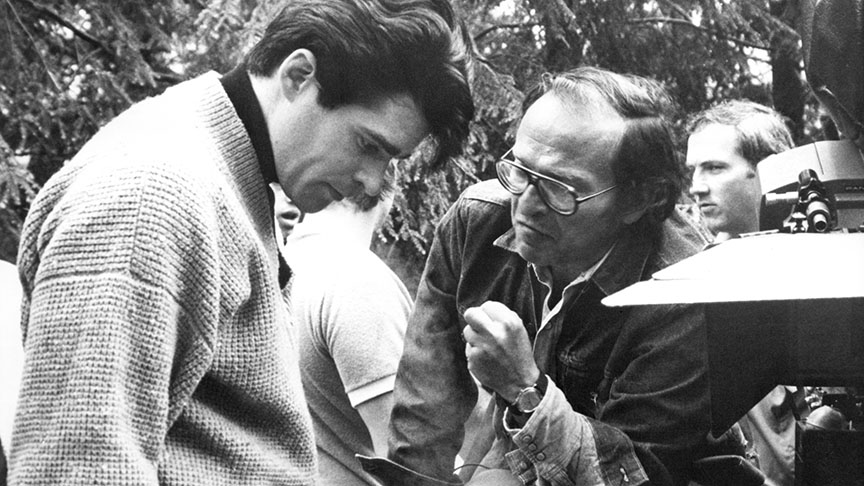
« Oui, nous ne tomberons jamais hors du monde. Nous sommes dedans une fois pour toutes. » (Tragédie Hannibal de Christian Dietrich Grabbe, 1835, cité par Freud dans Le malaise dans la culture).
Du 23 août au 12 septembre 2007 à La Cinémathèque française se tiendra un hommage au cinéaste américain Sidney Lumet (« Sidney Lumet, Le Pouvoir et la Loi ») et en partenariat avec le Festival du Cinéma Américain de Deauville.
Cet hommage est à saluer dans la mesure où il rend compte de l’expérience artistique polyvalente d’un homme qui excelle aussi bien dans la direction d’acteurs (il a été lui-même acteur et a créé un enseignement théâtral dérivé de celui de l’Actor’s Studio) que dans une mise en scène rigoureuse et perfectionniste (il a participé aux débuts et aux succès de la Télévision dans les années 50 comme Wise, Mulligan, Frankenheimer, Ritt, Friedkin). Grâce à son exigence professionnelle, il a pu s’entourer des meilleurs scénaristes (1) (Walter Bernstein, Tennessee Williams, Frank Pierson, Paddy Chayefsky, David Mamet, Larry Cohen…), a su adapter de célèbres pièces de théâtre (Eugene O’Neill, Anton Tchekhov, Tennesse Williams…) et s’entourer des techniciens parmi les plus convoités de la profession.
Ce qui est très émouvant pour nous aujourd’hui, demeure le fait qu’il est l’un des derniers piliers du cinéma américain dans toute sa grandeur « classique » qui, paradoxalement, a poursuivi son âge d’or pourtant révolu à la fin des années 50 (2).
Ce n’est pas anodin qu’Henry Fonda soit ce personnage à l’écoute dans Douze hommes en colère dans la mesure où sa seule présence renvoie au cinéma fordien et à l’exemplarité qui se dégageait de la plupart des personnages des films de ce dernier. Avec Henry Fonda, c’est tout l’âge d’or du cinéma hollywoodien qui fait table rase, qui émet deux, trois hypothèses tout en formulant ses doutes, ses réserves et des questions. Il est à l’écoute… Et cette écoute est prophétique puisqu’elle va non seulement annoncé la grande décennie des films américains des années 70, mais sera également contemporaine et d’actualité dans la mesure où elle s’incarnera dans un cinéaste, Sidney Lumet, à la lisière du cinéma dit « classique » et celui de la « modernité ».
« Es-tu vertueux ? Attentionné ? Crois-tu en ces valeurs ? Es-tu aimé de tous ? Je l’étais aussi. T’imagines-tu que ta douleur sera moindre parce que tu as aimé la bonté ? La vérité ? » (La ligne rouge de Terrence Malick)
Parcours
Né le 25 juin 1924 à Philadelphie, il passe son enfance dans le Lower East Side de New York. Il débute sur scène aux côtés de son père à partir de 1928 sur les planches du Yiddish Art Theatre de New York, et à la radio dans The Adventures of Helen and Mary. En 1931-32, il joue dans le feuilleton The Rabbi from Brownsville de son père Baruch Lumet et, en 1935, dans The Brownsville Grandfather d’Abraham Blum.
« Mon enfance à New-York s’est déroulée pendant la Dépression. Et, comme vous le savez, être pauvre dans une grande ville revient à mener une triste et terrible existence. C’est pire que d’être pauvre à la campagne. Parce qu’il n’y a aucun havre de paix, aucun endroit où respirer, où se retrouver seul. Vous êtes cerné par la foule, dans une boîte. À plusieurs dans une boîte minuscule. Je pense que mes principaux traits de caractère viennent de là. Quand vous êtes pauvre dans une grande ville, vous vous retrouvez très rapidement conscient de la classe à laquelle vous appartenez. Vous devenez vite conscient de votre statut social. (…). Ce sentiment d’enfermement est très fort, même dans mes extérieurs new-yorkais. Je fais très peu de panoramiques. C’est pour traduire à l’image cette sorte de piège psychologique où se débattent beaucoup de mes personnages. Ce que je cherche, quand je tourne en extérieurs, c’est une métaphore ou une illustration directe de la vérité profonde de mon personnage. Quand mes extérieurs confèrent un sentiment de piège, d’enfermement, c’est presque toujours parce que c’est comme ça que je vois mes personnages. » (Sidney Lumet, cinéaste new-yorkais, à propos de Serpico).
Il obtient son premier rôle à Broadway avec Dead End de Sidney Kingsley, toujours en 1935. Par la suite, il participe à : It Can’t Happen Here de John C. Moffitt et Sinclair Lewis (1936), The Eternal Road de Franz Werfel (1937), Sunup to Sundown de Francis Faragoh (mise en scène de Joseph Losey), Schoolhouse of the Lot de Joseph A. Fields et Jerome Chodorov (1938), My Heart’s in the Highlands (3) de William Saroyan (mise en scène par Bobby Lewis du Group Theatre), Christmas Eve de Gustav Eckstein (1939), Morning Star de Sylvia Regan, George Washington Slept Here de George S. Kaufman et Moss Hart, Journey to Jerusalem de Maxwell Anderson (1940), Brooklyn, U.S.A. de John Bright et Asa Bordages (1941).
Il apparaît même aux côtés de Sylvia Sidney dans One Third Of A Nation de Dudley Murphy (1939).
« Participer au Group Theatre fut une grande expérience ; j’avais quatorze-quinze ans et je suis parti à la campagne pendant l’été 1939 avec toute la troupe pour étudier et préparer les mises en scène de la saison suivante. C’est ce qu’ils faisaient lorsqu’ils avaient gagné assez d’argent, ce qui était le cas à la suite du succès de la reprise de Awake And Sing et de la création de The Gentle People d’Irwin Shaw. Tout le monde était là (sauf Lee Strasberg qui était déjà parti) : Elia Kazan, Bobby Lewis, Stella Adler, Harold Clurman, Lee J. Cobb, Maurice Carnovsky. C’est pendant cette « école d’été » que j’ai vraiment appris le métier de comédien ; c’était incroyablement excitant pour le jeune garçon que j’étais. Ils ont commencé par exemple à répéter leur premier Tchekhov, Les Trois Sœurs, sous la direction de Harold Clurman sans finalement le monter. Stella Adler jouait Masha et Luther Adler Tcheboutykine. Je n’ai pas joué dans d’autres pièces montées par le Groupe car il n’y avait pas de rôle d’enfant à me confier ; mais je sortais avec Helen Adler, la fille de Stella, et je ne cessai d’être en contact avec eux jusqu’à mon départ à l’armée. » (Entretien avec Sidney Lumet mené par Michel Ciment, Positif, n° 251, février 1982).
À cause de ses convictions très fortement de gauche, il s’engage à 17 ans dans les « Signal Corps » où il suit un cours d’un an pour travailler au service des radars, que les Anglais venaient de développer, avant d’être envoyé sur le front de Birmanie. Il passe cinq années à l’armée.
Après la guerre, il prend la succession de Marlon Brando dans A Flag is Born, spectacle de Ben Hecht mis en scène par Luther Adler (1946). En 1947, il réagit contre la Méthode (4) (Elia Kazan, Robert Lewis et Cheryl Crawford) en fondant l’un des premiers ateliers off-Broadway, « The Actor’s Workshop », à Greenwich Village, avec une douzaine d’exclus dont Richerd Kiley, Ann Jackson, Eli Wallach et Yul Brynner. Ils y élaborent un programme d’enseignement de trois ans (5).
« N’est-ce pas à cette époque que vous avez monté un atelier d’art dramatique Irving Place ?
C’est même là que j’ai commencé à faire de la direction d’acteurs. J’étais à l’Actors Studio, et je me suis disputé avec Bobby Lewis, qui dirigeait la classe des élèves confirmés. J’ai été exclu, et je suis donc allé à Greenwich Village monter mon propre atelier. »
« Pourquoi avez-vous été exclu ?
Mon différend avec le Studio portait sur le fait que je pensais que nous étions les meilleurs acteurs réalistes du monde, mais que le réalisme n’était qu’un style parmi d’autres. Je pensais qu’au sein d’un atelier, il était très important de travailler d’autres styles de jeu, la comédie classique, Shaw, Shakespeare, Tchekhov, les auteurs grecs… Il faut s’y employer en s’organisant sérieusement, et c’est ce que nous avons fait sur une période de trois ans. C’était merveilleux. » (Projections 11, New York film-makers on film-making, Tod Lippy, 2000)
Il monte plusieurs spectacles d’avant-garde tout en travaillant à la radio et à la télévision. Parallèlement, il donne des cours à la High School For Performing Arts qui venait de créer son département théâtral. En 1948, il fait sa dernière apparition à la scène dans Seeds in the Wind d’Arhur Goodman et, en 1949, grâce à Yul Brynner qui le convainc, il entre à la CBS comme assistant réalisateur (6) avant de mettre en scène Le Bourgeois Gentilhomme de Molière.
De 1951 à 1953, il réalise environ 150 épisodes de la série télévisuelle hebdomadaire Danger (produite par Martin Ritt) et réalise 26 émissions du programme You Are There dont le principe est la reconstitution des plus grands moments de l’histoire des Etats-Unis. Il signe également plusieurs épisodes de la série I Remember Mama (Produite par Ralph Nelson).
À partir de 1953, il se spécialise dans la réalisation de dramatiques en direct, et collabore sur sept années aux programmes Playhouse 90, Kraft Television Theatre, Studio One entre autres, et pour lesquels, il tourne plus de 200 dramatiques.
« Il faut dire aussi qu’au début des années 50, pendant la chasse aux sorcières et après, la télévision était beaucoup plus engagée que le cinéma. J’ai réalisé une double émission sur Sacco et Vanzetti qui a eu beaucoup d’écho dans le pays. Et une semaine après qu’Ed Murrow eut violemment attaqué McCarthy, nous avons enchaîné avec une émission sur le repentir de Galilée dans la série You Are There (7), puis avec les procès de Salem. Tout cela bien sûr était intentionnel. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).
En 1955, il monte à la scène The Doctor ‘s Dilemma de Shaw et, en 1956, Night of the Auk d’Arch Oboler, avec Claude Rains et Christopher Plummer avant que Reginald Rose lui propose d’adapter pour l’écran Douze hommes colère en 1957 (8). Depuis, il a réalisé une quarantaine de films pour le cinéma parmi lesquels Le Gang Anderson (1971), Un après-midi de chien (1975), Network (1976), Le Prince de New York (1981) ou encore Contre Enquête (1990).
« – Vous êtes sans doute le seul réalisateur « commercial » américain qui ne soit jamais allé tourner à Hollywood, en vingt-cinq ans d’activité (9). Pourquoi ?
– Au début, c’était délibéré. Quand j’ai commencé à tourner, l’ancien système des studios existait encore. Il y avait des départements pour chaque domaine : photo, décor, montage, etc. et un chef à la tête, qui avait le droit de donner des ordres à votre directeur de la photographie, à votre décorateur, même s’il n’avait rien à voir avec le film. Et si vous faisiez quelque chose qu’il n’aimait pas, il pouvait facilement saboter votre travail. C’est pour cette raison que je me suis tenu à l’écart de cela. (…). Hollywood ressemble à ces villes du XIXème siècle, comme Bethleem en Pennsylvanie dont toute l’activité dépendait d’une aciérie qui possédait tout. Une ville où il n’y a qu’une profession conduit à des catastrophes. C’est comme les cités d’artistes, ces sociétés idéales fondées pour que l’on y crée : je trouve cela ridicule. Créer, c’est se frotter à la réalité. L’histoire de l’art, c’est l’histoire des grandes villes où l’artiste n’est pas important, où tout n’est pas organisé en fonction de lui. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).
En 2001, il crée et réalise de nombreux épisodes de la série télévisée Tribunal Central (100 Centre Street) dont le thème central est le quotidien des avocats, des juges, des accusés et des témoins de la Cour de la justice new-yorkaise.
Jugé coupable !
D’un côté, Lumet dépeint une machine en branle par l’entremise d’une unité policière, juridique, médiatique, financière et d’un autre côté, il montre, non sans romantisme et mélancolie, un individu en état de grâce, broyé ou non par cette machine, mais qui, par vocation, amour ou conviction, va vivre et incarner une contradiction avec ce qui l’environne. Lumet va non seulement partager cette expérience, souvent tirée de faits réels, mais l’incarner de manière fulgurante le temps d’un film, sachant pertinemment, et c’est là où repose son talent subtil et souvent mal compris par la critique qui veut le rattacher aux démonstrations morales exemplaires pour bonne conscience. Il communiquera cette énergie subversive par l’intermédiaire de certains de ses personnages, qu’elle soit naïve (Al Pacino et John Cazale dans Un après-midi de chien), ambiguë (Le Prince de New York), paradoxale (Peter Finch dans Network), démesurée, généreuse, mais éphémère (Jugez-moi coupable), aveugle et bornée, mais juste (Serpico, Le Verdict).
Ce qui va l’intéresser tout particulièrement, et s’affûter le long de sa carrière, c’est se servir de l’individu comme outil pour entrer dans un système, entrer dans sa psyché (The Offence, Le Prêteur sur gages, Equus) pour y déceler des symptômes sociaux et moraux où chacun puisse s’y retrouver. Lumet se sert du cinéma comme Freud se servait de la psychanalyse, c’est-à-dire fédérer les minorités sociales par les problèmes liés aux tabous, aux préjugés auxquels nous sommes malheureusement tous attachés. Lumet préconise la mise en question perpétuelle, la remise en cause et la culpabilité que ressentent souvent ses personnages qui n’est autre que le parfait alibi pour qu’ils puissent douter. Il faut douter en permanence…
« L’ennemi principal de chaque individu demeure sa propre morale, et le délivrer du jugement qu’il porte sur lui-même, du fait de ses origines de classe, serait, pour tous, un bond en avant. » (Alain Jouffroy, De l’individualisme révolutionnaire)
« Long Day’s Journey Into Night est le premier de mes films « humains », j’entends par là ceux où je ne porte pas de jugement sur mes personnages et où se retrouvent en droite ligne La Mouette, Un après-midi de chien et Le Prince de New York. Chez O’Neill, il n’y a ni bons ni méchants, chacun a ses failles. Il est le versant tragique de la douceur de Tchekhov, avec plus de psychologie mais autant de compassion. (Tennessee) Williams de son côté ne traite au fond que d’un seul sujet : la vie moderne est destructrice. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).
Jeu de rôles
« Rien n’est plus beau que la nature. Elle doit être l’objet d’une continuelle observation. Prenez pour commencer une simple petite fleur, ou bien une de ses pétales, une toile d’araignée, ou un dessin de givre sur une vitre, et essayez d’expliquer par des mots pourquoi vous aimez ces objets. L’effort que vous devrez faire vous forcera à les observer plus attentivement et plus exactement pour mieux les définir. Et ne fuyez pas la nature sous son aspect le plus noir. Cherchez-le dans les marécages, dans la vase, dans la vermine, et souvenez-vous que, derrière ces phénomènes, se cache la beauté. La beauté vraie ne craint pas d’être défigurée. Au contraire, même la défiguration ne fait souvent qu’accentuer la beauté et la mettre en relief.
Recherchez la beauté, et aussi son contraire. Apprenez à les voir, à les reconnaître et à les définir. Sans quoi votre conception de la beauté serait incomplète, artificielle et mièvrement sentimentale. » (Constantin Stanislavski, La formation de l’acteur)
Un autre aspect de son œuvre reste emblématique : le rapport interactif entre les acteurs et les personnages qu’ils doivent interpréter à tel point que tous ses films pourraient être vus comme une véritable mise en abîme complexe sur le métier d’acteur. Non pas dans une dimension propre à la vie traitée comme un rêve ou une illusion propre à la littérature européenne du 17è siècle (La littérature et le théâtre du Siècle d’Or espagnol par exemple), mais dans une perspective où l’individu, socialement et politiquement, est perçu comme un acteur face à ses responsabilités à jouer un rôle moral et social déterminant pour la société, aussi bien seul qu’en groupe. Le Crime de l’Orient Express (Murder on the Orient Express, 1974) et Piège Mortel (Deathrtap, 1982) n’ont pas d’autres raisons d’être que la dimension préfabriquée qu’ils assument pleinement et revendiquent même. Le premier (10) dans cette abondance de célébrités et le deuxième pour le caractère volontairement factice de son sujet (11).
Les deux, acteur et personnage confondus, doivent être à l’écoute. Soit celle-ci bouleverse un groupe par l’entremise d’un individu qui doute comme le démontre Henry Fonda dans Douze hommes en colère, soit celle-ci est « brouillée », mal interprétée, répétée, confuse, voire corrompue et provoque souvent la catastrophe rapprochant ses films de la tragédie.
« Le cœur de tout jeu d’acteur, c’est l’écoute. Peu importe que ce soit au cinéma, au théâtre, à la télévision. En fait, l’élément fondamental, c’est se parler, s’écouter l’un l’autre, c’est au cœur du jeu d’acteur. » (Commentaire audio de Sidney Lumet sur Point Limite). (12)
Le théâtre dans son œuvre filmique est beaucoup plus qu’une simple mise en abîme (les fins respectives de The Deadly Affair et Piège Mortel). Il est très présent dans son rapport à l’unité de temps et de lieu (le huis-clos, les choix de cadrage lié à l’espace ou au personnage…), mais il est capital dans les coulisses du film qu’il tourne. En effet, Lumet organise des répétitions de deux à trois semaines avec les acteurs avant le tournage même de ses films (13).
« La première prise est toujours la meilleure, parce que c’est la plus naturelle (John Ford faisait beaucoup de répétitions avant). Et plus elle prenait du temps, meilleure elle était. J’en ai fait un point d’honneur et les acteurs m’en étaient reconnaissants » (Entretien avec John Ford réalisé par Dan Ford en 1973, bonus du DVD du Mouchard).
Le théâtre est également présent dans les thématiques scéniques qui provoquent les conflits internes et externes de ses personnages. Son œuvre pourrait aussi bien dépeindre l’idéal citoyen que l’idéal comédien et le décryptage de ses films relèverait de la pédagogie la plus utile de l’un à l’autre.
« N’ayez pas peur de vous exprimer. Ne soyez pas impressionné par les événements. C’est important, mais ça dépend de nous. Première leçon d’histoire. » (Point Limite)
Il faut voir Al Pacino dans Un après-midi de chien (14) et ses va-et-vient entre l’intimité d’un groupe qu’il séquestre dans une banque et l’extérieur de celle-ci où s’ameutent policiers, FBI, badauds et médias. Ou encore Paul Newman dans Le Verdict (1982) sur-jouant presque l’avocat alcoolique jusqu’à ce qu’il prenne conscience de la gravité clinique dans laquelle se trouve sa cliente qu’il doit défendre devant le juge et du film dans lequel il joue. Il en va de même pour Sean Connery dans The Offence (1972) ou encore Treat Williams dans Le Prince de New York (1981).
« Un jour, j’ai demandé à Penny Baker, le grand documentariste, quelle était sa méthode essentielle pour faire un documentaire. Il m’a répondu que ce qu’il y a d’essentiel ce n’est pas de diriger le film, mais de le laisser vous diriger. Ça, c’est un talent que je n’ai pas. » (Sydney Lumet, un cinéaste new-yorkais, Bonus du DVD de Serpico)
Le paradoxe le plus génial qui caractérise pour moi son œuvre, c’est d’avoir conféré au cinéma une dimension documentaire non pas à l’aide d’une caméra épileptique ou au grain d’une pellicule proche des reportages qui allaient faire fureur durant la guerre du Vietnam, mais grâce à sa connaissance précise du théâtre. Des espaces scéniques au jeu perfectionniste de ses comédiens (de la performance à l’improvisation, des acteurs aux figurants) et des adaptations théâtrales aux faits-divers.
« Je ne suis pas un reporter, dont le rôle est de recueillir des faits exacts, mais un artiste qui doit rassembler des matériaux capables de faire naître en lui des sentiments. » (Constantin Stanislavski, La formation de l’acteur)
Toute l’œuvre de Lumet découle de son expérience d’acteur et de la passion qu’il éprouve à l’égard de cette profession. S’il a traversé les trois univers artistiques que sont le théâtre, la télévision et le cinéma, avec tant d’aisance, c’est grâce à sa dévotion et sa curiosité inébranlable pour les comédiens (15). Tout son cinéma peut facilement être analysé sous ce prisme-là. Dans Making Movies qu’il a écrit (et où il parle de son métier de cinéaste) et certains de ses commentaires audio des DVD de ses films, il n’hésite pas à dire qu’il considère même la caméra comme l’un des acteurs principaux de son film.
« À mon avis, il y a deux philosophies de base, deux pièges dans lesquels tombent les réalisateurs. D’un côté, il y a la philosophie du « laissez-moi simplement montrer ce qu’il se passe, laissez-moi simplement enregistrer l’action ». À l’opposé, il y a l’école du « filmons entre ses jambes, faisons un super gros plan. » Ces deux postures sont fallacieuses, car la caméra, comme tous les éléments d’un film, doit être en relation avec ce qu’il se passe au niveau dramatique. Il faut diriger la caméra comme on dirige un acteur. » (Sidney Lumet, Making Movies)
AVERTISSEMENT :
NE PAS LIRE L’ANALYSE DES FILMS SUIVANTS SI VOUS NE LES AVEZ PAS VUS !!
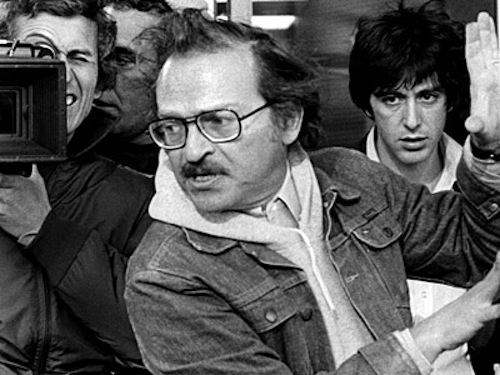
L’analyse des films qui suit n’est pas exhaustive, ni même préférentielle. Les titres manquants (L’Homme à la peau de serpent, The Deadly Affair, Daniel, Dans l’ombre de Manhattan, Gloria,…) sont dus au temps limité pour voir les films et écrire dessus et à la difficulté de trouver certains films du réalisateur en France (Le Groupe, Bye Bye Braverman, La Mouette ou encore Critical Care).
« Héros sacrilèges » (The Offence, Serpico, Le Prince de New-York)
« La vie en commun des hommes n’est rendue possible que si se trouve réunie une majorité qui est plus forte que chaque individu et qui garde sa cohésion face à chaque individu. La puissance de cette communauté s’oppose maintenant en tant que « droit » à la puissance de l’individu qui est condamnée en tant que « violence brute ». Ce remplacement de la puissance de l’individu par celle de la communauté est le pas culturel décisif. Son essence consiste en ce que les membres de la communauté se limitent dans leurs possibilités de satisfaction, alors que l’individu isolé ne connaissait pas de limite de ce genre. L’exigence culturelle suivante est alors celle de la justice, c’est-à-dire l’assurance que l’ordre de droit, une fois donné, ne sera pas de nouveau battu en brèche en faveur d’un individu. En cela rien n’est décidé sur la valeur éthique d’un tel droit. La voie ultérieure du développement culturel semble tendre à ce que ce droit ne soit plus l’expression de la volonté d’une petite communauté – caste, couche de population, tribu –, se comportant à son tour envers d’autres masses de même sorte, et peut-être plus vastes, comme un individu violent. Le résultat final est censé être un droit auquel tous – ou du moins tous ceux qui sont aptes à être en communauté – ont contribué par leurs sacrifices pulsionnels, et qui ne laisse aucun d’eux – là encore avec la même exception –devenir victime de la violence brute. (…).
Il ne semble pas qu’en exerçant une quelconque influence on puisse amener l’homme à muer sa nature en celle d’un ermite, il défendra sans doute toujours sa revendication de liberté individuelle contre la volonté de la masse. Une bonne part de la lutte de l’humanité se concentre sur une seule tâche, trouver un équilibre approprié, c’est-à-dire porteur de bonheur, entre ces revendications individuelles et les revendications culturelles de la masse ; l’un des problèmes qui engagent le destin de l’humanité est de savoir si cet équilibre peut être atteint par une configuration déterminée de la culture ou si le conflit exclut toute réconciliation. » (Freud, Le malaise dans la culture)
Lumet désacralise le héros en lui conférant une dimension « réaliste » soit par une certaine ambiguïté « morale » (une décision morale liée à des prérogatives sociales contradictoires) mettant son personnage en conflit avec lui-même, soit par les moyens pour l’être comme trahir ses proches (la délation est une problématique très complexe dans ses films, de Serpico à Daniel en passant par Le Prince de New York). La notion du « héros » chez lui est donc unique et ambivalente d’autant qu’elle est intimement liée au cinéma par l’aura que ce médium leur confère.
Le protagoniste est souvent traité comme spectateur de ce qui lui arrive et doit passer d’une conception du destin à une autre qu’une remarque de fritz Lang énonce parfaitement :
« Le destin n’est pas une chose à laquelle on ne peut pas échapper. Le destin est ce qu’on fait de sa vie. » (Conversation entre Fritz Lang et William Friedkin, 1975)
Le cinéma de Lumet se place entre ces deux instances. La première est donc le destin qui est prédéterminé par des événements extérieurs et la deuxième est le destin que détermine l’individu pour vivre selon ses aspirations morales et sociales, voire ses ambitions. Lumet part souvent de l’un à l’autre comme l’attestent ses personnages qui soudainement prennent conscience de leur mode de vie habituel problématique. Le cinéaste met en garde le spectateur / citoyen de ne pas sombrer dans la léthargie mentale dans laquelle il s’est embourbé et qu’il traite par la métaphore « spectaculaire » de la corruption via ses films policiers (Serpico, Le Prince de New York, Contre Enquête, Dans l’Ombre de Manhattan). La corruption est toujours présente et elle se manifeste principalement dans les lieux communs. Network (1976) ou Les Coulisses du Pouvoir (Power, 1986) ne parlent que de ça, ils démontrent tous deux comment on crée des clichés, des habitudes, des drogues afin de transformer le citoyen / consommateur en produit effectif et rentable.
« L’aliénation du spectateur au profit de l’objet contemplé (qui est le résultat de sa propre activité inconsciente) s’exprime ainsi : plus il contemple, moins il vit ; plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son propre désir. L’extériorité du spectacle par rapport à l’homme agissant apparaît en ce que ses propres gestes ne sont plus à lui, mais à un autre qui les lui représente. C’est pourquoi le spectateur ne se sent chez lui nulle part, car le spectacle est partout. » (Guy Debord, La Société du Spectacle).
« Il serait temps, je crois, que l’individu se réveille, et qu’il reprenne non seulement confiance dans sa liberté par rapport aux mots, mais qu’il défie par sa propre pensée le pouvoir, culturel et social, des mystificateurs de l’autorité culturelle. Chaque individu est détenteur d’une chance historique qu’on veut lui confisquer, en lui retirant d’abord le droit d’avoir raison à lui seul contre tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout ce qui se pense au-dessus de lui. C’est de cette chance individuelle, de cette brusquerie du désir, de cette pensée non garantie par l’État dont les véritables individus sont porteurs, que, parlant d’individualisme-révolutionnaire, j’ai voulu partir depuis 1965. La terreur anti-individualiste est fille de l’État, qui a ainsi trouvé une forme nouvelle d’étouffement et de répression : on veut faire payer à l’individu son crime de régicide, puis de déicide. Obéissant à un ordre « d’en haut », les savants, les linguistes, les psychanalystes, les théoriciens de gauche et les technocrates de droite ont établi une sorte de consensus, selon lequel l’individu, en tant que tel, devrait maintenant « la boucler ». (…).
Voici le Temps des INDIVIDUS. Non, ils ne seront pas tous des « révolutionnaires professionnels » : loin de là. Est-ce dommage ? Je n’en suis pas sûr. Chacun a le droit de rire, et de jouer, aussi. Mais chacun s’étant découvert, on saura enfin qui parle, et pourquoi. » (Alain Jouffroy, De l’individualisme révolutionnaire).
The Offence (1972)
« Alors, Nietzsche doit avoir raison. Citant Ainsi parlait Zarathoustra. « Dieu est mort : de Sa pitié pour l’homme, Dieu est mort. » (Eugene O’Neill, Long voyage du jour à la nuit).
L’inspecteur Johnson (Sean Connery) voit son quotidien morbide basculé dès que la police britannique arrête le meurtrier présumé de petites filles, Kenneth Baxter (Ian Bannen), que lui et ses collègues n’ont cessé de retrouver sans pouvoir rien faire. Les frustrations éprouvées devant cette enquête vont opérer des bouleversements irréversibles pour lui dès le moment où il sera nez à nez avec le présumé coupable lors d’un interrogatoire…
Adapté de la pièce This story of yours de John Hopkins, The Offence est un film audacieux et original dans sa manière d’aborder son protagoniste. Son personnage est voué à l’échec et n’accepte pas le doute, ni l’épreuve initiatique à laquelle il est confronté, contrairement aux protagonistes tourmentés qui parsèmeront les films postérieurs de son auteur.
The Offence dépeint, avant toute chose, un personnage atypique qui échappe, dans la mesure où il les fusionne, à certains archétypes. En effet, Sean Connery incarne à la fois le rôle social et la solitude existentielle du cow boy (ici dégénéré parce que vieillissant et brimé par les situations qu’il côtoie tous les jours), mais aussi du flic vantard anglais que l’on pourrait à coup sûr croiser dans un pub et qui y déploierait sa grande gueule, infériorisant les autres pour se sentir mieux.
« Parce qu’il faut toujours qu’il ricane de quelqu’un, toujours qu’il cherche la pire faiblesse en chacun » (Eugene O’Neill, Long voyage du jour à la nuit).
Il en résulte un personnage à la fois accessible, vulnérable, mais aussi inquiétant et imprévisible. Il échappe à tout point de vue moral et objectif qui rassurerait le spectateur. Dans le caractère diffus et flou de l’Inspecteur Johnson se trouve, d’une tout autre manière, la gestation du protagoniste du Prince de New York.
The Offence est un film sur Dieu, non pas par le prisme religieux, mais par la foi individuelle et sociale qui hante une petite bourgade par l’entremise de meurtres cruels d’enfants. Le film repose sur le doute existentiel de Dieu face à l’horreur de ces meurtres.
Tout le film baigne dans une lumière austère, grise, verdâtre que ponctuent les auréoles agressives et oppressantes des spots utilisés par le policier pour les interrogatoires. Ces spots représentent plus que la seule autorité judiciaire et institutionnelle sur un individu dans la mesure où ils ponctuent le film et hantent notre anti-héros ; ils représentent l’autorité divine, céleste. Et Sean Connery est écartelé entre ces deux instances qu’il ne peut plus incarné, dans un cas (policier) comme dans l’autre (citoyen, croyant). Dans ce que la morale (16) n’a plus lieu d’être au regard des crimes ou des faits-divers sordides qui compartimentent son quotidien et parce qu’il ne sait plus comment dépenser son énergie justicière. En effet, le coupable est flou ou absent et risque de manquer l’appel pour être le bouc émissaire de ses propres tabous, mais aussi de ses propres fantasmes.
La genèse du Prince de New York se souviendra du film. En effet, le vrai sujet du Prince de New York fut : « Quand nous essayons de tout contrôler, c’est le contraire qui arrive. Rien n’est plus comme il nous semblait. » (Sidney Lumet, Making Movies)
« Mais je suppose que c’est la vie qui l’a rendu comme ça, et qu’il n’y peut rien. Personne ne peut rien contre les choses qui adviennent dans la vie. Elles adviennent avant qu’on ait eu le temps de s’en apercevoir, et une fois qu’elles sont advenues, elles vous font faire d’autres choses jusqu’à ce qu’en fin de compte tout vienne se mettre entre vous et ce que vous voudriez être, et que vous ayez perdu à tout jamais votre être véritable. » (Eugene O’Neill, Long voyage du jour à la nuit).
La profession de l’inspecteur Johnson implique de tout contrôler. Mais l’enquête lui échappe et à mesure que celle-ci s’effiloche, il perd le contrôle sur lui-même jusqu’à ne plus contrôler ses fantasmes. Ces derniers s’en voient même dénaturés par tout ce qu’il a pu voir au travers de son métier (images fragmentaires d’horreur compilées ponctuent le film dans un montage perturbateur faussement arbitraire proche de certains films de Resnais (17)). Et l’intérêt du film réside dans la contamination du personnage sur tout le film. Nous aussi, nous perdons petit à petit de notre morale dans la mesure où les deux grandes instances qui nous retiennent (refrénnent) sont l’autorité institutionnelle juridique, légale et Dieu. Et sans ces dernières, ce serait certainement le chaos et il n’y aurait plus de morale.
« Tu confonds ce qui est moral avec ce qui est légal » (Sidney Lumet, Family Business)
Ce chaos va s’incarner dans la dernière scène du film où Johnson va finir par torturer un présumé coupable (comme un « présumé innocent », le doute est bien préservé). La dérive humaine que représente Johnson c’est qu’il ne supporte plus le doute, il faut que tout soit clair, rangé, jugé. Il est l’un de ces jurés hargneux de Douze hommes en colère qui projette sa vie affective dépressive sur des individus en jugement qu’il ne connaît même pas et qu’il juge avec toute la haine possible entraînant l’inculpé dans une spirale juridique irrémédiable.
Même le décor professionnel du commissariat, autrement dit le lieu de travail de Johnson, s’en voit bouleversé et devient un véritable purgatoire où il est en instance de jugement. La vie de Johnson finit dans ce lieu-dit comme l’attestent les flashes back du film sur la bavure qu’il a commis en tuant cet homme, Kenneth Baxter, pour le faire parler. Le film s’arrête sur ce flash back au lieu de finir sur l’entrevue entre Johnson et le Lieutenant Cartwright (Trevor Howard) dont découle ces aveux « visuels ». Et le ralenti de l’image confirme une distorsion du temps renforçant le huis clos de la deuxième moitié du film entre Johnson et Baxter.
Pour finir, Lumet nous fait épouser subtilement le sadisme de son protagoniste sur sa victime : le faciès de ce dernier (Baxter) et les expressions volontairement exagérées (le maquillage, les angles, la lumière et le jeu de l’acteur) jouent sur le fantasme collectif et commun du spectateur vis-à-vis du délit de « sale gueule ». De plus, Lumet corrompt le point de vue « moral » de son film dans ce lynchage devenu « collectif », c’est-à-dire qu’il induit la complicité, la collaboration de son spectateur,
À la fin du film, Johnson se perd dans ses fantasmes qui le rendent extatique : baigné par une lumière chaude et douce, il se voit comme le tendre complice et partenaire d’une petite fille allongée dans un décor extérieur, forestier. Il réanime par ses fantasmes l’une des jeunes victimes. La tendresse malsaine éprouvée par Johnson pour cette petite fille est en nette opposition avec toute la lumière générale du film (18), ce qui implique un soulagement, une délivrance permise par le réalisateur pour son spectateur (19), mais pour une scène dont le sujet relève pourtant du comble de l’interdit dans ce qu’elle suggère.
« Je déteste montrer la violence. Je l’ai fait dans un ou deux films. Parce que je pense que le public participe avec moi. Je ne pouvais pas montrer dix exemples de ce que l’assassin faisait à un enfant. Ça aurait été de mauvais goût. Je m’en serais voulu de la montrer. Et en ne la montrant pas, le public, chaque membre du public pouvait penser à la chose la plus atroce selon son imagination. Par conséquent, le public entier collabore avec moi. » (Fritz Lang à propos de M. le Maudit dans Conversation entre Fritz Lang et William Friedkin, 1975).
La réussite de ce film n’a d’égal que son habile perversité. The Offence est certainement un tournant dans la carrière de Lumet vis-à-vis de ses protagonistes et de l’ambivalence complexe qui peut en émaner. Lumet, plus que jamais, pousse l’adhésion malsaine du spectateur jusque dans le sadisme de son protagoniste qui dégrade un individu en outrepassant les droits qu’il a sur lui, tant sur le plan psychologique (il l’insulte, l’infériorise) que physique (il le bat à mort). Et dans ses scandaleuses déviances sexuelles traduites sur le plan formel (images vaporeuses en contrastes avec tout le reste du film, ralenti, bonheur extatique et libérateur du protagoniste lors de son fantasme morbide et pédophile…). D’ailleurs, Lumet n’en démord pas, c’est le titre même de son film : « The offence » (délit, infraction, offense, péché), « to offend » (offenser, offusquer, choquer, heurter).
Le cinéma, selon Sacco et Vanzetti, est perçu comme des « idylles qui déforment la vérité et les réalités de la vie, qui cultivent et embellissent toutes les émotions morbides, toutes les confusions, toutes les ignorances, tous les préjugés, toutes les horreurs, et qui, volontairement et avec habileté, pervertissent les cœurs et, plus encore, les esprits » (The lettres of Sacco and Vanzetti, londres, 1929, cité dans – Jay Leyda, Kino. Histoire du cinéma russe et soviétique).
Serpico (1973)
« Je pense que nous devons d’abord être des hommes, des sujets ensuite. Le respect de la loi vient après celui du droit. La seule obligation que j’aie le droit d’adopter, c’est d’agir à tout moment selon ce qui me paraît juste. On dit justement qu’une corporation n’a pas de conscience ; mais une corporation faite d’êtres consciencieux est une corporation douée d’une conscience. » (Henry David Thoreau, La désobéissance civile).
À New York, un Inspecteur de police, Frank Serpico (Al Pacino), intègre et idéaliste, subit quotidiennement la corruption à l’intérieur des services de police. Obsédés à arrondir leur fin de mois par le racket, les policiers corrompus se méfient de lui et craignent qu’il les trahisse alors qu’ils ne font que ralentir les enquêtes de celui-ci. Dépité par les habitudes scandaleuses de ses collègues, Serpico en réfère à ses supérieurs, mais découvre que là aussi le secteur est vérolé. Il décidera donc de faire éclater le scandale au grand jour en se confiant au New York Times.
Dès l’ouverture du film, on est surpris par l’aspect mystique du film et de son personnage. En effet, le flic modèle Frank Serpico vient de se faire descendre. Sa stature sur la civière relève du martyr christique, et le montage parallèle qui s’ensuit sur le discours à l’égard des policiers qui ont fini leur formation – dont fait parti ce même personnage dix ans plus tôt – a tout l’air d’un sermon.
« Être policier, c’est avoir foi en la loi, la faire appliquer sans enfreindre les droits, à l’égalité et à la dignité, de chaque individu.
Chaque jour, vous serez à l’épreuve : physiquement et moralement. Cela réclame intégrité, courage, honnêteté, tolérance, courtoisie, persévérance et patience. Vous voilà soldats de la guerre du crime, aptes à mettre la théorie en pratique dans la rue. » (Serpico de Sidney Lumet).
Ensuite, le cheminement initiatique de Serpico dans les forces de l’ordre et ses rencontres avec les citoyens relèverait presque de la vie du Christ. Et ses rencontres avec ses collègues policiers sont décrites de manière à ce que ces derniers ressemblent aux « mauvais » Romains du Nouveau Testament qui ne tarderont pas à vouloir sa perte. D’autant plus que ces « mauvais » policiers rencontrés contredisent le beau discours du début. En effet, au lieu de « héros », Serpico rencontre des policiers corrompus, tirs au flanc, violents, incompétents, racistes, extrémistes, zélés, conformistes ou simplement irresponsables qui violent la loi continuellement. Les symptômes criminels sont incarnés par les policiers eux-mêmes et non par les voleurs, les violeurs ou les dealers que Serpico arrête le long du film. Toute son énergie et ses investigations reviennent au point initial, c’est-à-dire à son lieu de travail, le commissariat, censé être le sacro-saint lieu des bonnes valeurs à défendre et à protéger.
« C’est surprenant. Incroyable. Mais je ressens comme un délit, d’être probe. » (Serpico de Sidney Lumet).
« S’ils (les flics) mettaient leur énergie au service de leur tâche de flic, la ville serait propre en 8 jours. Sans pègre. Si je pouvais travailler seul, ce serait la solution. Seul ! Mais pas moyen. Les autres t’englobent. (…). Ils sont pourris. Tous ! Chacun d’eux se vautre ! Il doit y avoir un moyen de nettoyer ça ! » (Serpico de Sidney Lumet).
Comme pour Douze hommes en colère ou Un après-midi de chien, Lumet développe une idée morale conceptuelle à partir de son personnage pour s’étendre et contaminer éventuellement d’autres personnages à l’image peut-être qu’il se fait du cinéma sur les spectateurs ou des arts en général. C’est un rapport pédagogue et il lui est légitime. Il traite d’ailleurs la ville de New York comme un univers kafkaïen réduisant encore plus la corpulence d’un Pacino devenu prométhéen et renforçant sa solitude.
« J’aime utiliser les décors et la mise en scène pour traduire ce qu’il se passe émotionnellement dans le film. C’était un homme seul. Et qui n’avait personne vers qui se tourner. J’ai donc laissé les rues vides. Je ne voulais pas que l’on puisse l’aider. Il était seul. » (Bonus du DVD de Serpico, « Les coulisses du tournage par Sidney Lumet »).
New York devient comme une hybridation sociale et métissée, un Titan, face auquel Serpico doit faire face et affronter. À l’image d’une petite souris dont il se sert pour trouver la drogue ou à celle biblique d’un David contre Goliath. Tout le film, malgré le mode de récit quasi picaresque (20) dans son découpage effréné qui scande la vie d’un homme comme une succession d’événements (du particulier « affectif » au général « criminel ») renvoyant également sa stature à Don Quichotte (de sa solitude à sa marginalisation).
« Je comprends votre amertume. C’est un peu se battre contre des moulins à vent. » (Serpico de Sidney Lumet).
Ce qui a sûrement fasciné Lumet pour faire ce film (21), c’est combien son protagoniste incarne ce que l’image du flic ne convie ou ne permet pas. Son rapport tendre aux animaux (il a un chien et un perroquet et travaille avec une souris pour repérer la drogue chez les dealers) contrecarre l’image virile et dure des flics, et rappellerait une comédie familiale comme Dr Dolittle de Richard Fleischer (1967). Il porte des fringues hippies et une attitude « cool », ce qui représentait à l’époque un affront vu les idéaux politiques divergents des deux. Il est éveillé, curieux et s’intéresse à tout jusqu’à même prendre des cours d’espagnol et de danse. Il a une réelle vocation, contrairement à ses collègues ; elle lui permet de rester lui-même du matin au soir sans être obliger de se dédoubler pour assumer les labeurs d’une dure journée. Et enfin, c’est un solitaire qui refuse de se cacher ou se protéger derrière la solidarité ou les liens « consanguins » entre flics qui se complaisent à truander les dealers pour arrondir leur fin de mois (« indemnités de licenciement ») comme s’ils purgeaient une peine. Sa vocation et sa dévotion vont pourtant le mener à un véritable chemin de croix.
« Tu veux être libre, sans attaches, pour continuer à te battre et à te torturer » (Serpico de Sidney Lumet).
Ce sur quoi s’insurge Lumet, avec son personnage, c’est comment le policier américain bénéficie d’une couverture sociale exempte de toute corruption qu’il va dénaturer dans la mesure où celle-ci légitimera tous les travers moraux de celui qui la revêt, lui ouvrant ainsi toute une voie criminelle. C’est pourquoi Serpico, grâce à sa réelle (et mystique) vocation depuis l’enfance, est protégé de cette « toison » policière. Sa boucle d’oreille, son chapeau, sa barbe, ses longs cheveux et tout le reste de son attirail font office de talismans pour s’en préserver, en plus de ses convictions personnelles et de sa volonté d’être proche de l’homme de la rue.
« Ce qui est passionnant chez Serpico, c’est, c’était un perturbateur depuis le début. C’était un homme toujours en révolte contre l’autorité. Et c’était fascinant de voir un personnage comme lui dans un service de police. Car la structure autoritaire y est tellement rigide et stricte et pour lui de s’intégrer en tant que policier avec son caractère rebelle, je trouvais ça fascinant. » (Bonus du DVD de Serpico, « Les coulisses du tournage par Sidney Lumet »).
La richesse narrative et critique du film est également manifeste dans ce paradoxe : plus il s’éloigne de sa famille (que l’on sent bien présente au début, et que renforce l’utilisation minimale de la musique du film composée par Mikis Theodorakis (22)), plus il se rapproche des autres, le transformant en réel ascète exempt de toute aliénation sociale possible due à la corruption (de la famille à la profession sociale).
« J’étais un individualiste et aucune organisation n’aime les individualistes. Ils ne veulent pas que tu penses pour toi. C’est comme à l’armée. Faut suivre les instructions. Ne pose pas de questions ! Et c’est très dangereux. C’est ce qu’il s’est passé en Allemagne nazie. Et beaucoup pensent que ça peut se produire ici aussi. Si les gens ne posent pas de questions et ne demandent pas justice. Ce pays ne croit même pas à la législation. J’ai peur de parler parfois et qu’ils pensent que je sois anti-américain. Pourtant j’ai servi ce pays. » (Bonus du DVD Serpico, « Entretien avec Frank Serpico »).
Avec Serpico, Lumet dégage les problématiques morales et sociales déterminant un « héros » aujourd’hui et le phénomène médiatique qu’il provoque. Sa conclusion est la suivante : on aime les héros à distance et, assurément, grâce et par l’intermédiaire des médias, mais on l’exècre quand on est à sa proximité dans la mesure où il va à l’encontre de nos intérêts et de notre confort, remettant de surcroît en cause les fondements mêmes de notre existence. Voilà ce qu’est le « héros » pour Lumet, dépoussiéré de l’hypocrisie et des « consciences maquilleuses ». La problématique de ce statut narratif et figuratif intimement lié au cinéma américain, et particulièrement au western, est ici contemporaine vis-à-vis du genre policier qui, par l’entremise du détective ou du looser, a digéré la figure anachronique, mais juste, du cow-boy. Et pour nous, aujourd’hui, reste pertinente dans la formulation de la question suivante que pose le film à toutes les sociétés occidentales dites civilisées : « Qu’est-ce un héros pris dans ces prérogatives aujourd’hui ? » Assurément et avant tout quelqu’un de mal-aimé, qui contredit et complique une organisation bureaucratique ou une collectivité sociale, et surtout qui finit seul, incompris.
« Il était une fois un Roi, qui régnait avec sagesse. Au centre du royaume, un puits, où tous venaient boire. Une nuit survint une sorcière qui empoisonna le puits. Le lendemain, tous y burent, sauf le Roi, et tous devinrent fous. Alors, ils se réunirent et dirent : « Débarrassons-nous du Roi, car notre Roi est fou. » La nuit, le Roi but de l’eau du puits. Et le lendemain, ses sujets se réjouirent car leur Roi avait retrouvé la raison. » (Serpico de Sidney Lumet)
« Expliquant pourquoi nous ne sommes pas des idéalistes, Nietzsche, dans Le Gai savoir, fait en sorte que toutes les ambiguïtés, qui pèsent sur les individus depuis la promulgation de la loi révolutionnaire, ont été levées comme des tabous :
« … pendant la plus longue période de l’humanité, il n’y a rien eu de plus terrible que de se sentir isolé. Être seul, sentir en isolé, ne pas obéir, ne pas dominer, signifier un individu, ce n’était point alors plaisir mais punition ; on était condamné à être « individu ». » » (Alain Jouffroy, De l’individualisme révolutionnaire).
« Quiconque attente à une vie d’homme, à la liberté d’un homme, à l’honneur d’un homme nous inspire un sentiment d’horreur, de tout point analogue à celui qu’éprouve le croyant qui voit profaner son idole. Une telle morale n’est donc pas simplement une discipline hygiénique ou une sage économie de l’existence ; c’est une religion dont l’homme est, à la fois, le fidèle et le Dieu. » (Émile Durkheim, L’individualisme et les intellectuels) (23).
Lumet va se servir de cette morale (héritée selon Durkheim de l’individualisme professé par Kant, Rousseau, des spiritualistes…) pour faire de Serpico un héros de fait et gagner du temps, par cette économie narrative, ramenant la figure de ce policier aussi bien à la figure du « loner » (de cow-boy incorruptible) qu’à la figure christique (sa tenue « grunge » ou « hippie » réactualise l’imaginaire vestimentaire de cette icône religieuse) pour ne s’intéresser finalement qu’à deux seules choses. La première, c’est la solitude du héros que l’on préfère admirer de loin plutôt que de s’y coller. Les héros, on l’a dit, on les préfère médiatisés que de les côtoyer dans notre intimité dans la mesure où ils menacent notre confort social et moral. La deuxième, c’est la mise en abîme de l’acteur par l’entremise du « jeu de rôles » que Serpico pratique pour mieux s’infiltrer afin d’arrêter les gros bonnets de la drogue (24). Ce qui intéresse donc Lumet, ici, c’est comment la représentation, ou ce qui relève du jeu des acteurs, va investir la réalité pour la rendre meilleure.
« Al Pacino était le meilleur choix pour interpréter Serpico. Aussi un rebelle. Il lui ressemble en plusieurs points, peut-être un peu plus beau mais très similaire. Al travaille en profondeur les personnages qu’il interprète, c’est vraiment ce qui l’intéresse, plus que le sujet du film lui-même. Il s’intéresse à la complexité du personnage, et sur ce film il a rencontré le personnage le plus complexe imaginable. » (Bonus DVD Serpico, « Les coulisses du tournage par Sidney Lumet »).
« Le véritable acteur est celui qui désire créer en lui-même une autre vie plus profonde, plus intéressante que celle qui l’entoure en réalité. » (Constantin Stanislavski, La formation de l’acteur).
Pacino va, pour Serpico, appliquer cette méthode d’investigation propre au théâtre via son personnage de policier qui se dresse contre l’appartenance affective et humaine des policiers en dehors de leur service, ce qui les exclut de toute réalité dans sa diversité sociale et morale, mais aussi de toute objectivité (le temps diégétique représente dix années de la vie de cet homme).
« À l’aide d’une dégaine à nouveau élastique, d’une mâchoire tantôt agitée (il mâche sans cesse du chewing-gum lors de son recrutement), tantôt tendue (quand il se rend compte de son impuissance devant la corruption de ses collègues), de coups de gueule qui fusent – par cinq fois – à la moindre frustration, de regards qui passent progressivement de la réprobation au découragement, d’un corps qui se déplace penché vers l’avant, écrasé par le poids d’une ordalie trop lourde à porter, de mains aux mouvements incertains qui se raccrochent aussi bien à une barbe mal taillée qu’à une longue chevelure hirsute qui ne sont là que pour dissimuler un autre trop plein de candeur obsolète, à l’aide, par ailleurs, d’un accoutrement « grunge » avant l’heure qui en fait un marginal de la contestation attardée, Pacino brosse le portrait d’un être décalé dans le temps, égaré dans l’espace, mais déterminé à imposer sa vision idéale de la police à quiconque ne la partage pas encore. » (Pacino-De Niro, Regards croisés, de Michel Cieutat et Christian Viviani, Dreamland éditeur).
Pour Un après-midi de chien (avec Pacino encore), il va l’incarner de manière fugitive (le temps diégétique est d’une journée et correspond à un hold-up) et le concentrer sur un être désespéré qui déploiera, de manière inconsciente et suicidaire, cette démarche, le transcendant et le fera quitter, un temps soit peu et de manière illusoire, sa condition sociale pathétique et misérable. Mais Lumet, grâce à Pacino dans ses deux rôles, pratiquera cet adage tiré de Stanislavski :
« Retenez bien ceci : chacun de nos actes, même les plus simples et les plus familiers de notre vie quotidienne, deviennent contraints lorsque nous devons les accomplir derrière la rampe, devant des centaines de spectateurs. C’est pourquoi il faut absolument vous rééduquer, vous réapprendre à marcher, à vous asseoir, etc., et surtout à voir les objets que vous regardez sur la scène et à entendre ce que vous écoutez. » (Constantin Stanislavski, La formation de l’acteur).
Lumet expérimente et confronte constamment le jeu d’acteur à la réalité. L’exemple le plus canonique demeure Le Prince de New York où il confronta acteurs expérimentés et non professionnels (25).
Et préservera à nouveau sa technique chère des répétitions (26) avant un tournage qu’il finira plus tôt que prévu.
« Suivant la complexité des scénarios, j’ai de deux à quatre semaines de répétitions avec eux (les comédiens). Je les rassemble et nous jouons toutes les scènes, y compris les poursuites, les bagarres. Deux ou trois jours avant le tournage, ils interprètent le film entier en continuité, comme pour la répétition d’une pièce. Pour moi, c’est vrai et cela remonte à la méthode que j’employais pour préparer mes dramatiques télévisées en direct. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).
Il conférera à nouveau d’innombrables idées de jeu renforçant la dynamique de son film en plus de son découpage, du tournage au montage (27).
« Tout ce qui se passe sur la scène doit avoir un but. Même si vous restez simplement assis, il doit y avoir une raison, un but précis, et pas seulement celui d’être en vue des spectateurs. On n’a pas le droit de rester assis sans raison sur scène. Il faut l’obtenir, et ce n’est pas facile.
(…).
Lorsque vous êtes sur la scène, vous devez toujours être en train de faire quelque chose. L’activité, le mouvement sont à la base de l’art de l’acteur. » (Constantin Stanislavski, La formation de l’acteur).
Le Prince de New York (Prince of the City, 1981)
« C’est un film sur la tromperie. Les bons se révèlent être affreux. Et certains des méchants, bons. Ceux qui sont moraux se comportent immoralement. Les immoraux avec une grande noblesse, parfois. Mes définitions du bien et du mal se sont embrouillées. Comment raconter cette histoire, sur le plan visuel ? Comment aborder ce thème sans dire : « Les gars, voilà ce qui s’est passé. » Les appareils les plus mécaniques qu’on ait utilisés étaient mes objectifs. Aucun objectif ne peut rendre ce que voit l’œil, mais les plus proches sont les 30 à 40 mm. J’ai jeté tous ces objectifs-là. Je ne voulais pas d’objectifs qui donnent une image simple. J’ai pris soit de très grands angulaires, soit des focales très longues, qui modifient les distances. Les images étaient compressées ou étalées sur un écran plus large. Il y a un plan où Treat Williams monte l’escalier du tribunal le matin où il va dénoncer ses partenaires. J’ai pris un très grand angulaire et il paraît minuscule, en montant lentement les marches. C’est très efficace, et relativement simple. Voilà ce qu’on a fait en gros. Puis, la façon d’utiliser la lumière, avec Andrzej Bartkowiak. J’ai parlé à Andrzej de faire émerger les personnes de l’arrière-plan. Au début du film, le monde extérieur est très présent. On voit tout, on ressent tout. La rue, les enseignes au néon. À la fin du film, la seule chose importante, ce sont les visages. » (Sidney Lumet dans Prince of the City : The Real Story de Laurent Bouzereau, bonus DVD du film).
L’histoire étant complexe et impossible à résumer en deux mots, j’ai décidé de déléguer ce labeur par le résumé fort utile du film que l’on trouve dans le Dictionnaire des films écrit sous la direction de Bernard Rapp et Jean-Claude Lamy pour les éditions Larousse :
« 1971. Dany Ciello (Treat Williams) est ses collègues Levy (Jerry Orbach), Marinaro (Richard Foronjy), Mayo (Don Billett) et Bando (Kenny Marino) appartiennent à une section spéciale de la brigade des stupéfiants. Chargés d’appréhender le « gros gibier », ces « Princes de New York » opèrent selon leurs propres règles, s’aidant d’informateurs toxicomanes qu’ils approvisionnent en drogue. Fragile et vulnérable, Dany assume difficilement les contradictions et les hypocrisies de son métier. Après bien des réticences, il décide de collaborer à une commission d’enquête sur la corruption policière, à laquelle il livrera un à un tous ses camarades ».
Le Prince de New York poursuit et réactualise le sujet autour des corruptions policières de Serpico et s’amuse à inverser ce qu’une fonction revendique par sa représentation sociale et que permet l’imaginaire collectif qui s’y rattache par son éducation civique. Le héros a bien changé et est difficilement perçu comme tel. Il est ambigu, paradoxal, flou, mais les conséquences de ses actes aboutissent à la même finalité : un exil ou une solitude forcée. Le film traite de la corruption généralisée où les malfrats, flics et agents du FBI ne cessent de s’intervertir. Il en résulte deux instances critiques capitales. La première : « L’habit ne fait pas le moine », il faut donc se méfier continuellement des caractérisations sociales et des préjugés qui s’y rattachent (vis-à-vis de l’homosexualité dans Un après-midi de chien, du racisme dans Contre Enquête et de l’autorité tronquée dans Serpico par exemples) et remettre constamment en cause ce que l’on apprend ou ce que l’on a appris. La deuxième : tout le monde est emprunt de culpabilité avec laquelle il faut apprendre à vivre, et à des échelles différentes bien sûr, selon les individus (Le Crime de l’Orient Express traite également de cette culpabilité collective, mais avec détachement et dérision).
« La seule différence entre toi et un type avec un masque, c’est que toi, tu as un badge. Tu es aussi pourri que lui. » (Le Prince de New-York de Sidney Lumet).
« On appartient aux gens qu’on poursuit. » (Le Prince de New-York de Sidney Lumet)
Les indics de Dany Ciello sont tous des substituts fraternels et l’analogie s’étend sur tous les dépravés, drogués, ce qui lui renvoie non seulement une mauvaise image de lui-même, un policier incapable de venir en aide à son propre frère, mais aussi qui décrédibilise sa profession.
« C’est vrai, je donne de l’héroïne à mes indics. Ils n’ont personne d’autre que moi. Ils sont malades et je me sens responsable d’eux. Mais aux yeux de la loi, je leur donne de la came, comme un dealer. C’est un crime. Pourquoi vous ne m’arrêtez pas ? Parce que je vous suis aussi utile que mes indics le sont pour moi. » (Le Prince de New-York de Sidney Lumet)
Treat Williams joue un policier qui flambe sa vie et dont la vocation policière retrouvée et expiatoire ne relève pas de celle qui animait Serpico, mais plutôt de quelque chose de désespéré, de suicidaire. Mais les deux personnages convergent dans le caractère mystique qui sous-tend leur délation, et remettent à jour le passage biblique peut-être le plus incompris et pourtant des plus populaires : la trahison de Judas.
« Je voulais être absous. Comment des types comme nous peuvent recevoir les sacrements ? » (Le Prince de New-York de Sidney Lumet)
Il porte des micros qui lui brûlent la peau, lui font des plaies sur son corps et la lumière du film se contrastant au fur et à mesure, jusqu’à créer une sorte de « clair obscur », ne peut éviter de convier le spectateur à la combinatoire du Christ et de Judas en la personne de ce flic repenti. On oscille entre ces deux figures que l’imagerie populaire a toujours voulu opposer, pour finalement aboutir à la conclusion qu’il s’agit d’une seule et même personne.
« Ergo, la trahison de Judas n’a pas été fortuite ; elle fut un fait préfixé qui a sa place mystérieuse dans l’économie de la rédemption. (…) le Verbe, quand il s’incarna, passa de l’ubiquité à l’espace, de l’éternité à l’histoire, de la félicité illimitée au changement et à la mort ; pour correspondre à un tel sacrifice, il fallait qu’un homme, représentant tous les hommes, fît un sacrifice condigne. Judas Iscariote fut cet homme. Judas, le seul parmi les apôtres, pressentit la secrète divinité et le terrible dessein de Jésus. Le Verbe s’était abaissé à être mortel ; Judas, disciple du Verbe, pouvait s’abaisser à être délateur (la délation étant le comble de l’infamie) et à être l’hôte du feu qui ne s’éteint pas. L’ordre inférieur est un miroir de l’ordre supérieur ; les formes de la terre correspondent aux formes du ciel ; les taches de la peau sont une carte des constellations incorruptibles ; Judas reflète Jésus en quelque sorte. De là les trente deniers et le baiser ; de là la mort volontaire, pour mériter encore davantage la Réprobation. C’est ainsi que Nils Runeberg élucida l’énigme de Judas. (…).
Imputer son crime à la cupidité (comme l’on fait quelques-uns, en alléguant Jean 12 : 6) c’est se résigner au mobile le plus grossier. Nils Runeberg propose le mobile contraire : un ascétisme hyperbolique et même illimité. L’ascète avilit et mortifie sa chair pour la plus grande gloire de Dieu : Judas fit de même avec son esprit. Il renonça à l’honneur, au bien, à la paix, au royaume des cieux, comme d’autres, moins héroïquement, à la volupté. (…).
Dieu s’est fait totalement homme, mais homme jusqu’à l’infamie, homme jusqu’à la réprobation et l’abîme. Pour nous sauver, il aurait pu choisir n’importe lequel des destins qui trament le réseau perplexe de l’histoire ; il aurait pu être Alexandre ou Pythagore ou Rurik ou Jésus ; il choisit un destin infime : il fut Judas. » (Jorge Luis Borges, Fictions, « Trois versions de Judas »).
De Serpico au Prince de New York, Lumet confronte un héros à ses personnages puis un acteur à ses spectateurs, c’est pourquoi il affectionne tant les dispositifs pénaux et juridiques que sont un interrogatoire dans un commissariat (The Offence). Ou les procès qui jalonnent son oeuvre et pour lesquels il a adopté et décliné tous les points de vue possibles et imaginables (le jury, l’avocat, le juge, le témoin…). Ces dispositifs austères et institutionnels ressemblent étrangement à ceux du théâtre ou d’un spectacle qui reposerait sur une unité de temps et de lieu réduit et qui mettrait à l’épreuve le talent des deux acteurs choisis au centre d’un lieu à la fois conceptuelle ou allégorique, d’un lieu à la fois anodin et « spectaculaire ».
« On a découpé le film en trois parties. Dans le premier tiers, l’arrière-plan est plus chaud, plus éclairé que les visages. Dans le deuxième tiers, c’est équilibré. Pour le troisième tiers, seuls les visages sont éclairés, on a laissé les arrière-plans tels quels. En choisissant les lieux de tournage, les décors, on les emplissait de vie, d’activité, de néons allumés dans la rue. « Je veux plein d’enseignes au néon… » etc. Dans un bureau, des papiers partout, pourvu que ça ait l’air très actif. Au fur et à mesure, on a épuré. À la fin, on ne voit plus rien en arrière-plan. Il n’y a plus que des murs nus. Même le tribunal change. Le premier tribunal est vieillot, très décoré, tout en bois, avec plein de place pour le public, etc. Le dernier tribunal, par contre, est moderne, avec des murs nus. Il n’y a personne dans le public. Très monochrome. Tout est fait de façon très fluide, on ne s’en rend pas du tout compte. J’ai trouvé le résultat très satisfaisant, car ça donne un film très stylé, sur le plan visuel. On jurerait que c’est réel. » (Sidney Lumet dans Prince of the City : The Real Story de Laurent Bouzereau, bonus DVD du film).
« C’est une histoire vraiment tragique. Ça commence sur des espoirs, et peu à peu, tout s’écroule autour d’eux. Tout ce qu’ils avaient envisagé part en sens inverse. » (Sidney Lumet dans Prince of the City : The Real Story de Laurent Bouzereau, bonus DVD du film).
Serpico n’a pas vraiment d’amis, ou une poignée infime à la rigueur, mais fédère unanimement les spectateurs : on le suit en permanence, obligé d’adopter son point de vue et on ne peut que s’identifier – ego oblige – à l’affirmation constante de son individualité romantique.
Par contre, Dany Ciello, dans Le Prince de New York, pousse beaucoup plus loin les problématiques énoncées par Serpico, redéfinissant ainsi ce qu’est un « héros » dans la vie « réelle ». Il n’est plus romantique, mais pathétique et sa silhouette incertaine, voire même confuse, lui permet difficilement d’avoir une empathie possible avec son spectateur. Lumet, grâce à ce personnage atypique et inclassable, et à l’interprétation géniale et très sous-estimée de Treat Williams (28) (qui interprète parfaitement cette zone d’ombre), réussit à préserver jusqu’au bout le caractère polémique qui se rattache à l’individu complexe qu’il a dépeint jusqu’ici.
« Une des raisons pour lesquelles c’est un bon film, c’est que je n’étais jamais sûr de rien. Je me sentais ambivalent. Avec des hauts et des bas. Par exemple, quand il donne un cours, dans la dernière scène. Il ne fait pas de scandale. Il a parlé simplement et l’autre est sorti. Sa position morale. L’expression sur le visage de Treat était superbe. Ça disait tout : « Je comprends, tu as raison. » Et : « Tu as tort, tu ne comprends rien à rien, bordel ! » Les deux éléments étaient présents. Une fois le film fini, je l’ai regardé et j’ai dit : « Il est héroïque. » (…). C’est ce que j’ai fait de plus abouti. D’abord, parce que c’était exempt de jugement. Je laissais l’ambivalence : est-ce un héros ou un méchant ? C’est à vous de décider. Je n’ai pas imposé mon approbation ou désapprobation du personnage principal. » (Sidney Lumet dans Prince of the City : The Real Story de Laurent Bouzereau, bonus DVD du film).
Lumet réussit certainement, avec Le Prince de New York, son film le plus réussi sur les questions des préoccupations personnelles et thématiques que le sujet implique. L’aspect documentaire du film permis paradoxalement par certains dispositifs théâtraux (les comédiens mêlés aux non professionnels, certaines directives de jeu et le découpage du film en actes). Le sujet de la corruption à l’intérieur des institutions mêmes qui la combattent, écrasant si possible l’individu et les convictions de celui-ci.
« Sidney nous a dit une chose, quand on s’est tous réunis, la 1re fois : « Je veux que vous soyez constamment en mouvement. Toujours actifs, en train de faire quelque chose, même de banal. » Voilà l’approche globale de Sidney. Cachons le fait qu’il s’agit d’une tragédie grecque. Inutile de les mettre en robe, tout solennels. Qu’ils soient si ancrés dans la réalité qu’on pense qu’il s’agit d’un documentaire. Mais ça n’en est pas un. » (Bob Balaban dans Prince of the City : The Real Story de Laurent Bouzereau, bonus DVD du film).
L’autre grande force de ce film baroque, mais sans ostentation, repose sur ses dialogues. Chaque dialogue est informatif et s’attaque subrepticement à l’absurdité hiérarchique qui accable des flics pourris ou repentis, et dénote du caractère impossible de prendre parti dans le débat opposant le corps juridique au corps policier. Lumet dit clairement à son spectateur : il est impossible de juger clairement. Ils ont, malheureusement, tous leurs raisons et protègent leurs intérêts, mais ont aussi leur propre morale !
À vous de juger selon ses bribes verbales toutes tirées du film :
« La loi ne connaît pas la rue »
« Vous savez pourquoi ces résultats ne sont pas des preuves admissibles (parlant d’un détecteur de mensonges). Si un type est un peu schizo et qu’il croit à ce qu’il dit, la machine n’en tient pas compte. Ou pour quelqu’un comme moi. J’aurais l’impression de mentir, même si je dis la vérité. »
« Il faut inculper, mais il y a ces lois sur la fouille, la saisie, et les écoutes. Aucune affaire n’est possible sans écoute illégale. Et on n’a pas d’inculpation sans faux témoignage commis par un flic. Que voulez-vous au juste ? Arrêter le gros dealer ? La seule façon de faire ça, c’est de lui piquer son fric. Sans quoi, il paie pour s’en tirer à bon compte. Il s’achète un prêteur sur gages, un procureur ou un juge. L’ordure de dealer est de retour dans la rue avant le flic qui l’a arrêté. La seule façon de l’arrêter, c’est de lui piquer son fric. »
« Si un homme tue une seule fois, il pensera très vite que voler n’est rien, puis il passera à la boisson, rompra le sabbat, et parviendra à l’incivilité et à la paresse. » (Thomas De Quincey cité dans Le Prince de New York).
« – Les flics ne sont pas les seuls avec un code. Les avocats et les médecins aussi.
– Oui. Aucun avocat ne risque sa vie ou son boulot pour dénoncer les escrocs de sa profession. Quel médecin a jamais dénoncé la fraude de Medicaid ? Ou les opérations inutiles ou ratées ? Ou la drogue ? Quel médecin a tout avoué ? Ciello est venu, peu importe pourquoi. Pour moi, c’est un héros, et on en est à décider de le mettre en prison ou pas. »
Les « Gardes à vue » (Le Prêteur sur gages, La Colline des hommes perdus, Le Gang Anderson, Jugez-moi coupable)
Le Prêteur sur gages (The Pawnbroker, 1964)
« Je porte le deuil de ma vie » (La Mouette d’Anton Tchekhov).
Survivant d’un camp nazi, Sol Nazerman (Rod Steiger) est prêteur sur gages dans un quartier populaire de New York. La diversité ethnique de son quartier et la bonne humeur de certains de ses habitants ne change rien au caractère aigri de cet homme enfermé dans ses souvenirs de guerre. Celle-ci l’a dépouillé de ses joies, de ses espoirs et de sa jeunesse. Arrogant, il tient sa boutique d’une main de fer avec son jeune employé, Jesus Ortiz (Jaime Sanchez) jusqu’au jour où il découvre que sa petite entreprise spécule grâce à l’argent d’une maison close.
Malgré un pathos peut-être excessif, Le Prêteur sur gages est déterminant sur la question du personnage et du lieu dans les films de Lumet. Les lieux se court-circuitent par des flash-back associatifs : le métro devient le train vers les camps de la mort et son lieu de travail, le lieu de récupération de vies brisées propre aux objets que l’on collectait des charniers de cadavres (de la dent à la chaussure). Et le personnage plaintif et perdu, entre deux temps (la Seconde Guerre Mondiale et les années 60) et deux lieux (l’Europe et les Etats-Unis), se réveille contre toute attente dès qu’il prend conscience qu’il est complice d’une société spéculant grâce à son apathie. Pour l’un (le protagoniste), on assiste lentement à son immersion dans le monde réel, et, pour l’autre (New York / Auschwitz), on assiste à une analogie audacieuse que seuls les Italiens oseront faire, pour critiquer la vie moderne qui s’industrialise sur le dos de ses citoyens, en utilisant la métaphore des camps de travail allemands sur le dos des juifs (le film Porcherie de Pasolini, en 1969, est l’exemple le plus emblématique de cette dimension critique).
« C’est ce que je voulais… être seul avec moi-même dans un autre monde où le vrai soit sans vérité et où la vie puisse se cacher d’elle-même. (…). Je me suis senti sacrément apaisé de n’être qu’un fantôme à l’intérieur d’un fantôme. (…). Qui aurait envie de voir la vie telle qu’elle est s’il pouvait faire autrement ? Trois Gorgones en une. Tu la regardes en face et tu te changes en pierre. Ou le dieu Pan. Tu le vois, tu meurs – intérieurement, je veux dire – et tu dois continuer de vivre comme un fantôme. » (Eugene O’Neill, Long voyage du jour à la nuit).
Le protagoniste souffre d’images mentales liées à la femme qu’il aimait, à leur enfant et aux camps de concentration. Ces images surviennent et le hantent de la même manière que Sean Connery dans The Offence si ce n’est que ce dernier est réactif et offensif. Il y a quelque chose de la mythologie grecque dans ce caractère tragique ou maudit d’une folie interne qui fait réagir des individus de manière imprévisible (la folie d’Ajax, la tragédie des Atrides…). Mais Lumet en profite aussi pour aborder son film comme une plainte contemplative afin de filmer New York à sa guise avec ce personnage qui erre comme s’il était perdu dans les limbes et en instance de jugement.
Sol s’aveugle volontairement avec cette famille idéale recomposée par ses rêves. Et cet aveuglement est d’autant plus frappant que la famille idéale qu’il recrée correspond à l’imagerie publicitaire américaine de cette époque qui dénature, récupère, rentabilise et dépersonnalise notre décor social. La révélation de Sol sera proportionnelle à la violence de sa remise en question.
« La solitude est la multiplication de soi-même » (Saint-Pol-Roux)
Lumet confère à ces films quelque chose de biblique sur la question de la privation, du malheur, des tentations, du sacrifice, de la pénitence, de l’isolement, des idées de jugements. Des questions individuelles et collectives (Moïse ou Abraham et le peuple hébreu), de l’allégorie sociale et morale via la culpabilité, la rédemption…
Dans The Offence et Le Prêteur sur gages, Lumet est proche de Paul Schrader sur deux points : l’intérêt de se focaliser sur un personnage solitaire qui ne fédère pas forcément notre empathie de prime abord et l’adoption de son point de vue au fur et à mesure, aussi polémique soit-il ! La vision subjective de Sol lorsqu’un voisin noir (qui n’est autre que le double inavoué de Sol) vient régulièrement et avec gentillesse lui parler de Socrate, Baudelaire et enfin d’Herbert Spencer. On ne peut s’empêcher de plaindre cet homme, le trouver même oppressant dans la solitude « obscène » qu’il représente (Taxi Driver de Scorsese et écrit par Schrader n’est pas loin d’autant plus que des effets de style liés au cadrage ou aux travellings, et l’utilisation de la musique de Quincy Jones, font également penser au premier).
« L’une des choses magiques que peuvent faire les films : vous faire vous identifier avec une personne que vous auriez jugée être peu méritante à vous ressembler . Un psychopathe, un chauffeur, un gigolo, un revendeur de drogue, un boxeur violent,…
Si vous jouez bien avec le public, que vous racontez comme il faut votre histoire, que vous séduisez le spectateur, dès le moment où il s’identifie avec ce type de personnage, alors ce dernier est vulnérable à de nouveaux sentiments, à une nouvelle conscience, permises grâce à cette délivrance d’eux-mêmes, à partir d’un moment du film. Ce n’est pas confortable et le spectateur n’aime pas cela, c’est pourquoi il faut entrouvrir juste assez cette porte, en vue d’une possible identification réussie. Bien sûr, la plupart des films font le contraire, c’est-à-dire jamais de menace au spectateur, toujours en sécurité, même s’il s’agit d’un thriller ou d’un film d’horreur. Vous ne serez jamais vraiment affecté, vous resterez la même personne à la sortie du film. (…).
J’essaye d’appliquer ce que j’appelle une vision monoculaire lorsque l’on regarde le monde que d’un seul point de vue, et à l’exclusion des autres (points de vue), parce qu’en fin de compte, pour le public, le monde est ainsi. À un moment donné, les spectateurs vont découvrir que ceci est faux et c’est de cette manière que, subitement, ils s’y trouvent impliqués. La participation du spectateur, c’est le but de tous les conteurs d’histoires et celui cinématographique consiste également à impliquer le spectateur dans ce processus. » (Entretien avec Paul Schrader, propos recueillis par Derek Wollfenden pour Le Technicien du Film, janvier 2005, n° 551)
Pour ce qui est des acteurs, Rod Steiger est souvent statique ou très lent dans ses mouvements tandis que Jaime Sanchez court partout et ne pense pas assez vite par rapport à la vitesse de ses actions comme le confirme le hold up final duquel il est complice et qui causera sa perte. Les mouvements des deux acteurs ne cessent de se contredire, mais finalement de s’entendre. L’un donne vie à l’autre par procuration non avouée de la part de Sol. Ce rapport physique entre deux personnages rappellerait presque celui entre Pacino et Cazale dans Un après-midi de chien. Lumet en vient souvent à utiliser le jeu de l’Actor’s Studio (Rod Steiger, Marlon Brando, Al Pacino, Paul Newman…) dans cette faculté de s’extérioriser ou de tout intérioriser et de jouer sur l’écoute, mais aussi sur la complémentarité des jeux, des physiques, des âges et des origines sociales (Long Day’s Journey into Night).
« – Pourquoi le traiter de créature ? Parce qu’il est noir ?
– Non, ça m’est égal ce qu’il est. J’ignore les préférences, le sectarisme. Noirs, blancs, jaunes,
ce sont tous des…
– Des quoi ?
– Des déchets.
– Vous êtes drôlement dur. Après tout, ce sont des enfants du bon Dieu.
– Tu crois en Dieu ?
– Je ne sais pas. Mais vous croyez en Dieu. Je suis prêt à le parier.
– Je ne crois pas en Dieu, ni à l’art, ni à la science… ni aux journaux, ni à la politique, ni à la philosophie.
– Mais alors, Professeur… n’existe-t-il rien… en quoi vous croyez ?
– L’argent !
– D’accord… Alors donnez-moi des leçons d’argent. » (Le Prêteur sur gages, Sidney Lumet)
La Colline des hommes perdus (The Hill, 1965)
« La loi n’a jamais rendu les hommes plus justes d’un iota ; et, à cause du respect qu’ils lui marquent, les êtres bien disposés eux-mêmes deviennent les agents de l’injustice. Le respect indu de la loi a fréquemment ce résultat naturel qu’on voit un régiment de soldats, colonel, capitaine, caporal, simples soldats, artificiers, etc., marchant en bel ordre par monts et par vaux vers la guerre, contre leur volonté, disons même contre leur sens commun et leur conscience, ce qui complique singulièrement la marche, en vérité, et engendre des palpitations. Ils ne doutent pas que l’affaire qui les occupe soit une horreur ; ils sont tous d’une disposition paisible. Or que sont-ils devenus ? Des hommes le moins du monde ? ou des petits fortins déplaçables, des magasins d’armes au service de quelque puissant sans scrupule ? » (Henry David Thoreau, La désobéissance civile).
Des soldats anglais dans un camp disciplinaire en Libye vont subir une discipline cruelle et sadique que va exacerber malgré lui Joe Roberts (Sean Connery). Ses supérieurs Bert Wilson (Harry Andrews) et Williams (Ian Hendry) le jalousent pour avoir été au front.
Le film narre donc les rapports de force entre un prisonnier et ses supérieurs militaires dans un camp de détention militaire anglais.
La règle du jeu repose sur le combat que livre un officier dégradé (pour avoir voulu défendre sa troupe contre son supérieur sur le front) pour se défendre. Contre des militaires frustrés d’être de simples gardiens de soldats perdus et sur lesquels ils exercent un quelconque et absurde pouvoir.
La hiérarchie militaire, qui anime les gardiens de ce camp, se délecte du pouvoir absurde qui en découle : un gaspillage inutile d’énergie à éprouver des soldats « perdus » et en détention pour désertion, vente illégale, désordre, vol…
Dès le début du film, Sean Connery est isolé par la caméra, à la fois détaché du groupe de prisonniers tout en y étant intégré (comme Henry Fonda dans Douze hommes en colère).
Lumet se sert de son décor naturel où le soleil de plomb renforce les ombres d’un noir et blanc déjà contrasté et accentué par les angles de caméra choisis ou les objectifs utilisés.
L’hostilité des supérieurs militaires (Harry Andrews et Ian Hendry (29)) à l’égard de Joe Roberts va démarquer celui-ci et provoquer son individualité. Réveiller ses idées subversives sur le corps militaire qu’il considère anachronique, désuet et qui appartient au règne de la reine défunte Victoria.
Pour survivre, il faut donc renforcer son rôle (exacerber son caractère) ou jouer la comédie si l’on ne peut endosser un uniforme ne nous correspondant pas. Un militaire (Ian Bannen) le démontre bien à un prisonnier fragile qui partage la cellule de Roberts et qui va en payer le prix (de sa vie).
« – Tu ne devrais pas être ici, petit. Ni dans l’armée…. On a eu un pédé, une fois.
– Je ne suis pas un pédé !
– Je sais. Mais écoute-moi donc… Cette « tante » avait trouvé le truc. Elle riait et chantait toute la journée. Et, sur la colline, elle dansait. La danse du ventre ! Mieux qu’une professionnelle ! Elle n’était pas forte, mais elle avait appris à survivre. Et c’est ça qu’il faut que tu apprennes. À survivre. » (La Colline des hommes perdus de Sidney Lumet)
La potentialité criminelle du pouvoir militaire, dès que son ennemi est absent, est de dépenser inutilement son énergie sur son propre corps social. Celui-ci s’incarnant et se déclinant habilement et de manière exemplaire pour chacun de ses prisonniers qui en constituent ses membres. Le corps sexuel pour George Stevens (Alfred Lynch), via les allusions hétérosexuelles en rapport avec sa femme ou homosexuelles à son égard, celui racial pour Jacko King (Ossie Davis), celui physiologique pour Monty Bartlett (Roy Kinnear) et Jock McGrath (Jack Watson) et celui militaire avec Joe Roberts (Sean Connery).
Tout ce qui relève du comportement humain est condamné, réprimé, dans la logique militaire dont les mécanismes répressifs rappellent ceux des nazis.
Lumet observe toute la cruauté de ses mécanismes qui trouvent leur allégorie sublime dans une simple colline, mais qui, exposée au soleil, devient le four crématoire des corps ou des idées simplement subversives ou marginales. L’armée dénature ce qui reste de l’humain et ne l’élève pas, comme le voudrait l’image de cette colline à gravir pour punir les prisonniers récalcitrants, mais les détruit. L’ouverture du film en témoigne : on ne peut rester debout sur cette colline, on s’y effondre exténué et on s’y échoue à sa racine, mort, bon pour y être enterré.
Jamais cette phrase éloquente du rebelle Joe Roberts (30) n’a été autant démentie par le film même qui le contient, ni depuis d’ailleurs : « Essayez de comprendre. Le temps de changer des hommes en jouets mécaniques est fini ! »
C’est le magnifique paradoxe du film et peut-être même de la plupart des films de Lumet : « Comment se fait-il que l’on soit à la fois conscient des injustices d’un corps social comme des préjugés liés à notre éducation, et que l’on s’obstine dans ces aberrations de sorte à pratiquer ces dernières même dans le corps juridique ? »
« Ces hommes ne se libéreront jamais ni de la prison, ni d’eux-mêmes. C’est le sujet même du film. » (Sidney Lumet, Making Movies).
Le Gang Anderson (The Anderson Tapes, 1971)
À peine sorti de prison, après dix ans d’enfermement, John « Duke » Anderson (Sean Connery) prépare déjà le cambriolage de l’immeuble de sa maîtresse. Il réunit une équipe bancale dont le professionnalisme appartient à une autre génération, comme lui, dont Tommy Haskins (Martin Balsam), The Kid (Christopher Walken), Spencer (Dick Anthony Williams) Jimmy (Paul Benjamin) ou encore Pop (Stan Gottlieb). Loin d’être assuré, le cambriolage est dès le début surveillé par le FBI…
Le Gang Anderson a été écrit par Frank Pierson (31), le même scénariste d’Un après-midi de chien. Comme ce dernier, il s’agit d’un film tragi-comique. La dimension humoristique du film n’empêche ni les vraisemblances, malgré le sujet convié, ni le fait de ne pas épargner les destins de ses personnages de cambrioleurs. Encore aujourd’hui, ce film est une réussite grâce à ce ton utilisé ; un ton décalé entre le genre utilisé (la comédie) et les réelles conséquences d’un hold-up sur quelques destins individuels. En plus de la distance constante du film causée par les services d’écoute et de surveillance du FBI. Ces derniers épient et écoutent les moindres faits et gestes des protagonistes qui ne peuvent se résigner à se ranger, ni à s’intégrer dans un monde qu’ils ne reconnaissent plus.
« – Le monde libre ! Il est tout à toi !
– Il ne me plaît pas.
– Il ne te plaît pas ? Comment ça ? Ces filles ne te disent rien ? Tu es pas si vieux.
– On dirait des putains. Au rabais.
– Quand est-ce qu’ils t’ont arrêté ?
– On m’a bouclé en 1931. J’avais descendu un flic.
– Tu as raté la Dépression, la 2ème Guerre Mondiale et la Corée. Veinard, tu as tout raté ! » (Le Gang Anderson)
Sean Connery représente un rebelle désabusé et le film épouse son sentiment. Il est à la fois cet homme compulsif attiré par le vol dans ce qu’il représente de défi « sportif » face à la loi et le praticien d’une philosophie personnelle qu’il veut constamment éprouvé et mettre à l’épreuve.
Il a à la fois la carrure rebelle d’un Serpico, mais l’audace désespérée et criminelle de Sonny dans Un Après-midi de chien.
« – Que ressentez-vous ? (…).
– De la fureur.
– Pourquoi ?
– On m’a violé 10 ans de ma vie ! C’est pas assez ?
– Vous connaissez la loi, vous avez perdu. Vous en voulez à qui ?
– À tous les salauds qui s’engraissent sur le dos des gens, légalement !
– Alors qu’à votre avis, leurs activités sont parentes des vôtres ?
– Et comment ! La publicité, c’est quoi ? De l’arnaque ! Le mariage ? De l’extorsion et de la prostitution mais officielles ! La bourse ? Une course truquée ! Un gros bonnet se fait une banque, et il a la « une » du journal. Un petit vole ce journal, et il est cuit ! » (Le Gang Anderson)
« – Quand tu voles un assuré, tu lui fais une fleur. Tu donnes du relief à sa vie, une histoire à raconter. Les gens s’intéressent à lui parce que tu l’as volé ! Tu fais une fleur à l’assurance, à cause de la publicité. Et aux flics, parce que tu prouves qu’ils sont nécessaires et méritent une augmentation. Et à toi, parce que tu as besoin de ce fric !
– Tu y crois ?
– Ce sont des conneries ! J’ai faim et je veux manger (« it’s just doggy-dog »). » (Le Gang Anderson)
« Tu joues avec la misère des autres. Quand tu voles quelqu’un légalement, sans risque, sans sortir le nez dehors, c’est immoral » (Family Business)
Ce qui a plu et plaît encore dans ce film, c’est certainement l’insistance des systèmes de surveillance qui submergent la fiction même du film et qui renvoient à toute une histoire contemporaine (Watergate) et à une toute nouvelle thématique cinématographique propre aux années 70 (32) (Conversation secrète de Coppola en 1974) et réactualisée dans la critique française par Jean-Baptiste Thoret (33).
Non seulement, ces systèmes techniques empêchent les personnages de réussir leur hold-up, mais aussi frustrent les spectateurs de l’opération « subversive » en cours.
En effet, les spectateurs sont habitués et, naturellement, fascinés par toute manifestation criminelle au cinéma, surtout lorsqu’il s’agit des préparatifs et du déroulement d’un hold-up, mais ici, le film se refuse à toute linéarité. Le film entier renvoie à sa propre conception et les scènes mêmes s’alternent avec leurs coulisses dans la mesure où l’attention des autorités sur leur moniteur et avec leur écouteur renvoie à la réception des spectateurs dans une salle de cinéma. Ceci empêche ainsi toute dramaturgie, ou la brise en permanence. Pourtant, c’est paradoxalement de cette frustration que va émerger l’adhésion du spectateur, bien qu’elle soit perpétuellement sapée, pour ces personnages qui réussissent, malgré tout et malgré la logique même du film, à se rencontrer et à s’entendre. C’est la seule chose humaine qui résiste et perdure : le lien invisible, instinctif, qui unit ces cambrioleurs perdus, égarés comme des enfants, sentiment que renforce l’inoffensivité et la tendresse de leur rapport.
L’affection que porte Sidney Lumet pour ses personnages correspond à leur statut anachronique face au « nouveau monde » auquel ils doivent s’adapter au sortir d’un pénitencier et du film qui les contient : ces cambrioleurs ont le syndrome de Jim Carrey dans The Truman Show (1998) de Peter Weir. Ils opèrent naïvement et en plein jour sous une « emprise » bureaucratique qui les observe (34).
Le Gang Anderson est un film rivalisant d’astuces filmiques qui se confondent avec celles de surveillance représentées dans le film.
« Le coup se déroulait comme prévu, mis en échec par un jeune radio-amateur paralytique. Pris d’une crainte rétrospective, les professionnels de l’écoute décidaient de tout effacer… Point final burlesque et cynique, érasion toute symbolique. En dénonçant la stupidité de ces perverses tentatives d’effraction, de divulgation et de fichage auxquelles l’affaire du Watergate allait donner plus tard un singulier écho, Lumet traçait aussi les limites de sa curiosité : au-delà de ce qui peut être consigné et répertorié dans le comportement privé et social, il reste une marge irréductible, que l’observateur le plus tenace ne peut prétendre capter. » (Olivier Eyquem, Positif, n°251, février 1982).
Le Gang Anderson est un film désabusé qui, derrière son caractère comique, devient donc vite critique dans la compilation de ce qu’il observe sur l’individu devenant une image, une valeur marchande à contrôler et évaluer coûte que coûte. C’est par sa formule populaire, dans laquelle le film s’inscrit – le hold-up rocambolesque effectué par des cambrioleurs sympathiques du Pigeon de Monicelli (Italie, 1958) à Brink’s Job de Friedkin (1978) –, qui surprend dans la mesure où Lumet va se servir de ses personnages sympathiques pour mieux les sacrifier.
« L’idée d’une seule et même misère, intérieure et extérieure, dans le monde et dans la conscience, c’était déjà l’idée du romantisme anglais, sous sa forme la plus noire, notamment chez Blake ou Coleridge : les gens n’accepteraient pas l’intolérable si les mêmes « raisons » qui le leur imposaient du dehors ne s’insinuaient en eux pour les faire adhérer du dedans. Selon Blake, il y avait là toute une organisation de la misère, dont la révolution américaine pourrait peut-être nous sauver. Mais voilà que l’Amérique au contraire allait relancer la question romantique, en lui donnant une forme encore plus radicale, encore plus urgente, encore plus technique : le règne des clichés, à l’intérieur comme à l’extérieur. Comment ne pas croire à une puissante organisation concertée, à un grand et puissant complot, qui a trouvé le moyen de faire circuler les clichés, du dehors au dedans, du dedans au dehors ? Le complot criminel, comme organisation du Pouvoir, va prendre dans le monde moderne une allure nouvelle, que le cinéma s’efforcera de suivre et de montrer. Ce n’est plus du tout, comme dans le film noir du réalisme américain, une organisation qui renverrait à un milieu distinct, à des actions assignables par lesquelles les criminels se signaleraient (bien que l’on continue à faire des films de ce type, à grand succès, comme « Le Parrain »). Il n’y a même plus de centre magique, d’où pourraient partir des actions hypnotiques se répandant partout, comme dans les deux premiers Mabuse de Lang. Il est vrai qu’on assistait à une évolution de Lang à cet égard : « Le testament du Dr Mabuse » ne passe plus par une production d’actions secrètes, mais plutôt par un monopole de la reproduction. Le pouvoir occulte se confond avec ses effets, ses supports, ses médias, ses radios, ses télévisions, ses microphones : il n’opère plus que par « la reproduction mécanique des images et des sons ».Et c’est le cinquième caractère de la nouvelle image, c’est cela qui va inspirer le cinéma américain d’après guerre. Chez Lumet (35), le complot, c’est le système d’écoute, de surveillance et d’émission du « Gang Anderson » ; « Network », aussi bien, double la ville de toutes les émissions et écoutes qu’elle ne cesse de produire, tandis que « Le prince de New-York » enregistre toute la ville sur bande magnétique. Et « Nashville » d’Altman saisit pleinement cette opération qui double la ville avec tous les clichés qu’elle produit, et dédouble les clichés eux-mêmes, au-dehors et au-dedans, clichés optiques ou sonores et clichés psychiques. » (Gilles Deleuze, Cinéma, I. L’image-mouvement, « la crise de l’image-action », p.282, 283).
Jugez-moi coupable (Find Me Guilty, 2006)
« Ce fut le plus long procès dans l’histoire des Etats-Unis. Deux ans, vingt hommes, vingt accusés, vingt-six chefs d’accusation, et un avocat pour chaque prévenu. Ce qui fait une quantité incroyable. (…). Le procès en lui-même est d’une grande fidélité. Une bonne partie du dialogue est tirée des minutes du procès, avec les vraies questions et réponses. Leur contenu est tellement choquant qu’on a presque du mal à croire que de tels échanges ont vraiment eu lieu. (…). Il était essentiel d’avoir de l’authenticité dans ce film. Le plaisir du film, ce qui vous donne ou ce qui me donne du plaisir à le regarder, ce sont toutes les extravagances qui ont vraiment eu lieu. À ce niveau, le réalisme était essentiel. » (Sidney Lumet à propos de Jugez-moi coupable)
Jack DiNorschio (Vin Diesel), un truand affilié à la Mafia, est emprisonné à la suite d’un trafic de drogue. Le FBI lui propose d’alléger sa peine en confondant tous ses partenaires et sa famille lors d’un procès. Au lieu de les dénoncer, il se défend devant la Cour, refusant le concours d’un avocat.
« C’était un dur, comme on l’est en Amérique, mais il avait un grand cœur. Il était un hors-la-loi et un opprimé, prêt à s’attaquer au FBI, aux autres parrains et même à sa propre famille. Il était prêt à défendre les choses auxquelles il croyait. En son âme et conscience, il pensait bien agir. » (T.J. Mancini, producteur et co-scénariste de Jugez-moi coupable)
Comme avec L’Avocat du diable (1993), Lumet expérimente la critique satirique au détriment de tout « vérisme » ou « naturalisme » prétendu dans ses dialogues (inspirés de ceux réels du procès qui eut vraiment lieu). L’énormité de son postulat (qui est donc pourtant réel) lui permet de passer au crible la justice américaine, mais en lui renvoyant cette fois-ci une image grossière relevant de la farce.
« Cet abruti transforme ce procès en vaudeville. » (Jugez-moi coupable de Sidney Lumet).
Lumet observe comment la justice s’articule sur l’image du paraître à préserver pour mieux convaincre. Le jury devient l’Hydre de l’Erne que doit combattre Hercule et qu’interprète ici, et à contre-emploi, le corps massif de Vien Diesel. Et le plus drôle et le plus fou, c’est qu’il le (con)vainc ! Lumet encore une fois, (dé)montre comment un homme va dérégler toute une organisation juridique qui repose finalement sur un dispositif spectaculaire. Mais le film cache un certain cynisme. Dans le devenir de son protagoniste condamné à perpétuité et qui finit foncièrement seul (malgré sa philosophie personnelle et ses principes qu’il a défendu jusqu’au bout). Et dans la continuelle mise en abîme du Jury dont les membres ne sont autres que les spectateurs de la salle de cinéma (encore !) que le héros (et le cinéaste) s’épuise à convaincre.
Et je pense même que ces spectateurs sont plus particulièrement ceux des « previews » dont la logique mercantile orchestrée par les Studios est absurde : elle escamote bêtement les films par le dictat du bon goût. La facture de Jugez-moi coupable (le numérique évoque un univers préfabriqué et un sentiment d’urgence, la chanson de Louis Prima au rythme nerveux devient infernale et obsédante), le choix et la prestation « rentre dedans » géniale de son acteur Vin Diesel, concourent à transformer le film en son contraire : inverser les dispositifs habituels du cinéma de son auteur et à le coder volontairement avec des stéréotypes poussés à outrance jusqu’au malaise.
« Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. » (Guy Debord, La Société du Spectacle).
Le film adapte littéralement cette citation de Lord Acton, interne au film d’ailleurs, « Tout pouvoir amène la corruption, le pouvoir absolu amène une corruption absolue », dans la mesure où son réalisateur corrompt plus que jamais son propre film. Lumet nous rend complice de ce génial sabotage grâce au genre convié, la comédie, et le corpulent Vien Diesel faisant volontairement écran aux préoccupations critiques de son auteur afin de mieux faire passer la pillule.
« En latin, le terme « complot » signifie « respirer ensemble ». » (Jugez-moi coupable)
« Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon » (Le Verdict, Contre Enquête, L’Avocat du diable)
Le Verdict (The Verdict, 1982)
« Les faibles ont besoin de quelqu’un pour les défendre. C’est pas la vérité ? (…). C’est pour ça que le Tribunal existe. Pas pour rendre la justice. Il est là pour leur donner un sentiment de justice. (…). Un jury, ça veut croire. En son âme et conscience. » (Paul Newman dans Le Verdict)
Frank Galvin (Paul Newman), avocat déchu et alcoolique, tient l’occasion de refaire surface avec une affaire de négligence médicale.
Le Verdict, dans sa structure et avec son personnage, est très imprégné de la Bible dans l’épreuve difficile que doit traverser celui-ci pour retrouver la paix avec lui-même. Il est étouffé par les institutions autoritaires que sont l’Église et un hôpital qui lui est affilié, mais aussi la Cour. Le procès l’opposera à l’avocat Ed Concannon (James Mason) et au juge Hoyle (Milo O’Shea) qui n’est pas consciencieux et que cette histoire dérange. Concannon n’hésitant pas à procéder par « vices de forme » pour gagner le procès. En effet, Galvin entamera une relation affective avec une femme, Laura Fischer (Charlotte Rampling), qui se trouve être soudoyée par ce avocat, mais qui est également son double affectif comme dépressif (elle veut aussi refaire surface sur la scène juridique). À mesure que l’un sort de l’alcool et retrouve sa vocation, l’autre s’engouffre dans la corruption, rendant caduque, et malgré elle, une relation qui lui tenait pourtant à cœur.
« Tout est prédestiné, mais on a toujours la liberté de choix, et souvent on fait le mauvais choix » (Ariel à Emily dans Une étrangère parmi nous de Sidney Lumet)
Lumet, comme pour Network ou Le Prince de New York, ne fait pas le même film du début à la fin. Il procède par dérèglement ou contamination. Des personnages au jeu de ses acteurs (Un après midi de chien), du cadre (Douze hommes en colère, Point Limite) à la lumière (36) (Le Prince de New York, Daniel).
Ses meilleurs films relèvent donc de cette méthode particulière de refuser à chacun d’eux un statut formel fixe, et cela lui est permis, soit par un parti pris dans la lumière (Le Prince de New York et le travail de Andrzej Bartkowiak avec l’image qui se contraste et le cadre de l’image qui se resserre de plus en plus sur ses acteurs), soit par le jeu même de ses comédiens. Paul Newman n’hésite pas à cabotiner pour jouer l’avocat déchu et alcoolique afin de renforcer le moment où il a une révélation avec l’affaire que son ami (37) lui a confié. Lumet intervertit même dans sa dernière séquence (38) les fonctions initiales du protagoniste et sa compagne furtive. Elle boit allongée et appelle désespérément par téléphone Frank Galvin pour prolonger leur histoire affective.
David Mamet (le scénariste du film) et Sidney Lumet sont complices pour rendre crédible cette histoire de réhabilitation (39), mais ne sont pas dupes quant à la nature de leur protagoniste qui, malgré son attitude rebelle dans la profession, son parcours atypique (il a failli être radié) et cette affaire criminelle expiatoire, n’est pas exempte des travers habituels de sa profession. En effet, il refuse l’argent que l’Église lui offre pour éviter le procès et assurer à la famille de la victime de l’argent pour subvenir à leurs besoins. Galvin refuse et ne tient pas au courant la famille de la victime de cette décision, trahissant, malgré sa conscience professionnelle retrouvée, son égoïsme et une certaine arrogance.
« Vous êtes bien tous les mêmes. Les médecins ou vous (les avocats), c’est toujours : « Ce que je vais faire pour vous ». Et puis, vous déconnez, et ça devient : « Mais nous avons fait de notre mieux. Tous nos regrets ». Et les gens comme nous souffrent toute leur vie de vos erreurs. » (Le Verdict de Sidney lumet)
En dépit des professions et institutions qui font autorité, les hommes, qui les incarnent, ne peuvent le faire parfaitement à moins de créer des monstres, des « jouets mécaniques » (les militaires de La Colline des hommes perdus) ou des « anges déchus ». C’est pourquoi le couple Lumet/Mamet s’attaque aux fonctions juridiques et hospitalières dont l’ego est le principal mal qui gangrène cette profession. Lumet va là aussi, s’amuser à intervertir leurs fonctions. L’avocat soigne et le docteur souffre !
Le film hérite de l’utilisation narrative et critique des apparats sociaux qui distinguent les professions entre elles, mais que viennent dérégler les individus marginaux ou rebelles qui s’y dissimulent et injectent la confusion des genres jusqu’à détourner les fonctions sociales de leur objectif : la société ne peut donc se définir que sur une pyramide de faux-semblants !
Dans Caught (1949) de Max Ophuls, le docteur, qu’interprète James Mason, soigne l’héroïne, victime des affres du capitalisme (dans ses croyances, ses mœurs), mieux que ses propres patients. Il soigne mieux les maladies sociologiques et morales que celles physiologiques ! L’avocat de The Verdict devient ainsi docteur dans la mesure où cette affaire dépasse son statut privé à en croire son allocution adressé au jury au début du procès et à sa fin :
« Le plus souvent, nous sommes égarés. Nous disons : « Mon Dieu, dis-nous ce qui est juste. Ce qui est vrai. » Or, il n’y a pas de justice. Les riches gagnent, les pauvres sont impuissants. À la longue, nous nous fatiguons d’entendre les gens mentir. Et, bientôt, nous mourons. Nous mourons un peu. Nous nous considérons comme des victimes. Et nous devenons des victimes. Nous devenons… Nous devenons faibles. Nous doutons de nous-mêmes, nous doutons de notre foi. Nous doutons de nos institutions. Et nous doutons de la loi. Mais aujourd’hui, vous êtes la loi. C’est… vous… la loi. Vous, et non un code. Non les avocats. Et non la statue de marbre ou l’apparat de la cour. Car tout ceci n’est que symbole de notre soif de justice. Mais c’est aussi, en fait, une prière. Fervente, craintive, mais une prière. Dans ma religion, on dit : « Agis comme si tu avais la foi, et la foi te sera donnée. » Si… Si nous devons avoir foi dans la justice, nous n’avons qu’à croire en nous-mêmes et agir en toute justice. Et je crois que la justice est dans nos cœurs. » (Paul Newman dans Le Verdict).
Le procès est pour Sidney Lumet une parfaite mise en abîme du jeu théâtral (40) : la bonne image à préserver devant le jury (41) pour convaincre chacun des membres. Les avocats emportés dans leur rôle font office d’orateurs ou de prêcheurs. Et leur monologue qui doit être décisif non seulement pour la Cour, mais aussi pour le spectateur qui évalue la vedette du film comme sa performance.
« J’ai beaucoup travaillé avec lui quand il faisait de la télé. Il a appris son métier à la télévision, avec brio. À l’époque de l’âge d’or de la télévision américaine. Il a appris sa technique en faisant du direct, c’est-à-dire qu’il répète jusqu’aux moindres détails. » (James Mason à propos de Sidney Lumet dans une featurette DVD du Verdict).
Contre Enquête (Q & A, 1990)
« There is a time to live
And a time to die
A time to tell the truth
A time to lie » (refrain de la chanson-titre dans Contre-enquête).
Un jeune vice-procureur, Aloysius « Al » Francis Reilly (Timothy Hutton), est chargé d’une affaire criminelle qui compromet un policier adulé et respecté par ses collègues de travail, l’Inspecteur de police Michael Brennan (Nick Nolte). Mais l’enquête se corse quand son témoin principal, le mafieux influant portoricain Roberto « Bobby Tex » Texador (Armand Assante), s’avère être le mari de son ex-copine, Nancy (Jenny Lumet).
Contre Enquête s’inscrit dans la tradition thématique de certains films de cette époque : il partage une construction narrative similaire, à savoir un jeune personnage menacé par son double paternel, mais aussi un jeune acteur faisant valoir un acteur plus vieux ou (et) expérimenté.
En effet, le film est contemporain de The Hitcher (Robert Harmon, 1986), Outrages (Brian De Palma, 1989) et sera suivi plus tard par City Hall (Harold Becker, 1996), mais aussi d’un acteur spécialisé dans ce type de rôle où le personnage est témoin d’un autre, voire vampirisé par celui-ci. Cet emploi échoua souvent à Charlie Sheen (Platoon, en 1986, et Wall Street, en 1987, d’Oliver Stone, La Relève d’Eastwood en 1990).
Contre Enquête narre donc, dans un premier temps, un jeune homme qui doit s’occuper de sa première affaire criminelle en tant que vice-procureur. Parallèlement à son enquête, il va devoir se construire professionnellement et affectivement, surtout quand il rencontre son présumé coupable et principal témoin, Mike Brennan. Celui-ci n’est autre que le « grand méchant loup » personnifié, c’est-à-dire le fantôme paternel qui renvoie à sa culpabilité professionnelle (son père était flic et derrière sa légende se cachait un homme corrompu, ce qui remet en cause les modèles de la justice américaine et de son histoire) et à celle affective et raciale qui en découlera (son ex-copine s’est séparée de lui à la suite de son regard ambigu à l’encontre du père de couleur de celle-ci).
Mike Brennan est donc ce « grand méchant loup » castrateur qui hantera constamment le jeune vice-procureur, mais représentera aussi l’épreuve idéale du père spirituel à tuer pour mieux grandir.
« – À mon avis, il va nous falloir le tuer.
– T’es un flic. Ton boulot est de parler d’abord.
– Mec, mon boulot est de rentrer chez moi, chez ma femme et mes gosses. »
Lumet ne se contente pas de rester sur la seule idée de faire de son jeune protagoniste le simple faire-valoir d’un autre. Il le complexifie grâce à l’enquête qu’il mène et qui fusionne avec une histoire sentimentale, l’isolant dans les services de police vu qu’il s’attaque à un flic respecté et adulé. Il est du côté, malgré lui et à cause de son sens de la justice et du droit, de ce mafioso portoricain qui sort maintenant avec son ex-copine dont il est toujours amoureux.
C’est le dilemme passionnant du film non dénué de romantisme dans la mesure où les deux hommes que tout oppose font équipe pour « tuer le père » : Mike Brennan est un père fouettard raciste et homophobe, il est également le refoulé d’une certaine Amérique. Autrement dit, tuer les frontières raciales et professionnelles les opposent ainsi que des délimitations juridiques et légales. Abandonner en somme leurs préjugés, des plus simples au plus sophistiqués malgré qu’ils soient rivaux de la même fille.
« À l’exigence éthique [des protagonistes de Lumet à l’« honnêteté presque coupable »] s’oppose leur appartenance ethnique, la solidarité tribale et clanique, la tentation raciste (Timothy Hutton dans Q & A), une espèce de loi du sang qui empoisonne les relations et brouille le jugement, un déterminisme généalogique qui commence avec la responsabilité de pères longtemps admirés et soudain défaillants (Q & A, Night Falls on Manhattan). » (Programme de la Cinémathèque française, septembre-novembre 2007, Visages de Christs en pleurs de Bernard Benoliel et Jean-François Rauger, article écrit à l’occasion de l’hommage au réalisateur)
Plus que jamais, Lumet va décliner ce dilemme et exploiter au maximum les conflits internes et externes de ses personnages qui en résultent, tous animés par le « démon du père » (celui génétique comme celui institutionnel) que représente Mike Brennan, l’incarnation la plus parfaite de l’esprit conservateur, répressif et rétrograde américain dont les valeurs préservées sont pourtant corrompues par les préjugés raciaux et des lois vétustes.
« Tandis que Al se tourmente au sujet de la possibilité de son propre racisme, Lumet soumet aux spectateurs la distribution peut-être la plus ethniquement variée de l’histoire du cinéma. Des mafieux italiens traitent avec des dealers portoricains, qui ont eux-mêmes affaire à des Noirs, des Hispaniques, des Irlandais et des policiers juifs, et toutes ces associations finissent par déléguer à deux personnages ethniquement peu communs : Alfonso et Armand Segal, des assassins juifs cubains. Pour un mafieux italien, ça signifie « pas de coup le samedi » ; pour l’officier de police hispanique, ça signifie que ce sont des « cousins cubains ». Toutefois, les intrigants frères Segal restent des personnages secondaires. Encore plus osé : Lumet ne se contente pas de se concentrer sur l’Autre ethnique, mais aussi sur l’Autres sexuel, à travers un aperçu du travestissement et de l’homosexualité. » (American-Jewish filmakers : Traditions and Trends, « Sidney Lumet : The Memory of Guilt », David Desser and Lester D. Friedman, Chicago, University of Illinois Press, 1993)
Mike Brennan se joue des minorités sociales ou sexuelles et de leurs origines qui s’isolent et se rejettent respectivement (les travestis, les noirs, les flics, les portoricains, les italiens, les irlandais, les juifs, les chrétiens,…). Il va émoustiller chaque camp et profiter de leur méfiance liée à leurs préjugés raciaux (déterminés de génération en génération) pour avoir les informations suffisantes pour retrouver et tuer les témoins gênants.
Nick Nolte devient ainsi l’anti-héros dérivé de celui subversif créé par Kurosawa et incarné par Toshiro Mifune pour Yojimbo (1961). L’acteur américain détourne cet anti-héros positif en se servant de sa méthode (pousser les minorités les unes contre les autres), réveillant ainsi le racisme déclaré, latent ou refoulé propre à chaque individu comme à chaque communauté. Mike Brennan est l’instrument critique de son auteur lui permettant de constater les maux de sa société. Homosexuel refoulé, Mike Brennan s’en prend à tous les personnages du film, indics, dealers, mafieux, tueurs, policiers, travestis à qui il met la pression (42) pour qu’ils paniquent et les provoquer à l’erreur. Grâce à lui, Lumet constate, par exemple, que chaque minorité croit se cacher (son sexe, sa couleur, son identité) derrière une fonction sociale et professionnelle faussement fédératrice alors que celle-ci crée d’autres délimitations, d’autres frontières, et ceci du policier au dealer, de l’indic au travesti.
« – (Al) Il faut avouer que Brennan et toi, vous n’êtes pas une combinaison naturelle.
– (Chappie) Ouais, pourquoi pas ?
– (A.) Mon Dieu, je veux dire chaque mot qui lui sort de la bouche. Tu devrais savoir mieux que quiconque.
– (C.) Où est le problème. C’est son style. Au moins avec lui, c’est déclaré.
– (A.) Mais comment tu supportes ça ?
– (C.) Je te l’ai dit, pas de problème. Lui, c’est lui. Moi, c’est moi.
– (A.) Et pour ce qui est des autres ?
– (C.) Quels autres ?
– (A.) Ceux qui ne sont pas aussi manifestes ?
– (C.) Au diable ! Eux c’est eux. Je suis moi.
– (A.) Tu peux les repérer ? Comment ?
– (C.) Eh bien, tu vois, ils posent des tas de questions stupides comme par exemple, comment c’est d’être un flic noir. Des conneries comme ça. C’est tout ?
– (A.) Oui, Chappie.
– (C.) Écoute, Al, tu n’es pas un mauvais gars. Il faut que tu saches quelque chose sur moi. Tu sais de quelle couleur je suis ? Du dedans comme du dehors ? Je suis bleu. Et quand j’étais dans les marines, j’étais vert olive ou treillis ou bleu parade ou quelle que soit la foutue couleur de l’uniforme du jour. Tu comprends ?
– (A.) Je comprends. » (Contre Enquête de Sidney Lumet)
Ce dialogue démontre clairement combien un policier noir (Chappie) se leurre avec son uniforme et ce qu’il représente. En même temps, il traduit une confession du héros (Al) au flic noir Chappie qu’il a substitué ici au père de la fille qu’il aime, de la même manière que Nick Nolte s’est substitué à son père, c’est-à-dire à l’image pas si propre que ça d’un policier pas si probe non plus.
L’issue du film délègue l’enquête policière aux hautes sphères de la justice et montre que Mike Brennan était instrumentalisé par un autre personnage, Kevin Quinn (Patrick O’Neal), le Chef de la Brigade criminelle du Comté de New York, celui-là même qui a confié l’enquête au jeune héros. Bref, toute l’enquête policière s’annule pour revenir au point de départ et le film se boucle presque comme s’il n’avait pas eu lieu laissant toutefois une brèche dans laquelle Al renouvelle sa demande auprès de Nancy, tous deux sur la plage,
Le film se clôt avant qu’elle ne puisse répondre, protégeant leur liaison du reste du film corrompu.
L’Avocat du diable (Guilty as Sin, 1993)
Jennifer Haines (Rebecca De Mornay), une belle et brillante avocate, se fait persuadé par David Greenhill (Don Johnson) de prendre sa défense. Ce dernier, play-boy charmeur et joueur, est accusé d’avoir précipité dans le vide sa richissime épouse. Mais David Greenhill ne tarde pas à manifester sa culpabilité auprès d’elle dès qu’elle décide de se charger de son cas. Jusqu’où pourra-t-elle appliquer le droit de réserve pour arrêter son dangereux client ?
Lumey décline son œuvre dans le scénario habile de Larry Cohen, spécialiste de génie de la série B dont les scénarios improbables sont menés avec tant de brio et d’humour qu’ils en deviennent vraisemblables ! Cohen ici permet à Lumet de se confronter directement au maître hitchcockien par sa structure même et les dénouements qui en émanent. Et d’aborder des sujets contemporains avec beaucoup plus d’humour et de légèreté qu’il n’avait auparavant pu le faire.
Les trois grandes instances critiques du film liées à la vie contemporaine américaine sont la vie de couple, la transformation médiatique des affaires criminelles traitées par la Cour en spectacles tous publics (43) et enfin les symptômes similaires entre le client et son avocat et le pêcheur avec son pasteur dans le confessionnal attestant de la confusion des valeurs et de leur facticité.
« – Y a rien à faire, c’est du boulot !
– Un couple aussi, c’est du boulot ! »
L’allégorie du couple persiste tout le long du film et les deux hommes, que sont le mari de l’avocate et son nouveau client, ne sont finalement qu’une seule et même personne. Don Johnson étant le fantôme subversif de l’autre ne servant qu’à dénoncer, non sans ludisme, les limites de la loi par l’entremise de notre vie sexuelle dont les ressemblances (ou les symptômes) sont nombreuses : domination et soumission s’intervertissent continuellement, et à volonté, de la fonction sociale professionnelle (avocate/gigolo) à celle sexuelle (mâle/femelle).
« Tuer avec des gants ce serait comme baiser avec une capote ».
Mais l’esprit génial et subversif de Larry Cohen ne s’arrête pas là puisqu’il confère un rapport sacré, religieux entre les deux parties. Non seulement cette relation est incestueuse – entre l’avocate arriviste et prête à tout pour gagner une affaire et un gigolo dont la dimension allégorique et fantastique sert également de projecteur pour dénoncer les travers moraux et légaux de la première –, mais aussi est elle ironiquement sacrilège. Le film va s’amuser avec les termes légaux du secret professionnel de l’avocat à ne pas dévoiler ce que pourrait lui dire son client : ce secret professionnel ressemble également à celui du psychiatre et de son patient comme, je viens de l’évoquer à l’instant, du pasteur et de son pénitent.
« – Vous savez ce qui est le plus embêtant quand on commet des crimes parfaits ?
– C’est quoi ?
– On ne peut en parler à personne. »
La fin du film pousse à son comble ô combien notre héroïne a des pratiques douteuses pour se débarrasser de son client diabolique : elle crée de fausses preuves pour le confondre en justice (44).
Enfin, le dernier point du film est le rapport médiatique que la loi entretient avec ses affaires criminelles. Cet argument critique, déjà développé dans des films comme Un après-midi de chien et Network, justifie la mise en scène hitchcockienne de Lumet qui livre ici un véritable exercice de style et une utilisation musicale bien loin de ses partis pris formels habituels pour retranscrire au mieux un sentiment du réel. Ici, pas de musique économe (au contraire, elle est bien présente et monumentale ; elle est signée Howard Shore), ni de sujet vraisemblable. Les personnages n’ont d’autre psychologie que la stature de leur fonction sociale et sexuelle et le cliché cinématographique qu’ils endossent tous deux et qu’ils poursuivent depuis les années 40 (L’Ombre d’un doute et Soupçons d’Hitchcock, House by the river et Le Secret derrière la porte de Lang, Hantise de Cukor…). On est bien dans un film et Lumet fait tout pour le souligner, se servant sans modération des codes formels et narratifs du maître hitchcockien qui a fait école depuis, à Hollywood.
Le « Gouffre aux chimères » ; Artifices hallucinogènes (Point Limite, Un après-midi de chien, Network, Piège mortel, À la recherche de Garbo, Power)
« Et sans doute notre temps… préfère l’image à la chose, la copie à l’original, la représentation à la réalité, l’apparence à l’être… Ce qui est sacré pour lui, ce n’est que l’illusion, mais ce qui est profane, c’est la vérité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à mesure que décroît la vérité et que l’illusion croît, si bien que le comble de l’illusion est aussi pour lui le comble du sacré. » (Feuerbach, préface à la deuxième édition de L’Essence du christianisme, cité par Guy Debord en exergue de son premier chapitre de La Société du Spectacle, « La séparation achevée »)
Lumet assume pleinement le caractère artificiel du cinéma et n’évite pas les sujets extrêmes ou les angles contrastés pour appuyer de temps à autre l’exemplarité de son propos au risque même d’être grossier dans son discours. Mais le caractère génialement « baroque » de cette dimension formelle ne vous rappelle-t-elle pas un film (Citizen Kane) ou un cinéaste (Robert Aldrich) ?
« Nous sommes entrés à l’époque des hommes doubles » (Pierrot le fou de Jean-Luc Godard)
Point Limite (Fail-Safe, 1964)
« À la suite d’une erreur, des bombardiers américains portant des charges atomiques sont lancés sur Moscou, sans retour possible. Pour éviter une guerre mondiale, le Président des Etats-Unis détruit lui-même New York. » (Dictionnaire des films, sous la direction de Bernard Rapp et Jean-Claude Lamy, Larousse, 1991).
Chez Lumet, les espaces sont souvent cauchemardesques parce que les existences s’y jouent. Les lieux changent et s’interchangent selon les individualités, selon les « acteurs » des classes sociales. Pour l’un, ce sera un tribunal, pour l’autre ce sera une banque, et ainsi de suite.
Comme dans La Mouette de Tchekhov (45), les personnages auront beau avoir une existence en apparence pleine de voyages (Nina), d’événements (Arkadina), d’expériences, ils sont condamnés à certains lieux qui stigmatisent leurs créations ou frustrations, ou élans affectifs déterminants pour le reste de leur vie.
Lumet conçoit le lieu comme un espace duquel on ne peut échapper. Même si les personnages en sortent et en reviennent, ils appartiennent d’une manière ou d’une autre à ce lieu. Celui-ci est décisif pour leur existence ou fonctionnel et routinier dans la vie sociale et professionnelle du protagoniste. Le cinéma de Lumet va se déployer à partir de cette instance non pas critique, mais profondément mélancolique et fataliste.
Point Limite fusionne bien l’appartenance individuelle et affective des êtres pour des lieux. Lumet va même confiner son histoire dans quatre espaces seulement qui ne vont cesser de se faire écho : le Quartier Général du S.A.C., le bombardier, la salle de guerre au Pentagone et la pièce d’où le Président va joindre son homologue russe pour anticiper sur l’urgence de la situation. Selon chaque individu, les lieux sont familiers et quotidiens pour les uns (les membres de la salle de guerre au Pentagone et le Quartier Général du S.A.C.) et événementiels pour d’autres (le Président, le traducteur, le bombardier)
Point Limite articule également les enjeux moraux qui découlent des politiques belliqueuses. Les conséquences tragiques du film sont permises grâce à son caractère allégorique que renforce la dynamique théâtrale convié par le huis clos. La dimension conceptuelle qui en découle est proprement fantastique parce qu’elle épouse le sentiment humain du spectateur à vouloir s’en extirper.
Les « gros » ressorts dramatiques (narratifs et formels) sont donc justifiés dans la mesure où ils expriment parfaitement l’angoisse du spectateur, sa panique. Point Limite rejoint Douze hommes en colère et La Colline des hommes perdus, ou encore La Quatrième Dimension (1959-1964), série télévisée contemporaine crée par Rod Sterling.
Comme pour Douze hommes en colère, Lumet joue aussi sur sa vedette qui lui permet ce parti pris.
« Tous les Américains auraient élu Henry Fonda président s’il avait décidé de se présenter. » (Sidney Lumet, Revisiting Fail-Safe, 2000)
Fonda joua pour John Ford l’ancien Président des Etats-Unis Abraham Lincoln, Vers sa destinée (Young Mr. Lincoln, 1939), mais aussi des figures politiques emblématiques comme dans Advise and Consent (1962) de Otto Preminger où il interprétait un candidat pour être secrétaire d’État. L’imaginaire collectif le rattache donc souvent à des rôles de poste social très important, du cow-boy au shérif, du citoyen au gouvernement.
Lumet, lorsqu’il utilise Fonda, sait pertinemment que le personnage à une telle fonction est déjà acquis par le spectateur. C’est la carrière de l’acteur et l’imaginaire du spectateur plus ou moins relié, et en accord avec celle-ci, qui finalement font le casting !
« Il ne faut pas nous attacher aux principes vétustes du passé quand ces principes sont un obstacle à une action en faveur de la paix. (…). Le passé ne doit pas paralyser nos efforts vers l’équilibre mondial. (…). Négocier votre survivance sous l’empire de la fierté est dangereux. » (Henry Fonda dans Advise and Consent).
Lumet affectionne quand ses protagonistes ont des principes ou qu’ils défendent une certaine idée de la morale. La culpabilité est nécessaire pour ceux qui la ressentent parce qu’elle leur révèle leur statut d’incarcéré, avec leur corps et leur façon de penser que son éducation entachée de préjugés lui a inculqué.
« Cette tête de cheval, c’est aussi la mienne. Mes rênes sont le langage et les principes usés. » (Equus de Sidney Lumet)
Lumet aime les tensions, les conflits pour ses raisons-là car ils lui permettent de dégager les dynamiques « scandaleuses » qui notifient la condition de l’homme en société.
On a souvent associer Lumet à un prêcheur, à un bonimenteur de bonne morale, et j’en passe, et sa manière de filmer a souvent été « taxé » de télévisuel, de théâtral… C’est n’avoir rien compris à un cinéaste qui n’a cessé de travailler sur la béance sociale entre un individu à l’intérieur de son propre espace mental déjà « corrompu » par son éducation et son milieu social.
Ses films posent ainsi souvent la question suivante : quels sont les instruments cognitifs et psychiques en sa possession, suffisants pour cohabiter du mieux qu’il peut avec son environnement social et politique. Où y a-t-il du « prêchi prêcha » dans l’observation émise ici ?
« Cette machine inexorable est en marche et ne va pas s’arrêter. (…). Les sentiments et les idées des gens deviennent relativement insignifiants, une fois le mécanisme en marche. » (Sidney Lumet, Revisiting Fail-Safe, 2000)
Le théâtre lui sert d’ailleurs non pas à figer une mise en scène dans un lieu donné, mais à substituer l’espace réel à celui, sous tension, de la scène où les espaces entre les corps s’en ressentent. Il adapte au cinéma, la pesanteur existentielle et claustrophobe que peut dégager le théâtre dans ces drames à la gradation tragique (Long Day’s Journey Into Night).
Des paradoxes s’affineront chez lui comme celui qui distingue des démonstrations allégoriques et exemplaires de ses idéaux politiques (Douze hommes en colère, Point Limite, La Colline des hommes perdus) et les adaptations des faits-divers pour l’écran auxquels il confronte une mise en scène qu’il va éprouver et épuiser par l’intermédiaire de ses acteurs afin que le film traduise le mieux possible les faits déroulés (Un après-midi de chien, Le Prince de la ville, Network, Jugez-moi coupable).
Point limite bénéficie, grâce à ses contraintes techniques ou économiques (46), d’une facture très stylisée comme en témoigne l’ouverture du film où le Général Warren A. Black (Dan O’Herlihy) fait un cauchemar. Dans celui-ci, on voit un taureau dont la texture noire et opaque de la peau se découpe du reste de l’image (où l’on ne distingue plus très bien le toréador) comme un trou noir béant. Lui aussi, le Général Black, spectateur dont les contours de la tête s’opposent au reste de l’image. Cette scène de rêve annonce l’idée graduelle du film qui, dans ses éclairages ou ses angles, va s’atrophier pour se relier finalement à ce rêve par le largage de la bombe atomique (le rêveur / spectateur du spectacle de tauromachie est celui qui lâche la bombe sur New York sous les ordres de son Président).
Le montage de ce cauchemar, et surtout celui qui suggère l’impact de la bombe atomique sur New York (47), ont certainement été influencé par l’environnement à vif de la Guerre froide, ses slogans et ses publicités liés à la crise des missiles à Cuba en 1962 ou à la candidature de Johnson (48) pour la présidence en 1964, et annonce des films comme Now (1965) de Santiago Alvarez.
« La période maccarthyste était un complément de la Guerre froide. J’écrivais pour la télévision, et la liste noire est apparue. J’ai donc été mis sur la liste de 1950 à 1958. » (le scénariste du film Walter Bernstein, Revisiting Fail-Safe, 2000)
« Un scénariste sur liste noire ne pouvait écrire que sous un pseudonyme. À condition qu’il trouve un producteur prêt à coopérer. » (Sidney Lumet, Revisiting Fail-Safe, 2000)
Un après-midi de chien (Dog Day Afternoon, 1975)
« Dans ce film, Sonny et Sal (Al Pacino et John Cazale), deux malfrats incompétents en quête du rêve américain, s’attaquent à une banque de Brooklyn en plein jour. Mais devant leur maladresse, les otages les prennent en sympathie et finissent même par les aider, tandis qu’à l’extérieur une foule de badauds se presse et soutient leur action. Au milieu du film, celle-ci reprend en cœur le cri lancé par Al Pacino, « Attica ! Attica ! », en référence aux insurgés de la prison du même nom et la prise d’assaut sanglante de l’enceinte par les forces de police le 13 septembre 1971, qui s’acheva par des dizaines de morts et l’assassinat de George Jackson, l’un des leaders des Black Panthers auquel Bob Dylan dédiera d’ailleurs une chanson. Pour Pacino, c’est bien sûr une manière de rappeler ce massacre d’État, et de dire combien la transgression active de la Loi s’apparente parfois à une forme de contestation politique de l’ordre établi. Mais elle traduit aussi un besoin de rattacher son action à des événements antérieurs, à des modèles (ici, de révolte) voire des stéréotypes – sans lesquels ils n’auraient sans doute jamais attaqué cette banque – afin qu’ils prennent en charge une réalité qu’ils ne maîtrisent plus. » (Jean-Baptiste Thoret, Le Cinéma américain des années 70).
Le film poursuit habilement dans son sujet ce que le scénariste Frank Pierson avait instinctivement ressenti avec Le Gang Anderson. Les Médias n’y étaient qu’à leurs prémices et l’information était encore plus ou moins confidentielle. Mais les braqueurs sont presque les mêmes d’un film à l’autre (il s’agit du même scénariste), ce sont les « bouffons de la farce ».
Pour Le Gang Anderson, Sean Connery interprétait un meneur d’hommes grâce à son charisme « bondien », mais finalement « ineffectif », qui cambriole plus par simple réflexe ou épreuve sportive défiant toute forme d’autorité que par nécessité ou motivation précise. Son acte est profondément subversif, volontairement immature, irresponsable et appartient consciemment, de la part du réalisateur, à ces gangsters attachants du cinéma des années 50 et 60 qui s’en tiraient toujours ! Lumet traita la violence de son sujet en mettant bien en parallèle la technicité professionnelle des uns (le FBI) et la naïveté humaine des autres (les gangsters) et dégagea le caractère anachronique (et injuste pour les cambrioleurs) de l’entreprise.
Dans Un après-midi de chien, le gangster a subi une réalité sociale donnée (la guerre du Vietnam, le chômage…) en même temps qu’a grandi en lui le besoin de s’affirmer, via ce hold-up dont l’alibi est de pouvoir enfin payer une opération clinique de changement de sexe à l’homme qu’il aime (Chris Sarandon). Pacino interprète un gangster amateur (ce qui n’est pas le cas pour Connery qui s’est juste trompé de décennie) dont c’est le premier acte criminel semble-t-il.
Mais au lieu d’exceller dans le banditisme (49), il va exceller dans le spectacle (50) et en prendra conscience. Il sauvera sa vie contrairement à Sal et utilisera la caméra comme garant de sa vie, bien plus que les otages finalement. Plus il se montre, plus il devient intouchable, une véritable image en somme.
« Au fur et à mesure de la journée, il devient de plus en plus hardi. D’une certaine manière, ils l’apprécient de plus en plus. Pour dramatiser ce point, j’ai introduit la scène où Marcia Jean Kurtz, l’une des caissières, tient son fusil, et il lui montre comment on salue dans l’armée. Ça démontre à quel point il est devenu inoffensif. Mais en devenant inoffensif, il peut les manipuler davantage. La même chose commence à se produire à l’extérieur. Une fois que les flics arrivent sur place, il y a une source de connexion entre lui et les passants. Elle grandit de plus en plus et il les manipule de plus en plus, tout en les amusant. » (Sidney Lumet, making of du film)
Un après-midi de chien est l’un des films qui se prête selon moi le moins à l’analyse universitaire sur le plan formel (51). Le film est dévoué au travail d’acteurs et expérimente son style dit « invisible (52) » (« unseen style ») qu’il perfectionnera formellement dans Le Prince de New York. Lumet, selon le sujet qu’il traite, s’adapte parfaitement à son sujet, ce qui explique qu’il considère la caméra comme un acteur. Son style « invisible » dépend entièrement des acteurs. Ensuite, sa caméra se mouvra selon le jeu de ces derniers, s’immiscera entre les personnages qu’ils interprètent et les joutes internes (que peuvent être, au travers de ses films, une passion, une conviction, une vocation, un repentir que ses protagonistes défendent envers et contre tout) et externes (les corps institutionnels) de ces derniers. C’est dans les conflits internes de son protagoniste que Lumet va substituer toute l’action externe des films américains habituels pour les concentrer dans l’espace réduit entre le corps de l’acteur et les bords du cadre de l’image qui le contient. Seul le montage relayera la dynamique du corps de l’acteur profitant d’un coup de feu pour accélérer le film ou la tension du cœur de son héros (53).
« Ce qui est intéressant avec un groupe comme ça, le plus important, c’est de ne pas trop les stéréotyper, sinon, on a tout un tas de saynètes disparates qui n’ont rien à voir avec le film. Je ne voulais surtout pas ça. Alors, je leur ai fait lire n’importe quoi. Je voulais savoir s’ils respectaient leur vraie nature. Comment ils se comportaient. Je ne voulais pas de « personnages ». J’ai dit aux acteurs : « Peu m’importe si la vraie caissière a dit ceci ou si le vrai directeur a fait cela. Je ne les connais pas. » J’ai dit : « Je vous connais, vous et même si vous avez un autre nom, il s’agit de vous. Vous n’aurez pas de costumes, portez vos propres vêtements. Vous aurez 2 dollars par jour en plus pour vos propres vêtements. Aucun accent, sauf celui qui vous vient naturellement. » C’était pour m’assurer que le sensationnalisme du sujet ne devienne pas un obstacle au rapport entre le public et le film. » (Sidney Lumet à propos des employées de la banque prises en otage dans Un après-midi de chien)
« Sidney est un grand réalisateur, oui, mais aussi un réalisateur qui sait réunir les bons acteurs et les faire répéter. Peu de réalisateurs le peuvent. Il vous fait répéter en pensant à la caméra, au visuel. C’est un réalisateur de film, pas un metteur en scène de théâtre. Et pourtant, il est à cheval, il sait faire les deux. » (Al Pacino)
Ainsi, le film témoigne d’une parfaite hybridation entre un acteur et son réalisateur, union qui, à elle seule, réfuterait la politique des auteurs de la Nouvelle vague qui ne pourrait isoler en vain l’un comme l’autre (54). La réussite du film est également due à la fusion des principales préoccupations de son auteur (qui vont se distinguer selon les films et se préciser) et prophétise la menace médiatique qui va corrompre le protagoniste et l’entraîner dans une spirale dépressive malgré le fait qu’il devienne attachant auprès des employées d’une banque qu’il séquestre et malgré les spectateurs du film même.
« Ce fait-divers est l’une des premières incidences du cirque médiatique autour d’un événement réel sordide » (Commentaire audio de Sidney Lumet sur le film en DVD)
« Les monstres ne sont pas tels que nous les imaginons. Nous avons beaucoup plus de liens avec les comportements les plus marginaux que ce que nous savons ou voulons bien admettre. » (Sidney Lumet à propos du sujet de son film, Making Movies)
Les médias vont le déposséder du désespoir de son geste criminel, annuler son individualité à vif et anamorphoser ses traits de caractères, ses traits sexuels. La subtilité du film est pourtant de ne pas nous faire partager le point de vue médiatique, mais suivre son protagoniste dans des cercles restreins ou étendus et tous définis. Soit par le cadre de l’image, soit par l’intérieur de la banque, son extérieur, ou encore par les spots policiers qui « sur-exposent » sa silhouette fiévreuse. Spectateurs dépassés par les événements, le policier (Charles Durning) et l’agent du FBI (James Broderick) sont dans un premier temps arrogants, vite abasourdis puis finalement paternels à l’égard de Sonny, tous entraînés dans une galère médiatique qu’aucun d’entre eux n’avaient prévue, les empêchant d’agir pour certains (les représentants de la Loi) ou les encourageant d’agir à leur guise pour d’autres (Sonny et Sal). « Souriez, vous êtes filmés ! »
« Baissez vos armes. Sans la télé, ils nous tueraient tous ! » (Un après-midi de chien de Sidney Lumet)
La récupération de la figure de Pacino devenant un symbole qui le dépasse, comme de la situation dans laquelle il s’est compromis, sera poursuivie dans Network avec la figure d’Howard Beale (Peter Finch) :
« L’aliénation du spectateur au profit de l’objet contemplé (qui est le résultat de sa propre activité inconsciente) s’exprime ainsi : plus il contemple, moins il vit ; plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son propre désir. L’extériorité du spectacle par rapport à l’homme agissant apparaît en ce que ses propres gestes ne sont plus à lui, mais à un autre qui les lui représente. C’est pourquoi le spectateur ne se sent chez lui nulle part, car le spectacle est partout. » (Guy Debord, La Société du Spectacle)
Network (Main basse sur la T.V., 1976)
« Nous vivons dans un temps trop excentrique, pour s’étonner un instant de ce qui pourrait arriver » (Lautréamont, Les Chants de Maldoror)
Le présentateur-vedette de la chaîne télévisuelle U.B.S., Howard Beale (Peter Finch), est licencié pour baisse de popularité. Pour se venger, il déclare en direct qu’il va se suicider. Il devient du jour au lendemain une icône populaire fédérant les frustrations et les rancoeurs américaines. Diane Christenson (Faye Dunaway) va profiter de la situation et exploiter le présentateur dépressif et lunatique atteint par moments de démence lucide. Elle évince ainsi son ami Max Schumacher (William Holden), le directeur de l’information, après avoir eu une liaison avec lui et confie à Howard Beale, sous la protection de Arthur Jensen (Ned Beatty) et avec la complicité de Frank Hackett (Robert Duvall), l’animation d’une émission défouloir.
« Comme Max Schumacher et Howard Beale, Sidney Lumet et Paddy Chayefsky ont vécu l’ « âge d’or » du direct, et assisté à la mercantilisation de la télévision américaine, à l’emprise croissante des conglomérats sur le petit écran, au développement de l’information-spectacle. Network est leur réponse à ces phénomènes : un film aux outrances calculées, mêlant brillamment polémique et nostalgie, réalisme et envolées lyriques, politique-fiction et faits divers. » (Olivier Eyquem, Dictionnaire des films, sous la direction de Bernard Rapp et Jean-Claude Lamy, Larousse, 1991)
Lumet se fait ici le chantre des illusions perdues, tout en s’obstinant à prélever ce qui résiste malgré tout. Et impunément à ce que toute société et tout pouvoir régisse, même les accidents imprévus. Il confère à ce qui relèverait du faits-divers quelque chose de mythique. Le travail de Lumet comme cinéaste est de mythifier des individualités qui se sont incarnées à travers des faits-divers qui ont défrayé la chronique et qui sont représentatifs d’un moment social donné. Ou conceptualise des récits pour en dégager leur caractère exemplaire et propre aux récits bibliques ou mythiques.
« Herbert Spencer disait que les légendes et les mythes avaient tous un fondement dans la réalité. » (La Gorgone de Terence Fisher).
Dans Network, plus rien ne résiste. Les personnages qui semblent sans scrupules le sont parce qu’ils ne ressentent plus rien de réel. Ce sont même eux les premiers spectateurs, et en tête le personnage de Diane Christensen qui incarne à merveille une femme dénuée de sentiments (55) et complètement assujettie aux succès télévisuels qu’elle aimerait faire. Sa victime, Max Schumacher, réussit à la quitter, il part avec les honneurs liés à ses principes et ses éthiques affectives, mais disparaît aussi bien de la scène télévisuelle (il s’est fait renvoyé de U.B.S.) que de la scène filmique (on ne le reverra plus). Broyé lui aussi.
Et Howard Beale, son ami, finit crucifier sur scène et ses beaux discours n’auront servi qu’à la propre édification d’une effigie de plus que la télévision noiera une fois encore.
Son assassinat devant les caméras est passionnant : il est commandité par les organisateurs de son programme (Frank Hackett et Diane Christensen) et exécuté par des terroristes. Ces derniers, pourtant, prétendaient tout rejeter du système capitaliste. Ils font cet attentat en faveur de la démystification de leur propre acte politique même, détourné ici de leur idéologie, pour du spectacle, pour du divertissement tout public (56) ! Network poursuit la voie entamée par Le Gang Anderson et Un après-midi de chien. Il annonce Les Coulisses du Pouvoir (Power) qu’il réalisera une décennie plus tard.
« Tu as devant toi un homme qui doute. » (Max Schumacher à Diane Christensen)
Network est aussi une habile fiction qui se joue d’un cadre réel comme si le film était tiré d’un faits-divers. La voix off qui ouvre, ferme et le ponctue le film, l’absence de musique externe (Point Limite, La Colline des hommes perdus, Un après-midi de chien), l’acuité dans les détails liés au fonctionnement intérieur d’une chaîne de télé, la vraisemblance des dialogues, les véritables acteurs politiques contemporains (l’enlèvement de Patty Hearst) ou événements internationaux (Beyrouth)… Tout concourt à donner l’impression qu’il s’agit de l’adaptation fidèle d’un faits-divers de la même manière que Massacre à la tronçonneuse (1973) de Tobe Hooper avec le grain de la pellicule (16mm gonflé en 35mm) et l’avertissement annonçant qu’il s’agit de faits réels.
Lumet participe à cette contestation plastique de jouer avec la forme et de tromper sciemment les spectateurs de par ce qu’ils attendent habituellement de celle-ci. Et montrer comment une forme « hégémonique » peut être bien plus déterminante que le fond même. La forme manipule. Il nous fait donc croire à la genèse d’un véritable scandale, puis d’un véritable assassinat.
« Je fais partie de la vie. Je vis ici ! J’existe ! Tu ne peux pas changer de chaîne ! »
Network est un compte rendu des plus lucides et cyniques sur les milieux télévisuels. C’est également une œuvre qui s’articule et se construit autour de ses dialogues. Chaque personnage alimente la verve critique du scénariste Paddy Chayefsky. Que ce soit Howard Beale en public qui décomplexe la télé de sa pudeur hypocrite habituelle, mais alimente dangereusement la faculté boulimique de celle-ci à tout récupérer, Max Schumacher en privé ou Diane Christensen, trop consciente pour ne pouvoir rien faire.
« – Ça ferait un « Film de la Semaine », ou mieux, une rubrique.
– Une rubrique sur quoi, avec quoi ?
– Des gauchos encagoulés, « Armée de Libération Œcuménique » tournant en super 8, leurs propres hold-up ! Peut-être vont-ils filmer un de leurs rapts d’héritières, un détournement de 747, un plastiquage, une exécution ! On ouvre chaque semaine sur ces directs différés, des plumes font les commentaires, et c’est parti la rubrique !
– Une rubrique sur des casseurs de banque ?!
– Quel titre ? Le Mao Tsé-Tung Show ?
– Pourquoi pas ? Il y a bien « Brigade anti-gangs » ! Pourquoi pas « Che Guevara et ses pistolleros » ? Hier, je vous ai envoyé une analyse de thèmes. Vous l’avez lue ? En bref, j’y disais : « L’Amérique devient morose, matraquée : Vietnam, Watergate, inflation, crise. Elle débraie, se shoote à mort. Rien n’y fait. » En conclusion, je dis : L’Amérique veut que quelqu’un véhicule sa rage. Depuis 6 mois que je suis là, je vous dis : Je veux que ça saigne ! Ici, pas de routine, mais contre-culture, anti-establishment ! Je veux pas jouer la patronne dure, gougnotte, mais quand j’ai repris les rênes vous aviez une audience nulle ! Pas une émission au hit-parade ! Nous sommes une fumisterie ! Alors, pondez-moi un tabac pour la rentrée de septembre ! Faites-moi une émission sur un groupe terroriste. Staline et ses joyeux bolcheviks ! » (Diane Christensen à ses employés dans Network)
Avec Howard Beale, en victime désignée, qui prend de l’ascension dans un milieu où les enjeux sont énormes, Network renvoie aux fables de Frank Capra (L’Homme de la rue, L’Enjeu). Mais la fable « optimiste » du cinéaste n’est dorénavant plus possible pour Lumet, ni même envisageable (57). La magie du cinéma n’opère plus rien, même dans son idéal le plus sincère et dépouillé.
Sidney Lumet n’a jamais été aussi cynique et désabusé, et ses dialogues nous communiquent le fond de sa pensée. Howard Beale proclame les vérités (58) qui ne seront pas démenties par son ami Max (59), tandis que Diane, Frank et Arthur Jensen pratiquent les modes scandaleux de fonctionnement économiques et stratégiques de la télévision. Et comme Arthur Jensen le confie à Howard Beale (60), c’est la compétition, la concurrence, le capitalisme qui nous gouverne.
Le monde est une affaire et la seule chose qui compte ce ne sont pas les frontières, c’est faire de l’argent.
Lumet et Chayefsky remettent en question toute notre Histoire et comment celle-ci s’articule autour de la question des intérêts. La télévision représente cette prise de conscience dans un premier temps, mais la continuité implacable de cette logique historique dans un deuxième.
« La transgression n’est pas la négation de l’interdit, mais elle le dépasse et le complète » (Georges Bataille, L’Érotisme)
La Télévision est décrite comme une machine infernale qui se nourrit de ses digressions et qui, dans son accumulation informative et virtuelle, cache et censure (61) finalement tout. Elle est même comparable au système corruptif policier si ce n’est qu’elle est pire puisqu’elle se définit par la corruption. En effet, elle dénature la liberté de la presse et d’expression dans ses abus et vend au plus offrant toute la culture subversive et underground américaine, enterrant définitivement toute la culture des années 60 et 70 propre à la génération Crumb par exemple.
« La télévision transforme en spectacle ce qu’elle montre. La télévision c’est les événements mis en vitrine. C’est comme un tableau qui bouge, il est contemporain de ce qui se passe dans la rue et en même temps on se sent un peu protégé. La télévision, ne l’oublions pas, est quand même un meuble, c’est du confort, une image intégrée au mobilier » (André S. Labarthe, Les Périphériques vous parlent, n°17, 2003).
Piège mortel (Deathtrap, 1982)
« Maintenant, retenez bien ceci : Le théâtre, en raison de son côté spectaculaire et de sa notoriété, attire beaucoup de gens qui ne veulent qu’exploiter leur beauté ou faire carrière. Ils profitent de l’ignorance du public, de son goût faussé, des caprices, des intrigues, des faux succès et de tant d’autres moyens qui n’ont aucun rapport avec l’art. Ces exploiteurs sont des ennemis mortels de l’art. Nous devons user avec eux des mesures les plus strictes, et si nous ne pouvons les changer, il faut leur faire quitter les planches. » (Constantin Stanislavski, La formation de l’acteur)
Sidney Bruhl (Michael Caine), un célèbre dramaturge, est prêt à tout pour s’approprier la pièce de théâtre qu’un ancien étudiant lui a envoyé. Ce dernier, Clifford Anderson (Christopher Reeve), se fait assassiner par le dramaturge à son domicile et devant Mary Elizabeth Maxwell Bruhl (Dyan Cannon), la femme de celui-ci. Mais il revient à la vie et provoque l’arrêt cardiaque de cette dernière. Tout ceci était en fait un stratagème entre les deux hommes pour la tuer et toucher son héritage, mais voilà que Clifford veut tout révéler en adaptant ces événements compromettants dans une pièce…
« Je suis peut-être capable de tuer Clifford Anderson, mais je ne suis pas assez criminel pour être producteur. » (Piège Mortel de Sidney Lumet)
« Sais-tu ce que cette pièce rapporterait à son auteur, aujourd’hui ? Entre trois et cinq millions de dollars. Et sans le T-shirt marqué « Piège Mortel ». Si ça n’est pas un mobile correct, je n’en connais pas. » (Piège Mortel de Sidney Lumet)
Le film prend le parti pris de trouver le meurtre normal, logique d’où l’intérêt du film qui revendique son artificialité. Du dispositif théâtral (spatialisation d’un huis-clos) à ses enjeux dramatiques et moraux.
Lumet, comme Joseph L. Mankiewicz avec Le Limier (Sleuth, 1972), s’intéresse à la démiurgie des meurtriers qui veulent tout anticiper en évaluant les moindres faits et gestes, et créant des stratagèmes pour confondre leur victime. La victime étant Myra dans un cas et le spectateur de l’autre. Ce dernier meurt symboliquement parce que surpris alors qu’il est censé être prévenu de ce qui suit et privilégié de son statut et du choix qu’il a fait pour voir sciemment une « comédie macabre ».
Le film est à l’image de la pièce « Piège mortel » qui n’est pas « authentique », qui n’est qu’un prétexte pour détourner l’attention de Myra et mieux la tuer.
« Sociopathe (…), ce mot ne me fait pas peur, mais il me donne à penser. Cela signifie, tu le sais, « personne qui n’a aucun sens d’un devoir moral. » (Piège Mortel de Sidney Lumet)
Le film se joue des fonctions sociales et des sexes qui, tous deux, ne cessent de s’interchanger : l’hétérosexuel devient homosexuel, la victime devient bourreau,… et du coup, démythifie tout ce que la société érige en nous par l’éducation.
Le film joue avec l’interaction fiction et réalité un peu comme dans la série télévisée de La Quatrième Dimension. La malédiction des personnages du film est la suivante : les auteurs Sidney et Clifford ne peuvent plus créer de personnages issus de leur imagination, ils doivent les incarner. En l’occurrence, il s’agit ici de comédie macabre. Ils vont pratiquer eux-mêmes leur meurtre pour épuiser toutes les possibilités criminelles que cet acte implique. Ils mettent à l’épreuve leur connaissance du sujet sordide qui hante leurs pièces, mais s’enlisent dans la vanité de la gloire et la soif banale d’argent. Comme tout le monde…
« Réfléchis une minute, tu veux ? Réfléchis à tout ce qui s’est passé cette nuit-là. Maintenant, essaie de le voir du point de vue du public. Tout ce que nous avons fait pour convaincre Myra qu’elle assistait à un vrai meurtre aurait exactement le même effet sur un public. Nous avons écrit et répété une pièce. Nous l’avons préparée et jouée. Elle était le public ! On l’a fait ! Ça a marché. À la perfection. Et personne ne peut prouver ce qui s’est passé ! » (Piège Mortel de Sidney Lumet)
« – Et tu crois que cette pièce, cette concoction…
– De vérités, de faits…
– Mon cher, ces faits sont déments, extravagants.
– (en chœur) « Des circonstances assez distrayantes pour permettre au public d’oublier l’invraisemblable ». Première leçon. » (Piège mortel de Sidney Lumet)
Lumet dénonce le caractère artificiel de certaines pièces qui n’articulent que des clichés formels innombrables pour viser le succès. Ce qui intéresse Lumet, c’est comment le cliché, comme les « personnages insignifiants » dans ce genre de pièce (contrairement aux personnages secondaires qui motorisent l’action du film), va contaminer leurs auteurs eux-mêmes devenus sociopathes tellement ils sont accros au succès, à la gloire !
Sidney Bruhl et Clifford Anderson sont des virtuoses vaniteux et artificiels, et leur union ne peut qu’aller au désastre puisqu’ils sont seuls dans ce que le succès convie (leur homosexualité criminelle et leur vanité renvoie à La Corde d’Alfred Hitchcock, également un huis clos). L’un d’eux est donc forcément de trop et le deuil n’a plus lieu d’être dans leur existence vaine, dépourvue d’affect à l’égard des autres : ils ont réussi à intégrer (et incarner) à la perfection ces « personnages insignifiants » qu’ils rattachent aux types de pièces qu’ils écrivent.
À la recherche de Garbo (Garbo Talks, 1984)
Estelle Rolfe (Anne Bancroft) est une femme d’une cinquantaine d’années, dynamique et militante convaincue. Son fils, Gilbert Rolfe (Ron Silver), est légèrement effacé face au caractère singulier de sa mère. Atteinte d’une tumeur au cerveau, Estelle Rolfe va lui demander une requête des plus insolites pour laquelle il va s’investir corps et âme, mais aussi grâce à laquelle il va réaliser un vrai baptême du feu vis-à-vis de son existence morne. Cette requête : rencontrer Garbo. L’enquête consacrée à sa mère qu’il va mener va bouleverser son quotidien : il rompt avec sa compagne Lisa (Carrie Fisher), rencontre Jane Mortimer (Catherine Hicks), une jeune actrice charmante et pimpante, et démissionne.
« – (Gilbert Rolfe) Elle veut rencontrer Garbo !
– (Lisa Rolfe) C’est sa dernière volonté ?
– (Estelle Rolfe) C’est pas ma dernière volonté. J’en ai encore des milliers. Mais le temps presse, alors il faut s’y mettre. » (À la recherche de Garbo)
Lumet rend hommage à la subjectivité du spectateur accro à l’image d’une actrice et règle ses comptes avec sa propre fascination des acteurs. Mais À la recherche de Garbo est également un film pudique sur la mort que le cinéma vient occulter de manière subtile alors qu’ils sont tous deux intimement liés. La scène où la vieille star entre dans la chambre d’hôpital d’Estelle malade l’atteste : telle « La Mort qui fauche » venant chercher une vie de simple mortel et l’emmener au ciel, Garbo accompagne les derniers instants de vie de cette femme.
« C’est un privilège d’aller en prison pour ce en quoi on croit » (À la recherche de Garbo).
Lumet, par l’intermédiaire de ce film, réalise une équation intéressante grâce à cette protagoniste survoltée, perpétuellement en lutte et revendications. Il met en parallèle militantisme chevronné et cinéphilie : ce sont tous deux des mondes imaginaires qui « romantisent » la vie à défaut d’être vraiment effectif sur le plan social, mais qui sont vitaux pour maintenir sa résistance au monde. Et au cinéma, Lumet n’est pas dupe sur ces films, ces derniers ne changent pas la vie, mais l’accompagnent.
« Après avoir vu quelques films dirigés par mes collègues réalisateurs de comédie qui semblaient avoir abandonné le comique en faveur du message, j’écrivis Les Voyages de Sullivan pour satisfaire le besoin de leur dire qu’ils devenaient trop profonds : laissez le sermon aux prêcheurs. » (Preston Sturges)
Les Coulisses du Pouvoir (Power, 1986)
« Dans l’arène sociale du spectacle, où s’affrontent avec une égale cupidité les forces du bien et les puissances du mal, il faut que le combat continue puisque les deux camps y gagnent financièrement » (Raoul Vaneigem, Rien n’est sacré, tout peut se dire).
Pete St. John (Richard Gere) est conseiller en marketing politique. Il coache sénateurs et gouverneurs jusqu’aux élections concernées en assurant leur promotion avec une image de marque soignée pour les médias et contemporaine aux goûts des statistiques. Dénué de toute considération morale et prêt à tout, St. John va pourtant se remettre en question quand son ami, le sénateur Sam Hastings (E.G. Marshall), se retire de la politique à cause d’un chantage sordide effectué par l’un de ses clients. Son ex-compagne, Ellen Freeman (Julie Christie), une journaliste sans états d’âme ou presque, et son adversaire et ancien partenaire, Wilfred Buckley (Gene Hackman), vont se mêler à la partie, pris également dans la tourmente du jeu politique et médiatique qui les opposera dans un premier temps avant de les fédérer ensuite.
« La politique est le dernier refuge des incompétents » (Penrose cité dans The Wiz de Sidney Lumet)
Sans retrouver le cynisme génial et la verve entraînante de Network, Power a toutefois un pouvoir d’attraction sur le spectateur grâce au culot et à l’audace de son protagoniste auquel on craint de s’identifier tout le long du film !
Dès l’ouverture qui suit le générique, Lumet donne le ton : un politicien parle en public jusqu’à ce qu’un attentat survienne. Le politicien accourt sur la place publique et prend dans ses bras une victime ensanglantée, gueulant à la caméra de St John, qui vient de faire irruption, de ne pas filmer. Le politicien et le conseiller en marketing sont complices et le sang sur la chemise blanche du premier est la marque indélébile de ce succès médiatique garanti qu’ils ont si savamment orchestré. Au politicien, il lui fallait cet acte héroïque et de compassion pour le rendre crédible dans le monde politique et St John, manipulateur de génie, l’a mis en scène comme un publiciste qui réussit à vendre son produit.
« Je ne cherche pas à amener de la morale là où il ne doit pas y en avoir » (Fernando Di Leo à propos de scènes violentes dans Le Boss, propos recueillis à Rome le 17 juin 1988 par Claude Ledû, « Mad Movies », Hors-Série « Spécial Italie », avril 2005).
On sent bien que le sujet tient à cœur au réalisateur qui, une fois de plus, se projette ou se dédouble ironiquement dans la peau de ce personnage atypique et, de prime abord, répulsif vu les méthodes qu’il utilise pour arriver à ses fins.
Il faut le voir apprenti reporter dans la scène décrite ci-dessus ou, plus loin, metteur en scène dirigeant un politicien accoutré en cow-boy avec une pléiade de figurants derrière lui représentant les premiers colons. Monteur astucieux sauvant une prise importante qui a été compliquée à faire. Et enfin, renforçant habilement les images d’un slogan publicitaire pour la campagne d’un député.
Comme Network, Power analyse les logiques de pouvoir, à savoir comment celui-ci s’articule et se manifeste-il dans une campagne promotionnelle.
« Ce que je dis de la politique s’étend à toutes choses ; l’égalité produit partout les mêmes effets ; là où la loi ne se charge pas de régler et de retarder le mouvement des hommes, la concurrence y suffit » (Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique II).
Plus l’intrigue se resserre sur son protagoniste à mesure que le film se déroule, plus celui-ci s’humanise. Lumet va lui opposer deux personnages pour y arriver. Le premier, c’est Arnold Billing (Denzel Washington), conseiller du sénateur Jerome Cade (J.T. Walsh), et double négatif de Richard Gere qui est prêt à tout pour son protégé dans la mesure où ces élections sont déterminantes pour son trafic douteux avec le monde arabe. Le deuxième, c’est le candidat indépendant Phillip Aarons (Matt Salinger) qui apparaît comme le politicien idéal vu son jeune âge, sa simplicité et son franc parler. Au contact de St John qui va lui faire comprendre la dimension spectaculaire et artificielle d’une campagne, il va se révéler être un homme fasciné par le jeu médiatique, pris dans une spirale qui, on s’en doute, va l’éloigner de son programme politique avant de se discrédité comme les autres. La fable de Capra concernant ce personnage n’aura pas survécu longtemps.
Pour Lumet, la corruption est un principe politique et tentateur irrésistible (Network, Contre Enquête, Dans l’ombre de Manhattan), et si l’on veut s’en défaire, il faut rompre avec tout (Serpico, Le Prince de la ville) et accepter de vivre sur du fumier à l’image du personnage biblique de Job.
« Family affairs » (Long Day’s Journey into Night, À bout de course, Une étrangère parmi nous)
« Il y a quelque chose de biblique dans la conception qu’a Lumet de la culpabilité : la culpabilité du père est transmise à ses fils, et prend une place prédominante dans leur vie. Les pères et fils, ainsi que d’autres binômes structurellement similaires (professeur / élève, homme âgé / jeune homme), sont omniprésents dans le cinéma de Lumet. Et les familles sont nécessairement dominantes. Bien que la vie de famille soit un motif central dans la vie et l’art juif américain, elle tient une place unique chez les Juifs. Une dynamique familiale particulière, une attention débordante accordée aux enfants, caractérise la vie des Juifs en Amérique. Pourtant, la plupart des films américains sont habités du motif du héros solitaire ; l’image frappante du « self-made man », qui n’a littéralement ni passé, ni famille, traverse les genres du cinéma américain. L’insistance de Lumet sur la vie de famille est un signe distinctif de son cinéma. Depuis Long Day’s Journey into Night (1962), un de ses premiers succès, jusqu’au sous-estimé A bout de course (1988), la question de la loyauté familiale en but avec la culpabilité d’un membre de la famille est au cœur des meilleurs films de Lumet. À côté de véritables familles, il utilise également des familles de substitution, et en particulier la police, comme c’est le cas dans la trilogie (62) Serpico (1974), Le Prince de New York (1981) et Contre Enquête (1990). Une autre sorte de famille, peu conventionnelle s’il en est, structure un autre film important, Un Après-midi de chien (1975). » (American-Jewish filmakers : Traditions and Trends, « Sidney Lumet : The Memory of Guilt », David Desser and Lester D. Friedman, Chicago, University of Illinois Press, 1993)
Long Day’s Journey Into Night (1962)
C’est peut-être à partir de cette adaptation précise et consciencieuse de la pièce homonyme d’Eugene O’Neill que le cinéma de Lumet va se complexifier et dans un même temps préciser ses thématiques.
La famille qu’il dépeint n’est pas celle ambivalente ou idéale qu’il décrira plus tard. Elle vit dans la culpabilité et chacun des membres qui la composent, un couple et leur deux enfants, vont s’entre-déchirer chacun de leur côté avant de le faire en face des concernés.
Lumet va dépeindre la culpabilité dévorante pour chacun d’entre eux et cela malgré leur âge ou leur sexe, malgré leur condition sociale. La servante, qui apparaît au milieu du film comme le seul élément extérieur de cette famille, va même permettre au réalisateur (comme dans la pièce d’ailleurs) de mettre en parallèle les non-dits sociaux, c’est-à-dire ne pas divulguer les secrets de famille qui leur ferait parjure avec les « quand dira-t-on », et les non-dits de la cellule familiale à savoir, la mère est une droguée et l’un de ses deux fils est atteint de tuberculose. La peur de la perte des uns pour les autres vont les transformer en véritables monstres qui vont projeter leur refoulé à la face des uns et des autres, se renvoyant indéfiniment une image critique déchirante et destructrice.
Le film est une réussite tant sur l’adaptation fidèle qu’il en tire que sur la direction des acteurs dont le jeu varie en fonction de leur âge et de leurs études théâtrales diverses. Tout le film sombre, à l’image de la pièce, à mesure que les personnages s’entredéchirent à tel point que ce n’est plus la nuit qui tombe dans la deuxième partie du film, mais ce sont les sentiments désespérés de chacun des membres qui assombrissent le jour. Magnifique idée scénique bien dégagée par Lumet qui nous livre toutes les désillusions et les désespoirs propres à chaque génération le long d’une journée, le temps d’un film.
Long Day’s Journey Into Night est servi par Katharine Hepburn (Mary Tyrone), Ralph Richardson (James Tyrone), Jason Robards, Jr. (Jamie Tyrone), Dean Stockwell (Edmund) et Jeanne Barr (Cathleen, la bonne).
À bout de course (Running on Empty, 1988)
Le film décrit le mode de vie d’une petite famille en cavale, recherchée par le FBI et les conséquences affectives sur chacun des membres qui la composent.
À première vue, comme pour Daniel (1983), Lumet s’intéresse particulièrement à l’adolescent (River Phoenix) qui est victime malgré lui des convictions politiques de ses parents (Christine Lahti et Judd Hirsch). Cela relèverait de la tragédie propre à la filiation, mais Lumet, à aucun moment du film, n’accable les parents (qui eux aussi ont des problèmes avec les leurs). Il préfère jouer avec l’inversion d’une typologie.
Imaginer la petite famille américaine modèle, idéale devenir l’ennemi public n° 1. C’est la famille émigrante du début du siècle qui se déplacerait infiniment jusqu’au cauchemar et qui dénoncerait la fausse intégration des étrangers en Amérique ! D’ailleurs, Lumet insiste bien sur l’esprit éveillé de l’adolescent malgré le changement d’identité constant pour échapper au FBI se rapprochant d’eux chaque jour. Dès qu’il communique avec le monde extérieur de sa famille, il le séduit (de celui social à celui sexuel), de l’enseignant de musique à la fille de ce dernier.
Lumet dépeint la famille de ses rêves dont les membres s’interpénètreraient dans n’importe quelle couche sociale pour résister, s’adapter et vivre, et dont le premier commandement reposerait sur la critique constante de l’autorité (son père lui apprend à la remettre en cause). Mais le film, plus complexe qu’il en a l’air, sous-tend l’autorité de cette typologie qu’elle soit idéale ou non : toute famille qui détient sur ses membres un rapport exclusif tue l’affirmation individuelle de ces derniers.
D’ailleurs le film se termine sur la libération du jeune homme par sa famille qui sacrifie son unité pour le bonheur de l’un de ses membres. Condamné à ne plus revoir sa famille pour vivre « naturellement » sa passion pour la musique et consumer sa relation affective avec la fille qu’il aime.
Une étrangère parmi nous (A Stranger Among Us, 1992)
Un jeune juif Hassidique est retrouvé assassiné dans sa boutique du quartier des diamantaires de New York. Emily Eden (Mélanie Griffith), une femme détective reconnue pour sa dureté, est chargée de mener l’enquête. Elle devra s’infiltrer dans la communauté religieuse à laquelle appartenait la victime ; il n’y a pas eu d’effraction sur les lieux du crime et 750 000 dollars en bijoux ont disparu. Le meurtrier appartiendrait donc à cette communauté. Celle-ci aux nombreuses règles strictes va épanouir Emily Eden et remettre en question la violence et l’apathie affective de son quotidien dans lequel elle s’est enlisée. Sa rencontre avec le Rebbe (Lee Richardson), Ariel (Eric Thal) et sa sœur Leah (Mia Sara) y seront pour quelque chose…
Le film se joue de deux clichés qui tendent à la misogynie d’un côté et au racisme quotidien vis-à-vis d’une minorité sociale de l’autre.
D’une part, la fonction professionnelle policière est visée dans la mesure où la femme y est souvent absente ou infériorisée. En effet, on la voit mal courir et se servir d’un flingue. Et pourtant, elle pourrait très bien le faire. Pourquoi pas ? Lumet va donc se servir d’un personnage féminin et plus précisément d’une individualité (63) bien affirmée, voire « extravertie ».
D’autre part, la communauté juive des Hassidique est souvent observée avec condescendance par le badaud qui les croiserait sur sa route, comme l’atteste la première confrontation d’Emily avec eux depuis sa voiture. Lumet va explorer les particularismes sociaux et culturels, liés à cette communauté religieuse, pour y dégager des symboliques non dépourvues de poésie. Et la conjoncture des deux, une femme policière et une communauté religieuse, va s’opérer le long du film, le temps que Lumet nous décrive les possibilités, les compatibilités affectives de l’un à l’autre.
Chez Lumet, d’une autre manière que Hitchcock (et ses « faux coupables »), le protagoniste est coupable et doit affronter sa culpabilité. Dans Une étrangère parmi nous, Emily compromet son collègue en ne demandant pas de renforts. Celui-ci est dangereusement blessé et se remettra lentement de ses blessures au fur et à mesure du film.
Emily Eden n’est pas une femme heureuse. Derrière sa dureté se cache des problèmes liés à sa famille. Son père ne fait preuve d’aucune attention à son égard et la mère est absente. Elle va se faire facilement adoptée par la famille juive qu’elle infiltre et recevra d’elle une affection réelle qu’elle n’aurait jamais imaginée.
Lumet, par l’entremise du deuil d’un juif assassiné, va plonger Emily et son spectateur dans les symboliques de la communauté. Ce deuil va lui permettre d’esquisser des règles strictes, mais d’une grande beauté. Par exemple, les miroirs sont recouverts dans la maison du défunt lors du deuil : cela signifie qu’il n’y a pas de place pour la vanité dans le deuil. Ou encore, on déchire les vêtements des endeuillés : cela signifie qu’on ne doit pas s’occuper à séduire. Et enfin, les pieds nus représentent l’idée que l’on n’est pas riche quand quelqu’un meurt. Pour parachever modestement son entreprise de « vulgarisation » filmique d’un milieu social bien défini, il va se servir des lectures du personnage Ariel qui s’isole pour étudier la Cabale.
« – (Ariel) La Cabale dit que l’homme doit trouver en lui tout ce qu’il cherche.
– (Emily) Eh bien, la cabale ne m’avait pas prévue, il me semble… » (Une Étrangère parmi nous de Sidney Lumet)
La famille juive va se révéler idéale pour Emily dans la mesure où, malgré les sexes séparés ou délimités, cela n’entame en rien le respect qu’ils peuvent avoir les uns pour les autres. Lumet se sert même de l’ironie suivante : le monde juif est un monde soudé accroché à de véritables valeurs et leur richesse vaut tous les plus beaux diamants du monde. Emily Eden trouve dans le Rebbe (« rabbin ») son père d’adoption qui a subi l’expérience des camps de concentration pendant la Seconde Guerre, ce qui la rapproche de son expérience « chaotique » de flic.
Lumet décrit le monde d’Emily, le nôtre, celui autour des Hassidiques comme un monde sans valeurs, violent, sexiste, raciste où la cellule familiale est détruite et où le couple entre l’homme et la femme ne peut ni durer, ni être entamé pleinement. Lumet « idéalise » la communauté qu’il dépeint et crée une histoire d’amour entre Ariel, le futur « Rebbe », et Emily.
La seule chose que Lumet épargne de notre monde, c’est le cinéma qui, même retranscrit sur un écran télé, ne peut atténuer notre admiration comme l’atteste cette scène où Ariel voit danser Fred Astaire et Ginger Rogers dans une comédie musicale. C’est la première fois qu’il voit un film et c’est magique. Il ne peut cacher son admiration pour une communauté qui objective et protège un idéal. Celui de Lumet est purement et simplement le cinéma.
« Dieu compte les larmes des femmes, aussi pleurent-elles plus souvent. » (La Cabale citée dans Une Étrangère parmi nous).
« Oh, God ! My God ! (64) » Exemplarité, Doute et Vocation (Douze hommes en colère, King, Equus, The Wiz)
« NINA
(…) dans notre métier, artistes ou écrivains, peu importe, l’essentiel n’est ni la gloire ni l’éclat, tout ce dont je rêvais ; l’essentiel, c’est de savoir endurer. Apprends à porter ta croix et garde la croyance. J’ai la foi, et je souffre moins, et quand je pense à ma vocation, la vie ne me fait plus peur.
TREPLEV, tristement.
Vous avez trouvé votre voie, vous savez où vous allez, mais moi, je flotte encore dans un chaos de rêves et d’images, et j’ignore pour qui et pourquoi j’écris. Je n’ai pas la foi et je ne sais pas quelle est ma vocation. » (Anton Tchekhov, La Mouette)
« Qu’il se réjouisse,
Celui qui respire en haut dans la lumière rose !
Car en-dessous, c’est l’épouvante,
Et l’homme ne doit pas tenter les dieux
Ni jamais, au grand jamais, désirer voir
Ce qu’ils daignent couvrir de nuit et de terreur. » (Schiller, Der Taucher (Le plongeur), ballade de 1797, v. 91-96, cité par Freud dans Le malaise dans la culture).
Douze hommes en colère (12 Angry Men, 1957)
« L’un plaisantait comme un soudard, l’autre gonflait ses joues pour mieux prêcher des lieux communs. » (Hölderlin, Hypérion)
« Je suppose qu’en tout j’ai dû réaliser cinq cents dramatiques sur une durée de cinq ans ! Puis Reginald Rose, l’auteur de la dramatique télévisée Douze hommes en colère, que je n’avais pas vue, me proposa d’en tirer un film et ce furent mes débuts au cinéma. Mais par la suite j’ai continué à tourner pour la télévision, tant j’aimais cela, par exemple une adaptation de la pièce d’O’Neill The Iceman Cometh, une autre du Dibbouk et même de Rashomon ! » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).
Dès l’ouverture du film, le visage d’un enfant portoricain se fondant dans la salle où le jury va venir débattre sur son sort, Lumet annonce la « couleur » de son sujet.
Douze hommes en colère est le film de toutes les oppositions : l’enfant contre des adultes, une génération contre l’autre, un individu contre un groupe, une origine raciale contre une autre…, mais c’est surtout la démonstration positive, optimiste et idéale de ce que l’individu, fidèle à ses convictions et à ses droits, peut réaliser. Même seul contre tous.
Douze hommes en colère est un peu la version sérieuse du film de Preston Sturges, Le Gros lot (Christmas in July, 1940), où l’on fait croire à un homme qu’il a gagné à un concours de slogans publicitaires alors que le jury est encore enfermé dans une pièce pour en débattre. Ils sont tous d’accord pour décerner le prix à l’exception d’une seule personne ! Lumet, par l’entremise d’un juré, joué par Robert Webber, lui rend hommage puisque celui-ci travaille sur les slogans publicitaires.
« Que pensez-vous de l’affaire ? Moi, j’ai trouvé ça très intéressant. (…) . Une chance que ce soit un meurtre. Et pas une agression ou un vol. En général, c’est d’un barbant ! » (Douze hommes en colère de Sidney Lumet)
Grâce à ses personnages, Lumet dénonce l’irresponsabilité de certains individus que les professions et les habitudes pervertissent en les éloignant de toute réalité sociale. Les enfermant dans leurs réflexes quotidiens d’où émanent des préjugés bien ancrés. Ils sont bien souvent dépourvus de libre arbitre.
Lumet constate l’impossibilité de ces hommes à se remettre en question ou à sortir d’eux-mêmes. Il montre donc combien la vie monotone de certains (qui un jour pourront avoir la responsabilité de vie et de mort sur un citoyen) peut être dangereuse pour d’autres (les minorités sociales ou sexuelles qui se retrouvent sur le banc des accusés par exemple) quand un homme est sans passion, sans conviction. Pris au piège dans une salle de jury selon lui (Jack Warden par exemple), alors qu’il est pris au piège dans son quotidien et les habitudes qu’il s’est créés.
Le film dénonce déjà, bien avant Un après-midi de chien, le rapport au spectacle qu’entretiennent les jurés entre eux vis-à-vis de leur amour-propre à débattre, et comment ce rapport décrédibilise même et surtout une réalité sociale dure, bien souvent propre aux minorités.
« Le problème, quand tout un chacun se met à vouloir rendre justice, c’est qu’à la faveur du désordre et de l’excitation, on peut se mettre à pendre des innocents par erreur.
Puis à se pendre les uns les autres, parce qu’on trouve ça amusant. Ensuite, on ne peut plus regarder un arbre ou une corde sans être parcouru de frissons. Chacun d’entre nous perd la tête dans ce genre de situation. En groupe, on fait des choses qu’on n’oserait jamais faire seul. » (Vers sa destinée, John Ford).
Les jurés appartiennent tous à des caractères, des sentiments, des fonctions sociales bien définies (ou que l’on devine) à l’exception de Fonda qui incarne une pensée claire et juste au détriment de tout sentimentalisme, dépourvu d’excès d’humeur, mais modulable selon l’impartialité de l’institution à l’égard d’un homme. Fonda incarne et assume pleinement la morale du film et sa stature relève du fantastique dans la manière où il se démarque du reste des jurés. Son costume blanc et son sang froid le rendent fantomatique, et permet au film d’assumer son postulat allégorique.
« Il est toujours difficile d’oublier ses préjugés dans ce genre de situation. Où qu’on les rencontre, les préjugés masquent toujours la vérité. Je ne sais pas où est la vérité. Je crois que personne ne le saura jamais. » (Henry Fonda dans Douze hommes en colère)
Ce film témoigne que l’injustice des hommes repose sur leur incapacité à accepter le doute. Ils ne le supportent pas. C’est pourquoi ils créent des raisons artificielles, souvent articulées autour d’anecdotes peu tangibles (si elles sont creusées), pour se consoler ou se rassurer à l’encontre d’un doute qui ne sera peut-être jamais démenti.
Douze hommes en colère est un film didactique qui, dans ses truchements d’angles et d’éclairages pour dramatiser l’action et renforcer les conflits, est une démonstration utile montrant combien il est difficile et périlleux de réussir à adapter les préceptes juridiques de la justice américaine. C’est un combat sans cesse renouveler qui ne repose en aucun cas sur des acquis pénaux dans la mesure où ces derniers seront toujours remis en question par les hommes eux-mêmes et la complexité de leurs crimes.
En l’occurrence, Lumet rend hommage au « doute légitime » comme droit pénal indispensable pour éviter une justice expéditive et la mener à l’erreur.
« Mais nous avons un doute légitime (« reasonable doubt »). C’est un principe inestimable de notre système. Aucun jury ne peut déclarer un homme coupable sans en être sûr. » (Douze hommes en colère)
Dès son premier film, Lumet est déjà polémique puisqu’il désarticule une justice qui, pour être idéale, doit outrepasser les propres limites qu’elle s’est fixées. Il ne faut pas oublier que le premier argument persuasif de Fonda, pour convaincre les autres jurés et défendre l’accusé, est l’achat illégal d’un couteau à cran d’arrêt identique à l’arme du crime, procuré chez un prêteur sur gages. Magnifique paradoxe sur une justice qui ne peut et ne sera jamais parfaite parce qu’elle doit être constamment à parfaire, même par la transgression.
Douze hommes en colère est un film construit en miroir qui isole dans la première moitié Henry Fonda et, dans la deuxième, Lee J. Cobb. Il montre combien il est difficile, voire même déchirant de se retrouver seul (Long Day’s Journey Into Night, Serpico, Le Prince de New York). La solitude de l’inculpé contamine sciemment Fonda et contamine, telle une malédiction, Lee J. Cobb qui se retrouve nez à nez avec son propre fils refoulé et avec lequel il a rompu des années plus tôt. Lee J. Cobb, isolé, devient – et contrairement à Fonda – un monstre caractériel qui se disloque complètement, non seulement vis-à-vis de son fils, mais aussi parce qu’il est fragile ; il n’est rien sans les autres (et surtout sans le juré interprété par E.G. Marshall), complexé de ne pouvoir argumenter ses propres idées, opinions et jugement. Il n’a pas su se construire seul et c’est pourquoi il refuse la simple idée que son fils soit parti faire sa vie en se passant de lui. Son enfant représente une remise en question qu’il ne supporte pas, ni même n’envisage.
Lumet condamne tout particulièrement quatre personnages comme les exemples les plus représentatifs et dangereux d’une justice qui pourrait les contenir dans une réalité donnée. Ce sont Jack Warden et Robert Webber, tous deux travaillent dans la pub. Le premier veut voir coûte que coûte son match quitte à changer d’avis à la moindre occasion ! Le deuxième ne cesse de discréditer la situation, se moquant éperdument du sort d’un jeune portoricain, ne portant intérêt qu’à ses slogans publicitaires. Puis Ed Begley et E.G. Marshall. Le premier interprète un raciste colérique, grossier qui monopolise la parole de sa verve agressive et intimidante. Il tousse, transpire et laisse entrevoir la strie de ses dents. Le deuxième est un courtier en bourse. Bien qu’adversaire le plus déterminé et respectable de Henry Fonda, il est un véritable androïde (il ne transpire jamais comme il l’affirme lui-même) qui ne remet rien en doute, convaincu par une justice « angulaire » qui n’accepte aucune souplesse ou ne souffre d’aucune ambivalence.
« Non seulement Lumet nous fait amplement comprendre que les jurés ont des idées reçues sur les Noirs et les Portoricains, mais, plus important encore, il nous montre aussi que ces stéréotypes peuvent avoir de graves conséquences. Le conformisme, surtout quand il sert à dissimuler le racisme et les préjugés, peut tuer. » (American-Jewish filmakers : Traditions and Trends, « Sidney Lumet : The Memory of Guilt », David Desser and Lester D. Friedman, Chicago, University of Illinois Press, 1993).
Enfin, Lumet réalise une subtile mise en abîme finale : les jurés n’ont pas de noms et le générique de fin nous livre seulement le nom des acteurs comme si ces derniers venaient de jouer pour nous leurs propres rôles !
King – A Filmed Record – Montgmomery to Memphis (1970)
« L’important n’est pas de lire : « Au commencement l’esprit de Dieu était porté sur les eaux. » L’important n’est pas de lire : « Au commencement était le verbe. » L’important n’est pas de lire : « Au commencement était la fable. » L’important n’est pas de lire : « Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre. » L’important n’est pas Dieu, ni le Verbe, ni la fable, ni la rencontre. L’important n’est même pas l’atteinte du verbe et de la fable, mais ce que l’on devient lorsqu’on y touche, tous nos changements sous leur pouvoir, notre manière de déteindre à leur passage, de devenir semblable à ce que l’on contemple, de perdre la raison et d’entrer dans la fable : car il est des ciels qui font les yeux bleus, des gazelles qui donnent la légèreté, des souvenirs qui rendent la mémoire, des contes qui effacent la réalité, il est des dieux qui nous transforment en mystère et des nuages qui font devenir oiseau. » (Requichot, Le discours du mourant)
« Les documents, dont disposent ce film, traitent de la vie et de l’œuvre du Dr. Martin Luther King de 1955 à 1968.
Ce film n’a pas l’ambition d’être exhaustif. Les épisodes présentés ont marqué l’Histoire et nos propres existences. Des images ayant valeur de témoignage ont été utilisées en dépit de leur faible qualité technique. » (King – A Filmed Record)
Co-réalisé par Joseph L. Mankiewicz sous la direction de producteur Ely Landau, King est un film documentaire (65) qui porte aux nues le Pasteur Martin Luther King. Comme le Prix Nobel qu’il reçut, le film se charge de lui statufier un oscar avec une figure récurrente, celle plus qu’emblématique de la statue d’Abraham Lincoln à Washington.
Même King, documentaire violent basé sur les archives d’époques et réalisé peu de temps après la mort du pasteur, est une sorte de film procès qui l’oppose à l’Amérique ségrégationniste blanche aux lois iniques et répressives. C’est aussi le film qui contre l’Amérique, dans sa reformulation pratique et scandaleuse de sa justice, avec les démonstrations passives du parti non violent d’un homme possédé par ses convictions religieuses et par sa foi en la justice américaine, la vraie, la plus juste.
« La liberté n’est jamais donnée de bonne grâce car l’oppresseur vous tient en son pouvoir et il s’y accroche. » (Martin Luther King).
Dans l’économie narrative relative aux archives utilisées, le film témoigne du génie de King par l’entremise de ses discours. King éprouve ces discours de deux manières afin de dégager leur force hypnotique et leur génie oratoire. D’une part, ces discours retranscrivent la photogénie du pasteur ainsi que de son éloquence verbale, via l’image et le son synchrones, afin que l’on puisse nous aussi témoigner, spectateurs, de son aura. Et d’autre part, ces discours sont dépourvus de leurs images, leur « préférant » celles contemporaines d’extrême violence des badauds américains racistes ou des policiers à l’encontre des membres du parti de King et de ceux qui suivraient la manifestation dont il est à l’origine. La voix de King s’insurge de par sa verve et résiste face à la violence montrée à l’image de son parti qu’il incarnait et permet au réalisateur d’éprouver l’homme face à l’Histoire. Rien n’y fait. King est désormais dans l’Histoire comme l’atteste le parti pris du film qui le statufie aux côtés de Lincoln dont la fameuse sculpture à Washington sert de leitmotiv visuel au film de la même manière que Ford le fit à la fin de Vers sa destinée. King est son double, son contre-champ et le montage réactualise les valeurs américaines que défendent les deux réalisateurs et à son insu.
« La seule voix qui puisse hâter l’abolition de l’esclavage est celle de l’homme qui engage par là sa propre liberté.
(…).
Sous un gouvernement qui emprisonne un seul être injustement, la juste place du juste est aussi la prison. (…). C’est là que l’esclave fugitif, que le prisonnier mexicain en liberté conditionnelle, que l’Indien venu plaider les torts subis par sa race, les trouveront ; en ce lieu séparé, plus libre et plus honorable, où l’État situe ceux qui ne sont pas avec lui, mais contre lui – la seule demeure d’un État esclave où l’homme libre puisse résider avec honneur. (…). Jetez votre vote, pas un simple bout de papier, mais toute votre influence. Une minorité est impuissante tant qu’elle se conforme à la majorité ; ce n’est du reste plus une minorité ; mais elle devient irrésistible quand elle la bloque de tout son poids. » (Henry David Thoreau, La désobéissance civile).
« L’homme qui a peur de mourir n’est pas libre » (Martin Luther King).
En 1967, Edouard de Laurot réalisa Black Liberation avec les discours de certains membres des Black Panthers et des images qui objectivaient leur riposte potentielle face au pouvoir blanc, mais qui déclinait surtout les mécanismes politiques servant à inférioriser l’homme de couleur et le réduire à néant, lui et toute sa culture. La violence du film était conceptuelle dans la mesure où il n’y avait pas encore d’archives ou d’images qui relevaient de cette violence à l’envers, effective dans ses cadrages contrastés de buildings capitalistes d’où l’acte de téléphoner pour des patrons blancs devient celui de lâcher des bombes. King, trois ans après, se servira de cette idée en détournant la violence à son encontre comme le Parti le fit contre l’Amérique ségrégationniste. L’énergie violente des Blancs se voit ainsi récupérer en force sourdre et que la voix de King va projeter pour encourager ses membres à plus de résistance encore et de détermination.
« La violence et l’injustice sont les armes des maîtres, mais pour ceux qui se révoltent les échecs sont des victoires. » (Frank Cassenti, La Chanson de Roland)
« Nous allons dire au pays : « Nous ne doutons pas de la victoire. » Quand le peuple s’engage pour une juste cause, qu’il est prêt à se sacrifier pour la justice, on ne l’arrête pas avant les cris de la victoire.
En ce qui concerne cette ordonnance illégale, nous disons à l’Amérique : « Sois fidèle à ce que tu as mis par écrit ».
Si je vivais en Chine ou même en Russie, je comprendrais peut-être ces ordonnances illégales, je comprendrais que l’on nie les droits garantis par le Premier Amendement, parce que nul ne s’est engagé à les respecter là-bas. Mais j’ai lu quelque part qu’il existe la liberté de réunion, j’ai lu quelque part qu’il existe la liberté de parole, j’ai lu quelque part qu’il existe la liberté de presse, j’ai lu quelque part que la grandeur de l’Amérique réside dans le droit de protester pour son droit. » (Martin Luther King).
Ce travail de montage rend bien compte des préoccupations de Lumet : sa fascination pour la volonté humaine quand elle porte les convictions ou la passion inébranlable d’un homme pour quelque chose. Et King, dans l’incarnation fantastique de la justice américaine qu’il représentait pour tout un peuple mixte, touche à l’exemplarité !
« Je ne laisserai pas d’argent derrière moi.
Je ne laisserai pas derrière moi une vie de luxe et de beauté.
Je ne veux laisser derrière moi qu’une vie de dévouement. » (Martin Luther King).
Equus (1977)
Un jeune homme, Alan Strang (Peter Firth), crève inexplicablement les yeux de six chevaux dans une écurie où il travaillait de jour auprès de son employeur Harry Dalton (Harry Andrews) et de la jolie Jill Mason (Jenny Agutter). Martin Dysart (Richard Burton), un psychanalyste de renom, tente de découvrir pourquoi. Mais plus il perce le mystère de l’acte de son patient, et plus celui-ci remet en question toute son existence aussi bien affective que professionnelle.
« On cherche tous une baleine blanche. Et quand on la trouve, la plupart du temps, elle nous tue. » (Burt Reynolds parlant de Moby Dick dans La Cité des dangers de Robert Aldrich).
Equus est un peu la version de Moby Dick, mais avec un cheval au lieu d’une baleine. La trame, trop littéraire (dans le sens apprêté qui trahit son appartenance théâtrale) du film enferme Lumet dans une vulgarisation démonstrative sur la psychiatrie offrant au cinéma une énième confrontation avec la psychanalyse freudienne. Trop de choses court-circuitent le film : le jeu outrancier des acteurs dépendant d’un sujet beaucoup trop complexe et ambitieux, la culture anglaise liée à ses tabous depuis la Reine Victoria, l’importance et le choc des croyances (de la mythologie grecque à la chrétienté) et l’impossibilité de l’homme de vivre en accord avec lui-même.
Mais accordons au film son audace principale : le cheval, non content d’être le substitut du Christ pour Alan Strang, est aussi le sexe de l’homme, de manière détournée et subversive. Il attaque ainsi le sujet de front : montrer comment la répression sexuelle d’une famille va déplacer la sexualité d’un jeune homme dans la seule chose qu’il a le droit d’aimer, Jésus !
« À la scène, c’était une véritable expérience poétique. Mais en fait, philosophiquement, je ne suis pas d’accord avec la pièce. Je suis très intéressé par la psychanalyse, pourtant je ne crois pas aux problèmes du Docteur Martin Dysart (Richard Burton). Peter Schaefer, l’auteur, homme merveilleux et remarquable écrivain, n’avait jamais été satisfait des films tirés de ses œuvres. Il m’a demandé de tourner Equus, ce que j’ai fait pour lui. Il connaissait mes désaccords. Nous avons travaillé ensemble à l’adaptation. Le film me laisse insatisfait, mais ce fut une expérience enrichissante, car ce fut la première fois que je me suis éloigné du réalisme. Mais dans mon travail avec les scénaristes et les acteurs, je me sers toujours de la psychanalyse pour découvrir le sous-texte, ce qui n’est pas dit, ce qui est signifié par rapport à ce qui est proféré. C’est évident dans Le Prince de New York : quand Daniel a décidé de passer du côté de l’administration, du pouvoir, il recommence à porter une croix, ce qu’il ne faisait pas au début. J’aime ces petits détails, que souvent l’on ne remarque pas, mais qui ont beaucoup de signification. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).
Malgré ses défauts, Equus utilise l’enquête policière psychanalytique et freudienne pour expliquer un acte grave et violent afin de pointer les travers culturels de la civilisation occidentale. Cette dernière a tissé des liens des plus ambigus entre la sexualité et le canon christique (dans les peintures du Moyen Age, il est le référent corporel par excellence avec Saint Sébastien entre autres). Par extension, on peut dire que le référent physique masculin et sexuel de la civilisation occidentale est le Christ !
Lors des flashes back du jeune homme qui se « confesse » au psychiatre, les scènes relatées sont souvent nocturnes et permettent une photographie spécifique rappelant celle de Gerry Fisher pour The Offence. Le halo blanc de la lune de Equus s’est substitué au spot qui représentaient les instances policières et célestes en cours de jugement de The Offence ! En effet, Alan Strang chevauche nu sur l’animal dans une clairière pour jouir ! Dès le moment où il éjacule, l’image se fige et la silhouette du jeune homme se fait dissoudre par la lumière « spermeuse » de la lune en arrière-fond.
La surveillance « généralisée » hante Lumet, quelle soit technique et humaine (Le Gang Anderson, Le Prince de New York), ou simplement sacrée et divine (The Offence, Equus), elle dégage chez lui un sentiment claustrophobe, emprunt d’un caractère existentiel quasi bergmanien, qui justifie souvent le dispositif théâtral dans l’adaptation d’une pièce et d’un espace réduit à investir (que permet le huis-clos). Alan aveugle les chevaux parce qu’il est honteux : ils l’ont vu étreindre son amie, et comme il l’affirme lui-même à son psychiatre, la divinité est jalouse et cruelle. La surveillance divine qu’il a substituée aux chevaux l’empêche donc littéralement de jouir !
Lumet montre combien il est dangereux de détourner la sexualité de son objet. Et la perversité dans l’éducation religieuse de conférer à la matière charnelle une spiritualité sacrée avant même l’expérience sexuelle. Substituer la Chair à la question spirituelle chez un enfant est grave d’autant plus que la perception du monde par celui-ci s’en voit dénaturé puisqu’elle découle forcément de la question sexuelle.
Le film montre la psychanalyse comme un instrument chirurgical qui prélève l’âme de l’enfant ou de l’adulte et le psychiatre comme la nouvelle figure sociale autoritaire qui dénude les gens et aseptise leur personnalité. Lumet remet en cause la psychanalyse aujourd’hui : elle s’est éloignée de sa révolution sociale de ses débuts avec Freud. Balzac parlait du journalisme comme la nouvelle religion des temps modernes, mais c’était sans compter sur la psychanalyse qui l’a supplantée aujourd’hui.
« Bien. Ce qui est normal, c’est un beau sourire d’enfant. C’est aussi le regard vide de millions d’adultes, qui subit et tue à la fois, comme un Dieu. L’ordinaire devient beau, mais la norme devient meurtrière. Si la norme est l’indispensable, la criminelle déesse de la santé, alors je suis son prêtre. » (Equus)
Equus, c’est un peu L’Exorciste (1973) où la folie n’est qu’une révélation, une « apocalypse » de plus qui procède par contamination. Martin Dysart est possédé par Alan Strang et sa folie lui correspond dans ce grand saut sur les dérives de l’éducation occidentale à laquelle personne ne peut échapper vraiment. Il est proche aussi de L’Exorciste dans la mesure où le prêtre comme le psychiatre en viennent à perdre leur foi en leur fonction lors de leur rencontre avec une jeune personne qui va tout remettre en question. L’horreur est dans la révélation inacceptable de leur condition terrestre immanente et celle-ci remet en question trop de choses pour eux.
« Apokaluptô fut sans doute un bon mot pour gala. Apokaluptô, je découvre, je dévoile, je révèle la chose qui peut être une partie du corps, la tête ou les yeux, une partie secrète, le sexe ou quoi que ce soit de caché, un secret, la chose à dissimuler, une chose qui ne se montre ni ne se dit, se signifie peut-être mais ne peut ou ne doit pas être livrée d’abord à l’évidence. Apokekalummenoi logoi, ce sont des propos indécents. Il y va donc du secret et des pudenda.
La langue grecque se montre ici hospitalière au gala hébreu. Comme le rappelle André Chouraqui dans son bref Liminaire pour l’Apocalypse johannique dont il a proposé récemment une nouvelle traduction, le mot de gala revient plus de cent fois dans la Bible hébraïque. Et il semble dire en effet l’apokalupsis, le découvrement, le dévoilement, le voile levé sur la chose : d’abord, si on peut dire, le sexe de l’homme ou de la femme, mais aussi les yeux ou les oreilles. Chouraqui précise qu’ « on découvre l’oreille de quelqu’un en soulevant les cheveux ou le voile qui la recouvre pour y chuchoter un secret, une parole aussi cachée que le sexe d’une personne. » (Jacques Derida, D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie)
Alan renvoie le psychiatre à sa folie conforme, à sa fonction de spectateur qui regarde et écoute. Alan le nargue de cette passion pour les chevaux, aussi destructrice soit-elle. Elle est salvatrice pour une âme contrite dès le plus jeune âge.
« J’ai aidé des enfants sincèrement, dans ce cabinet. J’ai chassé des peurs par la parole, et soulagé bien des angoisses. Mais il est clair que je les ai amputés de parties de leur individualité qui répugnaient au dieu Normal, sous tous ses aspects. » (Equus)
Il y a presque une relation d’âges et d’admiration entre le père potentiel Martin Dysart et le jeune homme que dans Mort à Venise. Les deux jeunes hommes y incarnent une passion et, Bogarde et Burton, les deux hommes d’âge mûr et impuissants qui la projettent (66) !
Burton en vient même à souffrir du symptôme occidental d’être lui aussi à plaindre : il n’a pas fait l’expérience de ce genre de douleur qu’il envie à Alan car elle suit une passion des plus intenses que l’on peut vivre.
La religion chrétienne est l’une des plus perverses qui soient car elle domine le croyant par la soumission, le martyr, la complaisance et le rabaissement de soi.
« Sa technique (à la religion) consiste à rabaisser la valeur de la vie et à déformer de façon délirante l’image du monde réel, ce qui présuppose l’intimidation de l’intelligence. À ce prix, par fixation violente d’un infantilisme psychique et inclusion dans un délire de masse, la religion réussit à épargner à de nombreux hommes la névrose individuelle. (…). Lorsque le croyant se trouve finalement obligé de parler « des décrets insondables » de Dieu, il avoue ainsi qu’il ne lui reste, dans la souffrance, comme ultime possibilité de réconfort et source de plaisir, que la soumission sans condition. Et s’il est prêt à cette soumission, il aurait vraisemblablement pu s’épargner le détour. » (Freud, Le malaise dans la culture)
Equus collecte toutes les analogies possibles entre « Equus » et « Jesus » qui, phonétiquement, ne sont pas très éloignés (ainsi que « Sexus » d’ailleurs). Par exemple, Alan aveugle le regard castrateur d’ « Equus » (via les chevaux) et dans une certaine mesure il va le crucifier (les yeux à l’instar des mains) avant de constater l’icône achevée et religieuse de celui-ci, coupable de sa force corruptrice divine qui l’a perdu, lui et sa découverte de soi comme de l’autre sexe ! Le film insiste également sur leur parenté (Jesus / Equus) avec l’étable / écurie qui renvoie à la « Nativité » et au calvaire christique pour les péchés du monde avec ses chaînes et son dos ensanglanté par le fouet des Romains. Ils sont ici substitués par la cravache et le mors du cheval.
« Ce qui différencie les païens de nous, c’est qu’à l’origine de toutes leurs croyances, il y a un terrible effort pour ne pas penser en hommes, pour garder le contact avec la création entière, c’est-à-dire avec la divinité. » (Antonin Artaud cité en exergue du Rôti de Satan de Fassbinder).
Pour finir, Lumet se livre avec ce film insolite, mais pas forcément représentatif de son cinéma, à une auto-critique sur le métier de cinéaste. Dysart prenant en otage son spectateur par l’entremise du regard caméra et du fait même qu’il nous raconte son histoire, il est son propre narrateur, renvoie au metteur en scène et à ses doutes. Le film confirme également le talent de Lumet dans son rapport au temps. En l’occurrence, ici, Dysart s’y est perdu comme Johnson dans The Offence. Les « flash back » sont chez lui déterminants pour représenter les dérives de son personnage égaré entre deux lieux et deux temps et le film doit opérer les connexions suffisantes pour qu’ils se raccordent enfin (Le Prêteur sur gages, The Offence, Serpico, Equus, Daniel) ou non.
À noter également que le dispositif scénique du film, confrontant le psychiatre à son patient, renvoie à la relation professionnelle et affective entre un metteur en scène et sa vedette qu’il fait répéter pour incarner son rôle à la perfection. La voix off et « in » ne cessant de s’alterner entre le présent et une réalité passée et le montage qui court-circuite le corps du jeune homme dans le va-et-vient de l’un à l’autre (il interprète par exemple l’enfant qu’il était avec son corps d’adulte) révèle la schizophrénie nécessaire créée par l’acteur (67). Le metteur en scène et le psychiatre réalisent même, pour leur « client », un psychodrame (68) !
Le metteur en scène glisse même dans Equus un regard ironique et critique sur la perception de l’individu dans une salle de cinéma et raccorde les liens entre sa passion (pour mieux l’éprouver comme la psychanalyse pour Dysart) et la dévotion religieuse :
« Tout le monde avait le regard fixe, comme dans une église. On aurait dit une congrégation secrète. Comme les Chrétiens dont ma mère parle, ceux qui se réunissaient dans des grottes. »
« Qu’y a-t-il de plus ignoble que de retirer à quelqu’un l’objet de sa vénération ? (…). Je sais seulement que c’est toute sa vie. Qu’a-t-il d’autre ? » (Equus de Sidney Lumet)
« Qui possède science et art
a aussi de la religion ;
Qui ne possède ni l’un ni l’autre,
qu’il ait de la religion ! » (Goethe, dans les « Xénies apprivoisées », IX (Poésies posthumes), cité par Freud dans Le malaise dans la culture).
The Wiz (1978)
« J’ai toujours adoré les comédies musicales et je voulais depuis longtemps en réaliser une. J’ai « ouvert » la pièce car une distribution entièrement noire impliquait naturellement un décor urbain et non campagnard comme l’histoire originale du Magicien d’Oz. Pour moi c’est un film sur la connaissance de soi-même et le dernier air, c’est There’s no place like home. J’ai voulu que l’histoire de Dorothy soit l’odyssée d’une jeune noire qui hésitait à franchir la 125e Rue, la frontière de Harlem, et qui découvre New York. Ce qui m’intéressait aussi, c’était le mélange de réalisme et d’imaginaire, bien que je ne l’ai pas réussi. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).
Remake du Magicien d’Oz d’après L. Frank Baum et réactualisé par Joel Schumacher au scénario, The Wiz bénéficie de Dede Allen au montage (Serpico, Un après-midi de chien), de Rob Cohen à la production, d’Albert Whitlock pour les effets spéciaux liés aux « matte shots », de Stan Winston pour les maquillages, de la musique de Charlie Smalls supervisée par Quincy Jones, et enfin d’un casting prestigieux puisqu’il comprend Diana Ross, Michael Jackson, Lena Horne ou Richard Pryor pour ne citer qu’eux.
The Wiz (1978) ne cesse d’inverser l’imaginaire blanc qui se rattache à la minorité noire américaine. Dès l’ouverture du film, sa protagoniste Dorothy (Diana Ross), une jeune femme un peu nunuche, est terrorisée à l’idée de sortir de Harlem, ce qui permet à Lumet d’inverser complètement la diabolisation du quartier noir par les blancs. Dans The Wiz, c’est ce qui est autour du quartier noir qui est menaçant, terrifiant. Lumet et Schumacher intervertissent la violence traditionnelle liée aux communautés bigotes qui préfèrent s’autogérer que de fréquenter les autres communautés avoisinantes (69).
Dès que l’héroïne arrive dans le monde imaginaire, elle libère les figures d’un graffiti qui prennent vie et s’animent en chœur. La malédiction que ces « dessins » ont supporté jusqu’ici est intéressante parce qu’elle renvoie une fois de plus à l’imaginaire blanc (70) qui cristallise l’expressivité artistique et vindicative noire propre à la danse, au chant ou aux graffitis sur les murs. Ces graffitis sont souvent perçus comme des attentats sur leur personne, sur leur culture, sur leur bien-être social. The Wiz remet les choses à leur place et démonte l’absurdité d’un imaginaire sur un autre qui ne demande qu’à s’exprimer et sortir littéralement de ses gonds.
Malgré que ce soit l’imaginaire interne d’un personnage, le Monde d’Oz est certainement le refoulé collectif d’une minorité.
« Cet ami inconnu, c’est celui qui est toujours un peu absent, même à côté de moi, et toujours un peu présent. » (Journal, Réquichot)
Dorothy va ensuite rencontrer trois personnages emblématiques à qui il manque un sens, un organe ou un sentiment, mais dont le point commun fédérateur, et significatif, est celui d’être « mal dans leur peau ». Ils déclinent également les complexes de Dorothy avec lesquels elle va se familiariser pour mieux vivre. Le premier est « Scarecrow » (« L’Épouvantail » est interprété par Michael Jackson) à qui il manque un cerveau. Le deuxième est « Tinman » (Nipsey Russell) à qui il manque un cœur. Le troisième est « Lion » à qui il manque du courage.
Dès sa première rencontre avec « Scarecrow », on assiste avec Dorothy à un lynchage verbal de la part de corbeaux qui l’encouragent à penser ainsi : l’issue de la vie est fataliste et le monde ne laisse aucune chance. Les corbeaux ont souvent représenté la communauté noire, de Walt Disney (Dumbo de Ben Sharpsteen en 1941) dans la version classique de ce stéréotype à Robert Crumb (Fritz The Cat de Ralph Bakshi en 1972) dans sa version subversive. Ici, le cliché est réemployé pour exhumer la violence morale de ce qu’il représente dans la mesure où les corbeaux se rattachent aux contes (où souvent ils picorent les yeux des humains), à ce qui relève du groupe dans sa forme la plus impersonnelle (ils apparaissent souvent à plusieurs comme les oiseaux) et à l’animal lui-même, menaçant, agressif.
Les corbeaux représentent donc, dans The Wiz, la pensée négative, les monstres internes des Noirs hérités de la violence blanche à leur égard, le mal-être individuel fataliste et défaitiste. En somme, ce sont les Noirs brimés par l’imagerie que les Blancs ont d’eux. Les Noirs combattent alors leur propre image, une image déformée, péjorative, anamorphosée. Et pour la rétablir, il faut attendre que les moments dansés et chantés « fissurent » les cicatrices personnelles qui, ouvertes, laissent échapper leur révolte intérieure, trop longtemps refoulée de génération en génération.
« Time, be my friend
Let me start again » (The Wiz de Sidney Lumet)
Le film s’amuse à visualiser toutes les images péjoratives et racistes et les décline pour mieux les épuiser et les renvoyer à leur non-sens (le cerveau de Jackson est littéralement des « ordures », c’est-à-dire du papier déchiqueté, mais sur lequel sont notées des citations utiles).
Le film parachève son imagerie inversée avec Oz lui-même (Richard Pryor), faux magicien qui invente des modes vestimentaires ou les change afin d’avoir plus de poids et d’influence sur le peuple qu’il domine. Pryor incarne ce tyran pathétique qui s’avère être l’homme le plus malheureux et le plus seul au monde, angoissé par la destitution de son pouvoir. Il incarne l’homme de pouvoir dépendant et esclave de son statut éphémère.
« Il n’est point de repos pour les fronts couronnés » (Shakespeare cité dans The Wiz)
The Wiz se termine sur la moralité suivante : le monde est en nous comme à l’extérieur, c’est pourquoi, il faut ouvrir sa perception sur celui-ci pour s’en voir grandit. Moralité qui, malgré toutes les problématiques critiques ingénieuses du film n’échappent pas à la dimension mièvre de son sujet de prime abord, ce qui rappelle L’Oiseau bleu (1976) de George Cukor d’après Maurice Maeterlinck, tous deux victimes de leurs bonnes intentions. Dans The Wiz, c’est peut-être que le hors-champ « blanc » n’existe pas et donc que le « combat » n’a pas lieu entre une culture retrouvée et une culture dominante. Et je suis convaincu que le cinéma doit se définir par l’un de ces paramètres narratifs qui lui est essentiel, la Rencontre.
« – Chez moi ? En moi ? Je ne comprends pas.
– Chacun doit trouver son chez-soi. Ce n’est pas juste l’endroit où l’on dort et on mange. C’est la connaissance. La connaissance de son esprit. De son cœur. De son courage. Quand on se connaît, partout on est chez soi. » (The Wiz).
En guise de conclusion
LE CORRUPTEUR,
« I’m mad as hell and I’m not going to take it anymore » (Network)
« Nous ne sommes rien ; c’est ce que nous cherchons qui est tout » (Hölderlin, Fragment Thalia).
« Il y a plus d’hommes ennoblis par l’étude que par la nature » (Cicéron cité dans The Wiz de Sidney Lumet)
De ces fictions « morales », un idéal se distingue, mais il appartient pleinement au cinéma et Lumet ne le sait que trop bien. Cet idéal est l’incarnation humaine d’une pensée en gestation permanente. C’est l’homme débarrassé de ses habitudes conformistes ou de ses traditions les plus rétrogrades, de ses préjugés sociaux issus de son éducation.
Trop théâtrale ? L’œuvre de Sidney Lumet a pourtant décliné et littéralement éclaté les unités de temps et de lieu, paramètres didactiques affiliés à une définition du cinéma (propre à la critique de cinéma) à défaut d’une autre.
Le rapport au temps chez lui est toujours inspiré. Les magnifiques flashes back, de ses protagonistes, qui parsèment son œuvre en témoignent. Ses « héros » le remontent pour changer et s’extirper d’une vie cyclique et monotone (The Offence), ou traumatique (Le Prêteur sur gages, Equus, Daniel). Ils ne cessent de le défier, invitant le cinéaste à faire une introspection sur son rapport vital au cinéma dans ce Temps que conjuguent ses expériences (théâtrales) et ses souvenirs (de sa famille à la ville de New York).
La relation au lieu est toujours déterminante. Ses « héros » se battent pour s’affranchir du lieu affectif ou quotidien (Serpico, The Wiz), ou inversement, du lieu « événementiel » auquel ils sont rattachés bien malgré eux (La Colline des hommes perdus, Un après-midi de chien).
« Le vrai degré de maturité d’un metteur en scène réside dans sa capacité de choisir ce qui est le meilleur pour l’ensemble plutôt que dans sa prétention de faire de l’œuvre la parfaite expression de son propre ego. » (Cahiers du Cinéma, « Le point de vue du metteur en scène » par Sidney Lumet)
Enfin, c’est une œuvre imprégnée de la question du doute. Grâce à lui, le réalisateur s’immisce dans la psyché et l’âme humaines. En effet, le doute est insupportable, on l’a bien vu, il détruit tous les acquis aussi bien cognitifs que matériels. En somme, le doute livre l’homme à son dépouillement existentiel le plus complet, le plus honteux, le plus inacceptable pour sa condition, déjà sous l’emprise sociale et politique qu’il s’est créé, en plus de l’emprise divine.
La vie, pour Lumet, est comme un long procès (Douze hommes en colère, Le Verdict, Jugez-moi coupable) et nous en sommes tous les acteurs accidentels ou « providentiels » dont la culpabilité ne relève pas de la faute exemplaire, mais elle est immanente à notre rapport à soi ou à l’autre (Point Limite), rapport à parfaire continuellement.
« M. le Président, mesdames et messieurs les jurés. Il est terrible d’avoir à juger. Ça implique tant de choses. Je sais que vous vous êtes dit : « Comment puis-je être pur ? » « Comment puis-je être impartial, sans être froid ? » « Comment puis-je être clément, tout en étant juste ? » Je sais que certains d’entre vous ont prié pour pouvoir juger sans faille. » (Paul Newman dans Le Verdict).
Il n’est pas étonnant que Lumet ait souhaité pendant longtemps adapter le roman de James Jones, The Thin Red Line. À n’en pas « douter » quand on voit la géniale adaptation de Terrence Malick (1998), film dans lequel un personnage se parle à lui-même et dit :
« Quel est cet endroit où nous étions ensemble ? Qui sont ceux avec qui j’ai vécu ? Ceux avec qui j’ai marché ? Le frère. L’ami. Des ténèbres à la lumière. Des conflits à l’amour. Sont-ils le fruit d’un même esprit ? Les traits d’un même visage ? Oh, mon âme, laisse-moi pénétrer en toi. Regarde à travers mes yeux. Regarde les choses que tu as créées. Toutes resplendissantes. »
« Je ne me rappelle plus exactement mais pour Le prince de New York, j’ai dû avoir 600 plans. Chacun devait avoir la couleur ou la tonalité la plus parfaite et devait appartenir, à un moment donné à un tout.
C’est pour cela que je compare la fabrication des films à celle d’une mosaïque. Cela m’est apparu comme une révélation (je ne parle pas de révélation religieuse !). Je reviens de Venise, précisément de l’île de Torcello : là-bas il y a une mosaïque dans une église, personne ne sait qui l’a signée, mais c’est un génie. Elle occupe la moitié d’un dôme. C’est une mosaïque horizontale de dix ou onze siècles. La madone qu’il peignit est bleue ! Mais le bleu et l’or forment une association très laide ! Son visage est si pâle. Il n’est pas du tout de couleur chair. Elle tient un bébé dans ses bras. Et cette figure verticale dans cet espace horizontal, avec ces deux couleurs qui ne vont pas ensemble, c’est pour moi l’une des plus grandes œuvres que j’ai jamais vues. À chaque fois que je vais à Venise, je vais l’admirer. Il n’a pas seulement réalisé un chef d’œuvre : parce que c’est une mosaïque, il ne pouvait pas anticiper la qualité de ce travail avant de le terminer. Quel courage d’avoir fait cela, car aucun esprit ne pouvait anticiper un tel chef d’œuvre. Il ne pouvait pas le dessiner parce que la forme est en trois dimensions : c’est un dôme ! Il doit y avoir 10 000 carreaux. Je compare toujours tout cela à des films. » (Sidney Lumet interviewé par Bernard Payen, Objectif Cinéma, 2005).
Le cinéma de Lumet procède par dépouillement. Il dépouille l’individu de son enveloppe social et des préjugés qui s’y rattachent. Son cinéma dépouille l’homme de tout ce qui encombre sa morale. C’est un cinéaste qui par l’artifice, la simulation, est peut-être l’un de ceux qui s’est paradoxalement le plus rapproché d’une certaine réalité.
Dans ses thématiques « américaines », a réussi a crée un univers « personnalisé » non seulement libéré du joug post hitchockien, mais aussi des parti pris formels ou narratifs sans équivoque du cinéma hollywoodien. En effet, son cinéma ne cesse de douter et de questionner une réalité de plus en plus limitée, de plus en plus carcérale.
« Pour moi, le travail essentiel du metteur en scène est de dégager un point de vue. Le point de vue peut être erroné, insuffisant, contourné, mais le job du metteur en scène est de s’assurer qu’il y a bien un point de vue. Où trouverons-nous le point de vue ? Quel point de vue adoptons-nous ? Dans quelle mesure est-il nôtre ? Dans quelle mesure vient-il d’autrui ? Et, une fois que nous avons un point de vue, comment l’objectivons-nous à l’écran ? (…). Considérée sous cet angle, l’émission Paper Box Kid, une des plus excitantes de la série Danger, n’était pas l’histoire d’un simple esprit qui aime à fanfaronner, se trouve impliqué dans un hold-up et fait échouer le hold-up par sa bêtise, puis, afin de prouver son courage, se laisse mener à la chaise électrique sans un cri de protestation. L’intrigue n’était que secondaire par rapport au thème central de l’histoire. Paper Box Kid avait pour histoire la terrifiante nécessité où se trouve un individu d’appartenir à quelque chose. On peut expliciter cette donnée au travers d’intrigues diverses. » (Cahiers du Cinéma, « Le point de vue du metteur en scène » par Sidney Lumet)
DEREK WOOLFENDEN. AOÛT 2007.
Traductions (extraits) : Marc Ulrich.
NOTES :
(1) Mais aussi Reginald Rose, Sidney Buchman, Paul Dehn, Gore Vidal, Waldo Salt, Peter Shaffer, Jay Presson Allen ou encore David Rayfield.
(2) « Lumet a commencé à réaliser des films de fiction dix ans avant Allen, Brooks ou Mazursky. Tandis que des brusques changements dans les modes de vie et la conscience ethnique accrue des années 60 ont permis à ces derniers de se concentrer sur des problématiques sociales, Lumet a entamé sa carrière de réalisateur à une époque où la répression et le conformisme étaient plus forts, dans la vision myope et la brutalité ethnique caractéristiques des années 50. » (American-Jewish filmakers : Traditions and Trends, « Sidney Lumet : The Memory of Guilt », David Desser and Lester D. Friedman, Chicago, University of Illinois Press, 1993).
(3) « (…). Ce fut un événement car c’était l’intrusion de la poésie dans un théâtre dominé par le réalisme. » (Entretien avec Sidney Lumet mené par Michel Ciment, Positif, n° 251, février 1982).
(4) « On en restait toujours à la tradition réaliste dans laquelle nous excellions tous. Je voulais m’essayer à des gammes différentes, jouer Ostrovsky, Sheridan, Farquhar, et non mettre en scène pour la énième fois Waiting For Lefty et tout le théâtre social des années 30. » (Entretien avec Sidney Lumet mené par Michel Ciment, Positif, n° 251, février 1982).
(5) « Pendant deux ou trois mois on faisait du théâtre réaliste moderne qui était ce que nous connaissions le mieux, afin d’établir un vocabulaire commun de base. Puis on remontait en arrière vers Tchekhov et Ibsen et leurs opposés, Shaw et Wilde, ensuite la comédie de la restauration, puis les comédies de Shakespeare, ses drames et enfin les tragiques grecs. Chaque étape requérait un style et une technique totalement différents. Nous avons engagé Anthony Tudor, le chorégraphe anglais, pour donner des leçons d’exercices corporels, et Marianne Rich pour nous apprendre l’entraînement vocal. Comme il n’y avait personne pour diriger les scènes sur lesquelles nous travaillions, je me suis jeté à l’eau et j’ai commencé à faire de la mise en scène de théâtre. » (Entretien avec Sidney Lumet mené par Michel Ciment, Positif, n° 251, février 1982).
(6) « Au début de la télévision, quand l’école du réalisme social (« kitchen sink », ndt.) était prédominante, il y avait toujours un moment où il fallait « expliquer » le personnage. Aux deux tiers du film, quelqu’un exprimait la vérité psychologique qui avait fait du personnage la personne qu’il était. Chayefsky et moi appelions ça l’école du « canard en plastique » (« rubber-ducky ») : « Un jour, on lui a pris son canard en plastique, et c’est la raison pour laquelle c’est devenu un tueur psychopathe. » C’était la mode à l’époque, et ça l’est encore pour beaucoup de studios et de producteurs. » (Sidney Lumet, Making Movies).
(7) À la C.B.S., il participa à la série Danger avant de participer à cette émission. « L’émission You Are There consistait à « couvrir » des événements historiques selon la technique des actualités et avec la collaboration des journaux télévisés de la chaîne. Par exemple des correspondants filmaient la mort de Jeanne d’Arc sur le bûcher, l’assassinat de Jules César, Washington à Valley Forge, l’empoisonnement de Socrate, le meurtre de Lincoln. Cela semble naïf, c’était passionnant. Et tous les textes interprétés par des acteurs inconnus comme James Dean ou Paul Newman) étaient écrits spécialement pour l’émission par des gens comme Paddy Chayefsky (Network) et Reginald Rose (Douze hommes en colère). (…). J’avais des affinités particulières avec certains scénaristes et nous travaillions souvent ensemble. Ainsi Walter Bernstein (Fail-Safe) et Abe Polonsky qui étaient sur la Liste noire et ont écrit sous des prête-nom la plupart des émissions de la série You Are There. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).
(8) « En 1955, le grand succès du film de Daniel Mann, Marty, modeste production inspirée des standards du petit écran et soucieuse de plus de réalisme, lance la carrière cinématographique de réalisateurs de télévision comme Sidney Lumet. » (Programme de la Cinémathèque française, septembre-novembre 2007, Visages de Christs en pleurs de Bernard Benoliel et Jean-François Rauger, article écrit à l’occasion de l’hommage au réalisateur).
(9) Rappelons que cette interview date de la sortie en France du Prince de New York (février 1982). Il a donc tourné à Hollywood depuis.
(10) La facture du film est volontairement nostalgique, désuet comme l’atteste l’éclairage du film (Geoffrey Unsworth) ou la musique (Richard Rodney Bennett). Les vedettes du film sont Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Sean Connery, John Gielgud, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Richard Widmark, Michael York, Wendy Hiller, Rachel Roberts ou encore Jean-Pierre Cassel ! Dans les années 70, ces grandes réunions d’acteurs furent assez nombreuses grâce à l’âge d’or du film catastrophe (Airport de George Seaton en 1970, L’Aventure du Poséidon de Ronald Neame en 1972, mais surtout La Tour infernale de John Guillermin et Tremblement de terre de Mark Robson réalisés en 1974, la même année que le film de Lumet).
(11) « Pour quelqu’un comme moi, porté à l’introversion, il est important, tous les quatre ou cinq films, de tourner simplement une histoire pleine d’action, pour le plaisir. Mon film, DeathTrap, est dans cette lignée, une intrigue criminelle très serrée, l’une des meilleures que j’ai lues, d’après une pièce de Broadway. Tout, encore une fois, se passe dans un lieu clos après une première séquence dans un théâtre. Pour moi, ce sont des films (et j’y inclus Le Crime de l’Orient Express) qui sont l’équivalent des barres parallèles pour un gymnaste. On y exerce et entretient sa technique. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).
(12) « Stanford Meisner était l’un des meilleurs professeurs d’art dramatique de mon époque. Avec ses élèves débutants, il passait le premier mois, ou les six premières semaines, à leur apprendre à vraiment se parler et s’écouter les uns les autres. Juste ça. C’est le grand dénominateur commun de tous les styles et de toutes les techniques de jeu. » (Sidney Lumet, Making Movies).
(13) « Est-ce que des montagnes de préparation tuent la spontanéité ? Absolument pas. J’ai même appris que c’était le contraire. Quand on sait ce qu’on fait, on se sent bien plus libre d’improviser. (…). Répéter les séquences du début à la fin permet aux acteurs de sentir la progression, l’évolution de leur personnage. De cette manière, quand on commence à tourner, ils savent exactement où ils en sont, quel que soit l’ordre dans lequel on tourne les scènes. Quelqu’un a demandé à Howard Hawks quel était l’élément le plus important dans la performance d’un acteur. « La confiance », a-t-il répondu. En un sens, c’est vraiment ce qu’il se passe pendant les répétitions : les acteurs gagnent en confiance à mesure qu’ils dévoilent leur personnalité profonde. » (Sidney Lumet, Making Movies).
(14) « Dans Un Après-midi de chien, les improvisations ont fonctionné parce que je voulais que les acteurs se servent d’eux-mêmes plus que de leur personnage. En temps normal, j’utilise l’improvisation en tant que technique de jeu, et non pas comme une source de dialogues. Si un acteur a du mal à trouver la vérité émotionnelle d’une scène, l’improvisation peut s’avérer un outil précieux. Mais c’est à peu près tout. » (Sidney Lumet, Making Movies).
(15) « Mon boulot, c’est devenir ce dont l’acteur a besoin. Je travaille d’une façon avec Pacino, d’une autre avec Ralph Richardson, d’une autre avec Katherine Hepburn. C’est selon leurs besoins. Je suis un caméléon. » (Sydney Lumet, un cinéaste new-yorkais, Bonus du DVD de Serpico).
(16) « Comment enseigner la morale si ce n’est à travers la religion ? Je ne suis pas un homme de foi. Mais la morale ne peut être apprise qu’avec la religion. » (Fritz Lang dans Conversation entre Fritz Lang et William Friedkin, 1975).
(17) Il utilisa cette même influence pour Le Prêteur sur gages.
(18) Le directeur de la photo du film a été réalisé par Gerry Fisher (Accident de Joseph Losey, La Mouette de Sidney Lumet, Terreur aveugle de Richard Fleischer, Le Convoi sauvage de Richard C. Sarafian…).
(19) Il est sensible à ce genre d’idées depuis Douze hommes en colère quand le film, de l’histoire aux moyens techniques pour la raconter, dans un intérieur confine et oppressant, se libère enfin à l’extérieur du tribunal.
(20) Le film se compose d’une succession de courtes séquences qui aura certainement une nette influence sur le film de Richard Brooks, À la recherche de Mr Goodbar (1977).
(21) « Ce qui est vraiment passionnant avec ce sujet, c’est que si la justice ne fonctionne pas, rien d’autre ne peut fonctionner dans une démocratie. La seule confiance que l’on peut avoir est de ne pas être jugé arbitrairement, ou condamné arbitrairement, et que le système judiciaire soit irréprochable et le même pour tous quelque soit leur statut social. » (Bonus du DVD de Serpico, « Les coulisses du tournage par Sidney Lumet »).
(22) « Pour ce qui est de la musique sur Serpico, c’est une de ces histoires vraiment extraordinaires. Je ne voulais pas de musique. Et c’était le dernier film où je n’avais pas le « final cut ». Dino [De Laurentiis] voulait de la musique. J’avais peur que si on ne trouve pas un accord à ce sujet il prenne le film, rentre en Italie, engage Nino Rota et qu’il y ait de la musique du début jusqu’à la fin. 2 h 30 de musique.
Je ne me rappelle pas comment j’ai su que Theodorakis, un des plus grands compositeurs, sortait de prison une semaine après. Je lui ai dit : « J’ai un film et je pense que tu es disponible ». Je lui ai expliqué le conflit avec Dino De Laurentiis. « Et Dino sera tellement flatté que tu veuilles faire ce film, qu’on pourra faire ce que l’on veut. » » (Bonus DVD Serpico, « Les coulisses du tournage par Sidney Lumet »).
(23) Plus loin, il écrit, et c’est fort passionnant concernant Serpico (et comment ce dernier film fonctionne, avec espièglerie, en se servant des conventions narratives enclines à une morale plutôt traditionnelle) :
« Or, tout ce qu’il faut aux sociétés pour être cohérentes, c’est que leurs membres aient les yeux fixés sur un même but, se rencontrent dans une même foi ; mais il n’est nullement nécessaire que l’objet de cette foi commune ne se rattache par aucun lien aux natures individuelles. En définitive, l’individualisme ainsi entendu, c’est la glorification, non du moi, mais de l’individu en général. Il a pour ressort, non l’égoïsme, mais la sympathie pour tout ce qui est homme, une pitié plus large pour toutes les douleurs, pour toutes les misères humaines, un plus ardent besoin de les combattre et de les adoucir, une plus grande soif de justice. N’y a-t-il pas là de quoi faire communier toutes les bonnes volontés ?
(…).
Mais j’ai hâte d’en venir à la grande objection. Ce culte de l’homme a pour premier dogme l’autonomie de la raison et pour premier rite le libre examen. Or, dit-on, si toutes les opinions sont libres, par quel miracle seraient-elles harmoniques ?
(…).
Non seulement l’individualisme n’est pas l’anarchie, mais c’est désormais le seul système de croyances qui puisse assurer l’unité morale du pays. » (Émile Durkheim, L’individualisme et les intellectuels).
(24) « Je pense qu’il faut être plus proche de l’homme de la rue. À l’heure actuelle, nous sommes isolés, complètement en dehors du coup. Les inspecteurs sont toujours en imper et chapeau mou ! On les repère à 10 lieues. » (Serpico de Sidney Lumet). Au cours d’une soirée, il arrivera même à se faire accepter d’un milieu social relatif au monde du spectacle en se confrontant individuellement à chacun des membres et se révèlera un véritable caméléon s’adaptant aux besoins mondains de chaque individu.
(25) « Pour donner l’impression d’un film réaliste, il me fallait des acteurs réalistes. Il y en a beaucoup à New York. J’ai fait quelque chose d’inhabituel. Je ne l’ai d’ailleurs jamais refait. Pour leur première audition, j’ai dit : « Revenez dans 2 jours, et faites-moi un monologue de votre choix. » Il y avait 100 rôles avec des répliques. Je voulais que ce soit les acteurs qui m’indiquent quel rôle leur convenait. Ils ont choisi ce qu’ils voulaient. Je les regardais, si j’aimais leur travail. Je cherchais ce qui conviendrait. Je prenais la liste et les faisais revenir pour auditionner pour un rôle spécifique. Je ne leur avais jamais donné la liberté de choisir leur rôle. C’était une approche merveilleuse. Joy Todd était le directeur de casting, et j’ai dit : « Joy, voyons des non-acteurs. » Pour les 110 rôles à répliques, on a fini avec 50 personnes qui n’avaient jamais joué auparavant. J’avais prévu une longue période de répétition… car je savais que mélanger ces types d’acteurs, des débutants et des professionnels – Treat avait un beau parcours. Comme beaucoup d’autres acteurs – C’était important de ne pas voir la différence. Ils devaient venir du même monde. Je savais qu’il fallait du temps, pour ça. Ce qui a été merveilleux, c’est que les acteurs ont plus appris des non-acteurs que le contraire. Ils ont vu qu’il ne fallait pas sur-jouer. » (Sidney Lumet dans Prince of the City : The Real Story de Laurent Bouzereau, bonus DVD du film).
(26) « Un autre aspect important de l’objectif, c’est qu’il doit, tout en restant vraisemblable, pouvoir exercer sur l’acteur une certaine attraction et lui donner le désir de l’accomplir. Cette fascination est un défi à son sens créateur.
Nous appelons créateurs les objectifs qui réunissent ces qualités nécessaires. Ils sont difficiles à choisir. Les répétitions consistent en général à découvrir les objectifs justes, à les préciser et à les assimiler. » (Constantin Stanislavski, La formation de l’acteur).
(27) En effet, malgré la durée finale du film (au moins 3 heures), le film a été tourné dans 131 lieux de tournage !
(28) « Il fallait d’abord trouver quelqu’un pour Bob Leuci, et Danny Ciello, tout tournait autour de ça. J’avais vu Treat (Williams) dans le film de Milos Forman, Hair. Je l’avais trouvé merveilleux. Et, ce qui était essentiel, il avait… du charme. Aucun réalisateur ne peut donner du charme à un acteur. On l’a ou on ne l’a pas. » (Sidney Lumet dans Prince of the City : The Real Story de Laurent Bouzereau, bonus DVD du film).
(29) Ce personnage rappelle celui despotique de Brute Force (Jules Dassin, 1947) qu’incarnait Hume Cronyn (Capt. Munsey).
(30) Ce personnage de militaire n’est pas sans rappeler celui de Warren A. Black (Dan O’Herlihy), dans le film précédent de Lumet, Fail-safe (1964), de par le contre-emploi moral du personnage vis-à-vis du cliché social qu’il revêt et est censé représenter : « Son rôle est assez exceptionnel dans le sens où il est chef d’état-major général. Et son comportement, vous le verrez, n’a absolument rien du militaire. Ni vraiment un réactionnaire, ni vraiment de droite, il n’a vraiment rien des clichés du militaire. C’est tout à fait l’opposé, en fait. » (Commentaire audio de Sidney Lumet dans le DVD du film Point Limite, et à propos du personnage joué par Dan O’Herlihy).
(31) À qui l’on doit aussi le scénario de Luke la main froide (1967) de Stuart Rosenberg avec Paul Newman.
(32) « Dans Le Gang Anderson, il nous est donné de suivre la préparation d’un cambriolage par quelques sympathiques marginaux. L’opération avance, sans véritables heurts et même dans une certaine allégresse, au point que l’on peut croire un instant qu’il s’agit là de jouir du spectacle purement affirmatif de la subversion. C’est oublier que la modernité est fondamentalement déceptive : tout était écouté, filmé, cinématographié en somme ; convaincus d’évoluer en liberté, les bandits étaient en faits cadrés par la police, enfermés toujours déjà dans son champ de vision. Ils peuvent bien multiplier les acrobaties le jour venu, Lumet et les flics attendent au pied de l’immeuble de mettre fin à la farce quand bon leur semblera. Le cinéma consiste alors juste à prélever un peu d’inauthenticité à la surface du monde.
L’histoire de la société du spectacle vient à se boucler triomphalement dans le cinéma, toujours suspect d’une totale immersion dans le faux, soit que ses protagonistes se révèlent les pions d’un dispositif de vidéo surveillance (voir le terrible film-testament de Peckinpah, Osterman Week-End), soit que le monde lui-même devienne une chaîne de télé, un vidéodrome (du nom du film de Cronenberg) » (François Ramone, « L’Ange et la pourriture, à propos d’un doute qui vint au cinéma américain autour des années soixante-dix », Why Not ? sur le cinéma américain, sous la direction de Jean-Pierre Moussaron et Jean-Baptiste Thoret, Rouge Profond, 2002, p. 30).
(33) À qui l’on doit, entre autres, Mythes et Masques : Les fantômes de John Carpenter (co-écrit avec Luc Lagier, 1998), Massacre à la tronçonneuse, une expérience américaine du chaos (2000), l’ouvrage collectif sous sa direction et celle de Jean-Pierre Moussaron Why Not ? sur le cinéma américain (2002), 26 secondes, L’Amérique éclaboussée : L’assassinat de JFK et le cinéma américain (2003), Le Cinéma américain des années 70 (2006) ou encore les revues Simulacres (co-dirigé par Guy Astic) et Panic pour ne citer qu’eux.
(34) « Le monde actuel est une prison à ciel ouvert, avec ses procédures de contrôle : puissances de l’idéologie, écoutes téléphoniques, télé-surveillance (Dog Day Afternoon, Network, Power). Et l’enfermement, on le sait, impose sa propre mise en scène. Mise en scène contre mise en scène : d’un côté, celle des amateurs, bricoleurs sympathiques (Sean Connery dans The Anderson Tapes, Al Pacino dans Dog Day Afternoon). De l’autre, les professionnels, visibles ou invisibles (la mafia, l’État, Hollywood), détenteurs du vrai pouvoir, celui d’une mise en scène avec des moyens, spectaculaire. Et le pouvoir n’est rien d’autre que le pouvoir de sa mise en scène. De son côté et depuis cinquante ans, Sidney Lumet fait du cinéma pour reprendre la main idéalement, pour ne pas abandonner à l’Autre toute la mise en scène. » (Programme de la Cinémathèque française, septembre-novembre 2007, Visages de Christs en pleurs de Bernard Benoliel et Jean-François Rauger, article écrit à l’occasion de l’hommage au réalisateur).
(35) Deleuze écrit précédemment (p.281) : « Pour que les gens se supportent, eux-mêmes et le monde, il faut que la misère ait gagné l’intérieur des consciences, et que le dedans soit comme le dehors. C’est cette vision romantique et pessimiste qu’on retrouve chez Altman ou chez Lumet. »
(36) Au fil de sa carrière, il s’est entouré des grands noms de cette profession : Boris Kaufman, Franz Planer, Oswald Morris, Freddie Young, Gerry Fischer, Carlo Di Palma, James Wong Howe, Victor J. Kemper, Owen Roizman, Andrzej Bartkowiak.
(37) Celui-ci est interprété par Jack Warden qui joue également dans Douze hommes en colère (1957), That Kind of woman (1959), Bye Bye Braverman (1968) et L’Avocat du diable (1993) de Sidney Lumet.
(38) Cette séquence a été rajoutée par Lumet. Elle n’était pas dans le scénario écrit par David Mamet.
(39) « Certains diront que c’est l’histoire d’un procès, ce qui est faux. Que c’est une attaque contre l’Église catholique, ce qui est faux. Que c’est une attaque contre le monde hospitalier, ce qui est faux. C’est l’histoire de la réhabilitation d’un homme. » (Paul Newman dans une featurette du Verdict).
(40) D’autres films le prouvent : Le Procès Paradine (1947) d’Alfred Hitchcock, Condamné au silence (1955) et Autopsie d’un meurtre (1959) d’Otto Preminger, Témoin à charge (1957) de Billy Wilder, Le Sergent noir (1960) de John Ford.
(41) Les scènes de répétition des deux parties avec les avocats et leur témoin clé est très cocasse. On prépare son témoin, comme un comédien que l’on fait répéter pour apprendre son texte, non à dire la vérité, mais comment la dire. Et comment les paramètres sociologiques et raciaux sont évalués par les deux camps pour faire témoigner un témoin de couleur.
(42) Une magnifique scène du film montre Brennan intimidant et humiliant le policier chargé de l’enquête policière, aux côté de Al et de Chappie (Charles S. Dutton), Luis Valentin (interprété par le génial Luis Guzman) devant son fils à qui il ne lâche pas la main.
(43) David Greenhill affirme de se rendre à la Cour et d’assister aux procès parce que les prêtoirs sont moins chères que le cinéma !
(44) De cet aspect, le film rappelle l’originalité critique du remake des Nerfs à vif (1991) par Martin Scorsese où un avocat est sans scrupules pour l’inculpé qu’il est censé défendre, n’hésitant pas à l’accabler juridiquement en omettant des preuves et des droits pour qu’il purge sa peine sans appel. Mais surtout pour qu’il puisse garder sa bonne conscience derrière une moralité vertueuse à préserver par tous les moyens possibles et le déculpabilisant à première vue. Voir également L’Avocat du diable (1997) de Taylor Hackford ou encore les pratiques du personnage de James Mason dans The Verdict (1982).
(45) « Et peut-être que Tchekhov a été déterminant pour moi, je veux dire la préparation et le tournage de La Mouette. Tchekhov vous enseigne le sens du ridicule : dans certaines de nos aspirations, de nos illusions. Les personnages chez lui se trompent toujours, ils tombent amoureux au mauvais moment de la personne qu’il ne faut pas. Réaliser ce film m’a procuré certaines des émotions les plus fortes de ma vie. » (Entretien avec Sidney Lumet par Michel Ciment, Positif, n°251, février 1982).
(46) « J’avais besoin d’images de bombardiers. On peut les emprunter aux banques d’archives. On n’a rien obtenu du gouvernement. On est allés aux banques d’archives, qui conservent tout. Mais on n’a rien pu obtenir. Pas une seule image. L’avion qu’on voit dans ce film vient d’un plan qu’on a piraté. Les cinq avions qu’on voit décoller sont tous le même. Que le gouvernement refuse de coopérer, ça s’était déjà fait et ça s’est fait plus tard, mais qu’ils censurent aussi les banques, c’était extraordinaire. En conséquence, on a dépeint l’invasion de l’espace aérien russe d’une façon très simple, presque simpliste. Ces images ont été créées par deux grands animateurs, John et Faith Hubley qui les ont animées à la main. C’était la façon la plus simple et la moins chère de les dessiner. Il y avait un petit nuage blanc pour chaque cible touchée. Tout à coup, on a été poursuivis en justice. Stanley Kubrick préparait Dr Folamour, qui était tiré d’un roman, Red Alert. Et les auteurs de Red Alert, Stanley et la Columbia, ont poursuivi en justice les auteurs de Point Limite, deux professeurs, pour plagiat. (…). Les deux films étaient identiques en termes de scénario et opposés en termes de personnages, d’intention et de style. Columbia Pictures a acheté Point Limite pour l’empêcher de sortir. À sa sortie, le film a fait un bide. Comment y croire après la sortie de la version comique ? » (Sidney Lumet, Revisiting Fail-Safe, 2000).
(47) « Il y a dix gros plans sur des scènes de la vie ordinaire dans les rues de New York. Ce qui était important, c’est que les petites scènes de vie qu’on montrait prennent fin à cet instant. » (Sidney Lumet, Revisiting Fail-Safe, 2000)
(48) « Quand Johnson était candidat à la présidence en 64, il s’est assuré la victoire grâce à une publicité incroyable [où l’on voit une petite fille arrachant les pétales d’une fleur avant que son attention ne soit prise par le décompte d’un largage de bombe. L’image se fige. On s’avance dans le grain de l’image en arrêt et jusqu’au néant de l’œil droit de la petite fille]. L’élection de 1964 était très centrée là-dessus, Johnson soutenait que Goldwater était non seulement un belliciste, mais aussi un irresponsable. » (Sidney Lumet, Revisiting Fail-Safe, 2000).
(49) « Mais ce point de vue classique (à savoir la mise à jour de l’ « a-romantisme des années 50 » qu’incarne le motif familier du casse, du « coup »), développé à satiété dans les années cinquante-soixante, jusqu’à devenir un sujet de comédie, prend une résonance nouvelle : les braqueurs sont des amateurs d’une consternante maladresse, qui laisse augurer leur sort tragique ; leur tentative a lieu en plein jour et suscite chez ceux qui en sont les spectateurs une multitude de réactions contraires. Le film devient très vite l’histoire d’une collectivité aux prises avec un fait-divers. Le hold-up ouvre une brèche dans la banalité quotidienne, révèle la fragilité du tissu urbain, bouleverse l’ordonnance précaire de la ville, suscite le déploiement des media et des forces de police. L’irruption du regard collectif attise les tensions, héroïse l’acte criminel, le pare d’une aura magique, préparant le terrain à la police, qui l’écrasera dans le sang, et restaurera l’ordre quotidien dans sa trompeuse inertie. » (Olivier Eyquem, Positif, n°251, février 1982).
(50) On retrouvera cette analogie scandaleuse dans La Valse des Pantins (The King of Comedy, 1983) de Martin Scorsese et dans un dialogue de Piège Mortel (Deathtrap, 1982) de Lumet :
« On imprime tout, on montre tout. Ils s’en foutent, qui a fait quoi ou à qui. Ils veulent être au courant. Tu as tué ta femme, tout va bien. Tu peux violer tes gosses, empoisonner un puits, élever des chauve-souris ! Tant que tu passes à la télé pour en parler. Tu sais que j’ai raison. Tu connais des gens qui refusent d’aller à une fête où on peut rencontrer Nixon, Vesco, tous ces grands escrocs qui s’en sont tirés ? »
(51) « Ce film a moins de style extérieur que n’importe quel autre de mes films. Il existe une différence entre réalisme et naturalisme. Le réalisme, c’est du naturalisme édulcoré qui va dans une direction. Ici, j’ai vraiment essayé de faire un film naturaliste. (…). Le film ne devait pas être réaliste, mais naturaliste. Il fallait rester concentré là-dessus. Le film l’exprime dans la mesure où tout est très précis, malgré une impression d’improvisation. À aucun moment, on ne tombe dans le voyeurisme. On s’est demandé comment l’humaniser et ne pas verser dans le voyeurisme, sans oublier le problème. Il n’y a aucun intérêt à faire un film sur un braqueur qui retient neuf otages et le conclure par : « Il est comme vous et moi. » Il ne l’est pas. Comment montrer clairement le dilemme qui se pose humainement ? » (« Lumet : Film Maker », documentaire autour du tournage d’Un après-midi de chien).
(52) « Pour moi, le style doit être invisible. C’est quelque chose qu’on doit sentir. » (Sidney Lumet, Making Movies).
(53) « Prenant le titre du film au pied de la lettre, Pacino fait de Sonny Wortzik, laissé pour compte du rêve américain, gagne petit du crime, un « mad dog », un chien fou en perpétuel mouvement. L’arme à la main, la chemise débraillée, la bouche souvent béante, comme perpétuellement étonné de ce qui lui arrive, il court en tous sens et en vain, comme un animal piégé. » (Pacino-De Niro, Regards croisés, Michel Cieutat et Christian Viviani, Dreamland éditeur).
(54) « Pour Un après-midi de chien, l’acteur fit supprimer deux scènes du scénario (une scène de lit et celle du mariage en blanc – des « flashbacks » – afin de mieux recentrer l’action sur le moment présent) et imposa de la sorte son jeu improvisé pour la plupart des séquences avec son ami et comparse John Cazale, ainsi que celle avec Chris Sarandon au téléphone (c’est leurs propres dialogues que l’on entend), et d’autres avec les otages dans la banque. Influence interactive, car son metteur en scène, Sidney Lumet, alla pleinement dans son sens, puisque, pour la séquence où Sonny parle à ses « épouses » au téléphone, il filma Pacino une première fois avec deux caméras, quatorze minutes durant (la durée maximale de film chargé), puis, afin de pousser l’acteur dans ses plus profonds retranchements, lui demanda de recommencer. Ce que fit Pacino sans broncher, mais il termina cette seconde prise totalement épuisé et pleura (…), Lumet captant alors ses larmes et les intégrant dans son montage final. » (Pacino-De Niro, Regards croisés, Michel Cieutat et Christian Viviani, Dreamland éditeur).
(55) « Tu es une humanoïde. Si je reste, tu me détruiras. Comme Beale a été détruit. Comme Laureen Hobbs l’a été. Comme tout ce qui touche la TV est détruit ! Tu es la Télévision incarnée. Indifférente à la souffrance, insensible à la joie. Tu passes la vie au laminoir du cliché. La guerre, le meurtre, la mort, pour toi, ce sont des flashs publicitaires. La vie quotidienne, c’est une comédie pourrie. Tu brises même le temps et l’espace en fractions de seconde et en ralentis ! Tu es la folie. La folie virulente. Tout ce que tu touches meurt avec toi. » (Max Schumacher à Diane Christensen).
(56) « Network est le film jumeau de Rollerball. Il dresse les mêmes constats, possède une structure similaire et se situe lui aussi dans le monde des empires télévisuels. Howard Beale apparaît ainsi comme le pendant de Jonathan E. et ses diatribes quotidiennes articulent une rage populaire qu’il libère et canalise dans l’arène cathodique (voir cette séquence formidable où il enjoint ses télespectateurs à hurler en même temps à leurs fenêtres). Les films de Norman Jewison et de Sidney Lumet actualisent ainsi le processus de substitution fantastique imaginé par les body snatchers de Don Siegel. (…). Network produit une critique violente de l’évolution des médias et de la société américaine au milieu des années soixante-dix, mais constitue surtout un terrible pamphlet contre l’évolution de la contre-culture, devenue alors une image de marque, un label commercial vidé de tout contenu politique. Dès lors, les corporations n’ont même plus à neutraliser les énergies révolutionnaires – qui n’ont de révolutionnaire que les costumes, les accessoires et les slogans – mais détourner ceux qui s’en réclament définitivement au service du système.
Si la rébellion fut le moteur puissant du Nouvel Hollywood, la façon dont la révolte s’est peu à peu consommée, les raisons pour lesquelles la résistance a pu être assimilée et la contre-culture absorbée, constitue l’une des préoccupations centrales du cinéma américain des années soixante-dix. Après le scandale du Watergate, le thème devient même prédominant et traverse un vaste ensemble de films : À cause d’un assassinat, Nashville, Le Convoi, Point limite zéro, Shampoo, Blow Out et la plupart des films de Brian De Palma : « J’avais senti pendant la promotion de Greetings combien le style révolutionnaire était devenu un produit. Car le capitalisme s’y prend toujours de la même manière pour neutraliser une force contestataire, il la couvre d’or, du coup elle n’est plus du tout contestataire, et rentre dans le rang […]. L’idée que le système finit toujours par vous récupérer m’obsède, c’est l’une des forces cachées du capitalisme. » » (Jean-Baptiste Thoret, Le Cinéma américain des années 70).
« Cette ruse des tyrans d’abêtir leurs sujets n’a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens, après qu’il se fut emparé de leur capitale et qu’il eut pris pour captif Crésus, ce roi si riche. On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s’étaient révoltés. Il les eut bientôt réduits à l’obéissance. Mais ne voulant pas saccager une aussi belle ville ni être obligé d’y tenir une armée pour la maîtriser, il s’avisa d’un expédient admirable pour s’en assurer la possession. Il y établit des bordels, des tavernes et des jeux publics, et publia une ordonnance qui obligeait les citoyens à s’y rendre. Il se trouva si bien de cette garnison que, par la suite, il n’eut plus à tirer l’épée contre les Lydiens. Ces misérables s’amusèrent à inventer toutes sortes de jeux si bien que, de leur nom même, les Latins formèrent le mot par lequel ils désignaient ce que nous appelons passe-temps, qu’ils nommaient Ludi, par corruption de Lydi.
(…). Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements étaient ceux qu’employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous le joug. » (Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire).
(57) « Tu sais, Barbara… les Arabes vont augmenter leur pétrole de 20 %. La CIA s’est fait prendre en plein Sénat. Il y a une guerre civile en Angola, une autre au Liban. New York est au bord de la faillite. On a enfin arrêté Patricia Hearst. Et le Daily News fait toute sa une sur Howard Beale. Il a aussi deux colonnes à la une du Times. (…). C’est un cadeau ! Et ça ne se vire pas comme un pot de chambre ! Beale a parlé pour chaque Américain, en exprimant son ras-le-bol ! Il véhicule la colère populaire ! (…). Je vois Beale en prophète moderne, superbe figure messianique flétrissant notre hypocrisie ! Un Savonarole, du lundi au vendredi qui crèverait le plafond ! »
(58) J’ai décidé de vous retranscrire ses trois discours qui sont parmi les plus cyniques de l’histoire du cinéma :
« Bonsoir. Aujourd’hui, mercredi 24 septembre, vous me voyez pour la dernière fois. Hier je vous ai annoncé mon suicide à l’antenne. Un coup de folie, je l’avoue. Voilà ce qui m’a pris. J’étais à court de conneries. (…). La Connerie mène notre vie ! Si elle vient à manquer, reste toujours la Connerie-Dieu ! Nous ignorons pourquoi nous souffrons, pourrissons, mais quelqu’un doit bien le savoir… et c’est ça, la Connerie-Dieu ! L’Homme est une créature noble, qui a besoin de Dieu ! Mais si un Homme peut contempler notre abattoir dément et se dire noble créature, c’est qu’il est aveuglé de connerie ! Je n’ai pas d’enfants. J’ai enduré 33 ans d’un mariage faux à hurler ! Voilà, il ne me reste plus de conneries. Je suis à court !
(…).
Aujourd’hui est mort Edward Ruddy. C’est le Président Directeur Général de UBS, mort à 11 h du matin, d’une crise cardiaque. Malheur à nous, qui sommes dans le pétrin ! Ainsi donc, un richard aux cheveux blancs est mort. Quelle incidence sur le prix du riz ? Et pourquoi « malheur à nous » ? Parce que vous et 62 millions d’Américains m’écoutez en cet instant. Moins de 3 % d’entre vous lisent des livres ! Moins de 15 % lisent des journaux ! Votre seule vérité vous vient du petit écran. À l’heure actuelle, toute une génération n’a connu le monde que par le petit écran. C’est son Évangile ! La Vérité Révélée ! Le petit écran peut faire ou défaire Présidents, Papes, Ministres ! C’est la force la plus terrifiante de ce monde sans Dieu ! (…). La télévision n’est pas la vérité ! La télé, c’est un parc d’attractions ! C’est un cirque, un carnaval, une troupe d’acrobates, de conteurs, danseurs, chanteurs, jongleurs, monstres de foire, dompteurs et footballeurs ! Notre job, c’est de tuer l’ennui ! Alors, si vous voulez la vérité, aller vers Dieu ! Allez vers votre gourou. Rentrez en vous-même ! Il n’y a que là que vous trouverez la vérité ! Mais ne comptez pas la trouver chez nous ! Nous, c’est le n’importe quoi ! Mensonges et Cie ! Chez nous, Kojak trouve l’assassin et personne n’a le cancer chez Archie Bunker ! Le héros est dans le pétrin ? Pas grave ! Regardez votre montre, il sortira toujours vainqueur ! On vous fourgue la merde à la demande ! On fait dans l’illusion. Rien de tout ça n’est vrai ! Mais vous, le public, vous êtes devant votre poste, soir après soir, de tous âges, couleurs, croyances ! Vous ne connaissez que nous ! Et vous commencez à gober nos illusions ! À croire que la télé est réalité et que vos vies sont irréelles. Vous obéissez au petit écran ! Pour vous habiller, pour manger, pour élever vos enfants et même pour penser ! Mais c’est une démence de masse, bande de fous ! C’est vous qui êtes le vrai. Nous, nous sommes une illusion. Alors, fermez vos postes ! Tout de suite ! Et ne les rallumez pas ! Fermez-les au milieu de ma phrase ! Fermez-les !
(…)
Ce qui est mort, c’est la vocation de ce pays pour la liberté pour l’épanouissement de l’individu. C’est l’individualité qui est morte. C’est l’homme, être unique, irréductible, qui est mort. C’est chacun de vous, en particulier, qui êtes mort. Car nous ne sommes plus une nation d’individus. Mais une nation de 200 millions de corps transistorisés, « désiodorisés », blancs comme neige, à carcasses radiales totalement inutiles et remplaçables comme des pistons ! Parler de déshumanisation, est-ce une mauvaise formule ? Bonne ou mauvaise, les faits sont là. Le monde devient humanoïde : les gens ont l’air d’humains, mais n’en sont pas. Le monde, pas seulement nous. Mais étant les plus avancés, on est les premiers atteints. Les gens, dans le monde entier, sont fabriqués à la chaîne, programmés, numérotés. »
(59) Les deux personnages se font écho, du privé (Max) au public (Howard), séparés à partir de la deuxième moitié du film.
(60) « C’est le flux et le reflux, l’énergie marémotrice, l’équilibre écologique ! Vous êtes un homme des cavernes qui pense en termes de nations, de peuples. Il n’y a pas de nations ! De peuples ! Il n’y a pas de Russes ! D’Arabes ! De Tiers Monde ! D’Occident ! Seul reste le sacro-saint système des systèmes ! C’est la vaste et immanente série d’interconnections, d’interactions, la domination multinationale par le dollar. Pétro-dollars ! Électro-dollars ! Multi-dollars ! Reichmarks, rands, roubles, livres et « shekels » ! C’est le système de la devise qui régit l’influx de vie de cette planète. Voilà ce qu’est l’ordre des choses, aujourd’hui ! C’est ça, le fondement atomique, sub-atomique, cosmique des choses d’aujourd’hui ! (…). Il n’y a pas d’Amérique ! Pas de démocratie ! (…). De quoi parlent les Russes ? De Marx ? Non : de programmation linéaire, statistiques, fourchettes extremum, calculs de rentabilité par ordinateurs ! Comme nous ! Il n’y a plus de nations, d’idéologies, M. Beale. Le monde est un Saint Collège de Conglomérats inexorablement régi par les ukases des affaires. Le monde est une affaire. Il l’est depuis que l’homme a quitté son limon. Et nos enfants, M. Beale, verront ce monde parfait où il n’y aura ni guerre, ni famine, ni oppression, ni brutalité. Un vaste holding Œcuménique où chacun travaillera pour le profit de tous. Où chacun aura des actions, son confort assuré, ses anxiétés tranquilisées, son ennui distrait. Et je vous ai choisi, vous, M. Beale, pour prêcher cet Évangile. »
(61) « C’est exactement le système de la lettre volée d’Edgar Allan Poe, c’est en mettant les choses sous le nez des gens qu’on peut être sûr qu’elles ne seront pas vues. C’est exactement comme d’avoir trimballé l’Origine du monde de Courbet au Musée d’Orsay. En mettant ce tableau à la portée de tous, personne ne le voit. Il n’y a pas besoin de le censurer, au contraire la meilleure censure, c’est celle-là, tout le monde passe devant, alors que quand Lacan en était propriétaire, il avait compris que ça fonctionnait avec de la transgression et il avait reconstitué chez lui cette transgression en le dérobant au regard public. Mais, voilà, on supprime la transgression et donc on peut tout passer, tout dire, mais on ne transmet plus rien, plus rien ne passe. C’est ce que j’appelle la nouvelle censure. Et l’autre volet d’une nouvelle forme de censure est de dire : « on ne censure rien, c’est à vous de censurer », d’où les petits comités qui arrivent pour manifester quand on met un bouquin de Jacques Henric avec le tableau de Courbet en vitrine. On charge les gens de faire eux-mêmes leur censure. Voilà à mon avis la révolution qui s’est passée. » (André S. Labarthe, Les Périphériques vous parlent, n°17, 2003).
(62) « Les trois films [Serpico, Le Prince de New York, Contre Enquête] montrent aussi la manière dont la police entretient un rapport d’interaction et d’influence avec d’autres institutions, notamment la famille. Ces films élargissent la notion de famille en reconnaissant que leurs policiers-protagonistes considèrent leurs collègues comme les membres d’une famille. (…). Ainsi, cette trilogie utilise l’institution policière comme un microcosme de toutes les institutions sociales, en démontrant comment les institutions interagissent forcément les unes avec les autres, comment elles affectent et répriment les actions de leurs membres en tant qu’individus, et comment ces membres affectent à leur tour les institutions et la société dans son ensemble. » (American-Jewish filmakers : Traditions and Trends, « Sidney Lumet : The Memory of Guilt », David Desser and Lester D. Friedman, Chicago, University of Illinois Press, 1993).
(63) Dans le remake du film policier de John Cassavetes (1980), Gloria (1999), Lumet insistera sur le caractère féminin au détriment même du sujet. Gloria (Sharon Stone) protège un enfant de la Mafia et découvre une nouvelle facette à sa féminité, la maternité. Elle réalisera qu’elle n’est pas qu’une simple potiche pour le plaisir de ces hommes, mais aussi une mère débordante d’énergie et responsable pour protéger son petit. Le dialogue entre elle et George C. Scott est assez violent : on découvre que l’image que l’on dégage peut saper sa propre identité. En l’occurrence, une jeune femme sexy et libérée ne peut être une bonne mère, ni en avoir les sentiments ! Dans la première version, celle de Cassavetes, tout le film policier pouvait être perçu comme le délire de persécution d’une femme d’âge mûr et l’enfant, dont elle a la charge, son fantasme filial.
Sidney Lumet a réalisé deux autres remakes : Les Feux du théâtre (Stage struck) en 1958 (d’après Morning Glory de Lowell Sherman de 1933) et Une espèce de garce (That kind of woman) en 1959 (d’après The Shopworn Angel de Richard Wallace de 1928).
(64) Derniers mots de Sean Connery dans The Offence.
(65) Documentaire auquel participa Harry Belafonte, Ruby Dee, Ben Gazzara, Charlton Heston, James Earl Jones, Burt Lancaster, Paul Newman, Anthony Quinn, Clarence Williams III et Joanne Woodward.
(66) Equus rappelle Reflets dans un œil d’or (1967) de John Huston dans « l’étrangeté » anglaise propre aux années 70 (liée à l’héritage éducatif « très à cheval » sur les principes et la religion) et dans la manière d’aborder la sexualité refoulée ou les substitutions familiales hyperboliques, voire « monstrueuses ».
(67) Ce procédé narratif périlleux, mais réussi, rappelle De Sang Froid (1967) de Richard Brooks.
(68) « Théâtre thérapeutique (Moreno) permettant au patient de revivre sur un mode ludique ses conflits réels ou ses fantasmes, avec un effet cathartique. » (Serge Tribolet, Lexique de santé mentale, Éditions Privat, 1997).
(69) Les dérives de cette mentalité seront plus ou moins énoncées dans The Village (2004) de M. Night Shyamalan.
(70) Il faut voir le documentaire Classified X (1998) écrit par Melvin Van Peebles et réalisé par Mark Daniels. Malgré quelques raccourcis, le film compile et explore la représentation du Noir Américain dans la production hollywoodienne qui l’a trop souvent réduit à un stéréotype régressif.

