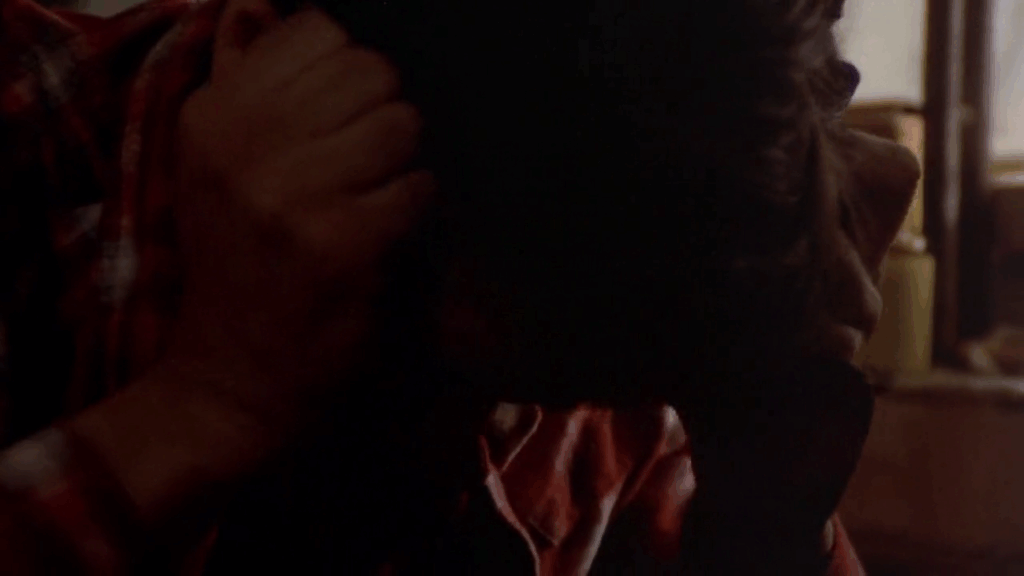« New York de Scorsese est bien la grande ville des films noirs qui ont nourri son imagination, mais à un stade de décomposition plus avancé. Ce New York est un ennemi voluptueux. Les vapeurs des rues se font fantomatiques ; Sport, le maquereau, fait la cour à sa putain enfantine [Iris] et l’entraîne dans une danse hypnotique; les cinémas pornos deviennent des chambres funéraires; la circulation bloquée est macabre. Et cet enfer est toujours en mouvement. […]. On dit de certains acteurs qu’ils sont des récipients vides que remplissent les rôles qu’ils tiennent, mais ce n’est pas ce qui a l’air de se passer ici avec De Niro. Il a pris le chemin inverse. Il a utilisé le vide qui est en lui, il est allé chercher sa propre anomie. Il n’y a que Brando pour avoir fait ce genre de plongeon, et la performance de De Niro a quelque chose de l’intensité immédiate dont Brando faisait preuve dans Le Dernier Tango. À sa manière, ce film a lui aussi une aura d’érotisme. Il n’y a pratiquement pas de sexe, mais l’absence de sexe peut perturber autant que le sexe. Et c’est de cela qu’il s’agit : l’absence de sexe, de l’énergie et de l’émotion qui s’accumulent pour se libérer en une éruption sanglante. Le fait que nous partagions avec Travis la sensation viscérale qu’une explosion est nécessaire et que l’explosion elle-même prend la qualité d’un accomplissement fait de Taxi Driver l’un des rares films d’horreur réellement modernes. » (Pauline Kael, The New Yorker, 9 février 1976)
Voilà l’extrait d’un article qu’écrivit la critique américaine Pauline Kael à la sortie du film, mais Taxi Driver, aujourd’hui… Comment appréhender un tel film aujourd’hui encore ? Comment pourrait-on le voir, surtout face à la montée du postmodernisme (1) qui étouffe la culture, l’art jusqu’à quoi ? L’éteindre ? Et pourtant, Godard ne comparait-il pas l’art à l’incendie dans son segment Fatale Beauté des Histoire(s) du cinéma, que justement « l’art naît de ce qu’il brûle »?

Travis (Robert De Niro), c’est exactement l’être exclu du postmodernisme, il ne correspond ni aux quotas, ni à la discrimination positive. Il drague et regarde les jolies filles puis leur parle tout en mimant maladroitement les êtres de supériorité morale qui seraient d’une classe sociale au-dessus de lui, d’où son attirance pour Betsy d’une autre « classe » que lui. C’est aussi la voix qu’on ne veut pas entendre, trop franche, trop directe, trop sincère et qu’on préfère laisser sur le bas-côté plutôt que d’échanger avec lui pour mesurer ses excès et tenter de les comprendre.

Mais c’est surtout l’être le plus attachant et le plus jusqu’au boutiste du cinéma américain d’alors, (avec Carrie ou Rocky dans les films éponymes sortis la même année) ; c’est l’écorché vif que les classes bourgeoises veulent étouffer, brûler, effacer, c’est le poète criminel d’Holderlin (« assurer à la société un minimum d’insécurité pour lui éviter un engourdissement fatal ») tout autant que le prophète-pourvoyeur réel-fiction et « ambulante contradiction » de la chanson de Kris Kristofferson (The Pilgrim, Chapter 33 de l’album The Silver Tongued Devil and I) à qui le compare sa muse Betsy (Cybill Shepherd). Cela pourrait être l’étrangleur de Paul Vecchiali (L’Etrangleur, 1970) qui reçoit, enregistre, réceptionne, éponge toute la violence du monde, comme Jacques Perrin qui en interprétait le personnage principal. Mais les faiblesses de Travis, de son sexe à sa personnalité, sont magnifiques et sa vulnérabilité inspire, réveille, révolte.

« Paul Schrader [scénariste de Taxi Driver] a expliqué que le racisme de Travis provient du fait que les frustrés et les pauvres impuissants ont tendance à reporter leur ressentiment non pas sur la classe des puissants mais sur la classe inférieure constituée de gens encore plus mal lotis qu’eux (2). » (Quentin Tarantino, Cinéma Spéculations)


Au travers du candidat pour lequel elle travaille, Betsy a pris toute l’attention médiatique et politique tout en simulant de prendre en charge les problèmes de la société. Betsy, c’est le comble moderne de la bourgeoisie qui prend à son compte les problèmes d’autrui, les récupère, les incarne à l’image de toutes ces jeunes communautés favorisées baignées dans le virtuel et les complexes d’une bien-pensance moribonde, tellement accrue et obsédée par son confort qu’elle en est devenue sécuritaire. Main dans la main avec les gouvernements de droite, Betsy revendique un monde sans échanges et sans partage où les valeurs associatives (par exemples) sont aseptisées, vidées de tout contenu subversif réellement politique. Betsy, c’est la (im)posture (3). Elle nie la violence des classes pour leur préférer un monde artificiel dont la seule mission réelle est de la protéger ou de la conforter dans ses préjugés traduisant violemment la condescendance de la supériorité morale de son rang. Et du moment qu’elle reste aux premières loges… D’ailleurs, Betsy et Iris (Jodie Foster), la trop jeune prostituée, ne se rencontreront jamais, seul Travis, le marginal qui en devient raciste à force de solitude, permet de joindre ironiquement les deux bouts, et renvoyer dans les cordes les deux solitudes, celle politique de l’entre-soi et celle social du désœuvrement. La maxime de Spinoza paraît impossible à concevoir dans l’univers du film que dépeint Scorsese, mais surtout aujourd’hui : « Ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas haïr, mais comprendre. » Et la résignation du faible (Travis) à succomber au racisme devient la violence du fort (la récupération politique qu’elle vienne de la bonne conscience morale des postmodernistes ou de l’extrême droite infâme et plus décomplexée que jamais).

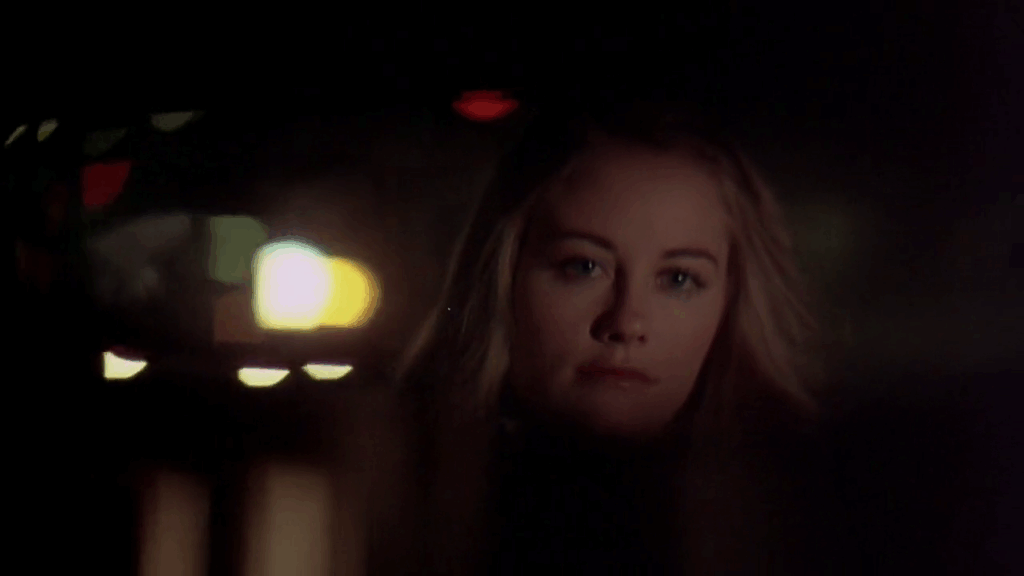
« Ne pas être capable ou ne pas vouloir se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre – afin de voir le monde d’une façon complètement différente de la vôtre – est le premier pas en direction de l’absence d’empathie, et c’est la raison pour laquelle tant de mouvements progressistes deviennent aussi rigides et autoritaires que les institutions qu’ils combattent. » (Bret Easton Ellis, White)
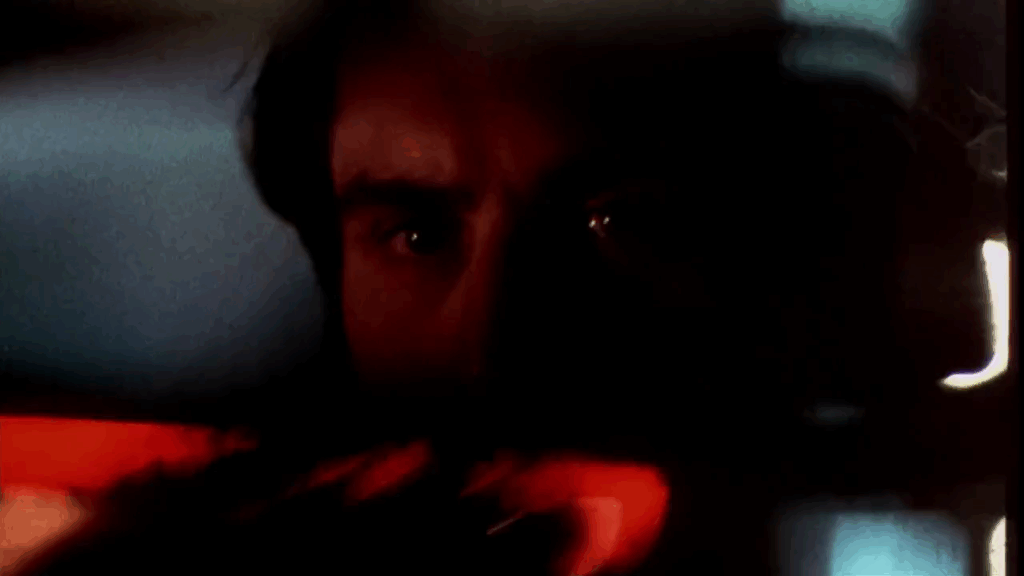
Derek Woolfenden, 24 mai 2023
NOTES :
(1) « L’amère victoire du postmodernisme confirme le basculement de la société du spectacle en société du chaos. En tant que simulacre culturel, le postmodernisme a emprunté le discours et les postures de la gauche et de l’extrême gauche pour en venir à élaborer un projet politique conjuguant et confondant, sans contradiction possible, le libéral, le libertaire, le fanatique et le médiatique. Cette réduction de toute l’existence sociale aux seules valeurs de la domination signe sa première victoire. » (Jordi Vidal, Servitude & simulacre en temps réel et flux constant)

(2) « L’un des pires effets de la misère, c’est de transformer ses victimes en bourreaux de leurs semblables. (…). « C’est là que réside la dimension la plus mal comprise et la plus cruciale de l’oppression. Partout dans l’histoire et dans le monde, les victimes (prisonniers ou opprimés) collaborent aux formes les plus barbares de leur propre torture. Si on refuse de voir et de reconnaître cette dimension, de peur de contribuer aux stéréotypes racistes ou par sensibilité et par respect de la réputation d’une communauté, on nie l’un des principes les plus fondamentaux de l’oppression. » (Philippe Bourgois cité par Alain Accardo pour sa préface du Culte de la charogne, Anarchisme, un état de révolution permanente (1897-1908) de Albert Libertad)

(3) « Dans la société de l’image et du buzz, on a tendance à confondre la radicalité de la posture avec l’intensité de l’engagement. Plus on reste inflexible, campe sur ses positions et propose une vision radicale qui exclut toute autre manière de voir, plus on se convainc de bien servir sa cause. Au contraire, élargir son point de vue, le raffiner ou le revisiter pour inclure d’autres paramètres, est considéré comme un compromis. Et en France, le compromis est perçu comme un renoncement à la radicalité de l’engagement. Dans d’autres sociétés, il est la manifestation même de la maturité et du raffinement de la pensée. On préfère alors ne pas collaborer avec ce que l’on juge comme l’ennemi, quitte à priver la collectivité des bienfaits qu’une collaboration pourrait apporter.

Au lieu d’être des espaces de confrontation fertile des points de vue, les médias sont devenus les producteurs du spectacle du clash. Dans ces duels, il ne s’agit pas de rencontrer l’autre pour affiner, élargir ou enrichir notre point de vue. Il s’agit de renforcer son opposition. Aux patrons, aux bobos, aux fachos, aux gauchos, au Mâle Blanc, au Musulman… (…). Les enjeux sociétaux ne sont plus que des outils au service des postures. (…). Aller vers l’autre s’apprend. C’est une gymnastique émotionnelle et cognitive, bien difficile pour les personnes qui n’ont grandi qu’au milieu du même. L’entre-soi peut être un refus comme une incapacité à inclure l’altérité. » (« Le temps des postures : la société de l’entre-soi » de Sarah Roubato, billet de blog de Mediapart, 8 mai 2023)