« SO BE IT »
Entretien avec le cinéaste David Schmoeller réalisé par Derek Woolfenden et Marc Ulrich le samedi 27 janvier 2007 dans la salle Jean Epstein de la Cinémathèque française de Bercy.
Traduction de Marc Ulrich.
Remerciements à Élodie Dufour, Fred Savioz et Chaab Mahmoud de la Cinémathèque française de Bercy.

C’est à l’occasion d’une séance Bis de la Cinémathèque française consacrée à David Schmoeller où furent projetés Fou à tuer, Tourist Trap et le court-métrage Please Kill Mr Kinski, que nous avons pu nous entretenir avec le cinéaste.
Il a tourné une dizaine de films depuis la fin des années 70 à aujourd’hui. Sa carrière dans le cinéma de genre des années 80 et 90 ressemble à celles de Jack Sholder (Alone in the Dark, Hidden, A Nightmare on Elm street Part 2 : Freddy’s Revenge) ou encore Jeff Lieberman (Squirm, Survivance, Le Rayon Bleu). Ces réalisateurs se partagent la réalisation de fleurons du genre : âpres, économes et sans concessions. Puis, les oubliettes d’Hollywood…
David Schmoeller est un homme modeste avec des obsessions dévorantes qui se sont retrouvées dans des thématiques bien précises avant de s’incarner en Klaus Kinski dans Fou à tuer. Il ne s’est d’ailleurs jamais vraiment remis de cette rencontre à en croire son admiration et les anecdotes liées à l’acteur durant le tournage cauchemardesque du film.
Mais, ce qui touche chez Schmoeller, c’est cette passion pour raconter des histoires… Dans le cinéma, pris systématiquement dans ses prérogatives critiques, morales, esthétiques, politiques et j’en passe, on en oublie trop souvent ce plaisir « mythique » de les raconter. Des histoires fantastiques et d’épouvante qui, finalement, malgré leurs apparences extrêmes, sont proches de nous… À notre tour de vous raconter son histoire par l’intermédiaire de nos questions, prétexte utile pour qu’il nous narre ses expériences, ses influences et son approche personnelle vis-à-vis du cinéma qui, à l’instar d’un Klaus Kinski ou du ghetto de la série B, ne lui a pas rendu la vie facile.
Vous avez réalisé de merveilleux films de série B fantastique, genre que nous apprécions beaucoup. Pourquoi est-ce votre genre de prédilection ?
Tourist Trap est mon premier film. Des amis, rencontrés à l’école de cinéma, avaient travaillé sur Massacre à la Tronçonneuse, un film à très petit budget qui a fait beaucoup d’argent et qui a lancé leur carrière. J’ai donc fait équipe avec Larry Carroll, monteur de Massacre à la Tronçonneuse, et nous avons décidé de faire un film d’horreur à petit budget. Je me suis basé sur mon film de thèse, qui s’appelait A Spider Will Kill You, pour réaliser Tourist Trap. Cela parlait de mannequins qui prenaient vie. Je n’étais pas spécialement friand de films d’horreur, mais c’était un moyen pour les jeunes cinéastes de l’époque de lancer leur carrière. C’est pourquoi nous l’avons fait.
Comment ce genre vous a-t-il permis d’exprimer votre univers propre, vos idées, et votre conception du monde ?
Je ne suis pas sûr que ce soit le genre en tant que tel qui m’ait permis de le faire. J’ai commencé par l’écriture, et je me suis mis au cinéma plus tard. Je crois donc que l’écriture a toujours été mon premier moyen d’expression. Les films d’horreur sont souvent des premiers films, car il s’agit d’un genre qui privilégie la réalisation, les effets spéciaux, l’ambiance, par rapport au jeu des acteurs par exemple… et ça ne coûte pas cher. C’est pourquoi les jeunes réalisateurs essaient souvent de percer avec un film d’horreur. Le piège, c’est que Hollywood met les réalisateurs et les acteurs dans des cases, et surtout les réalisateurs. S’ils ont un scénario de science-fiction, ils vont chercher un réalisateur de science-fiction, de la même manière qu’ils vont chercher un réalisateur de drames pour un drame, ou un réalisateur de comédies pour une comédie. Si on fait un film d’horreur, on se retrouve sur la liste des réalisateurs de films d’horreur. On devient le type qui fait des films d’horreur. C’est le piège. Le seul moyen d’y échapper, c’est de tout faire pour changer de genre dès le deuxième film ; Spike Lee est un bon exemple, ou encore Ron Howard. Un réalisateur doit vraiment travailler dur pour ne pas être enfermé dans une case. D’ailleurs, les réalisateurs qui réussissent à faire un film différent chaque fois obtiennent une plus grande autonomie dans leur travail.
Vous écrivez toujours ?
J’écris toujours, oui.
En dehors du cinéma, pour vous-même ?
Non non, uniquement des scénarios.
Quelles sont vos influences principales quand vous écrivez une histoire et quand vous tournez un film ?
Je pense que ça part toujours d’une histoire. La plupart des réalisateurs reçoivent du travail ; en d’autres termes, ils sont engagés sur la foi de leur réputation et de leurs précédents films par un producteur qui a déjà un projet. C’est bien plus difficile d’avoir un projet personnel et de chercher quelqu’un pour le financer. À l’exception de Tourist Trap, j’ai fait tous mes films en mercenaire. J’ai donc toujours fait le film de quelqu’un d’autre. Après un travail, j’écris toujours un scénario original que j’aimerais mettre en scène, et j’ai vendu quelques scripts, mais je n’ai jamais pu les réaliser. C’est un peu frustrant.
Votre style est tout de même toujours identifiable. Parlez-nous des liens entre le cinéma et le crime. Y a-t-il un rapport entre le cinéma, le crime et la morale ?
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question… La dernière histoire que j’ai écrite et dont je suis fier s’appelle Little Monsters, et il s’agit d’une histoire qui concerne la notion de crime. Elle m’a été inspirée par un véritable meurtre : deux garçons de dix ans ont kidnappé un enfant de trois ans, la situation a dégénéré, ils se sont retrouvés avec ce bébé sur les bras qui pleurait sans arrêt, et ils ont fini par le tuer. On les a placés dans un centre de redressement jusqu’à leurs dix-huit ans. C’était une histoire vraiment intéressante, dans la mesure où à cet âge, on admet qu’un enfant ne sait pas vraiment ce qu’il fait. Il sait que c’est mal, mais il ne mesure pas la gravité du meurtre. On ne peut donc pas le punir comme on punirait quelqu’un de plus âgé, même si aux Etats-Unis, l’âge à partir duquel on peut être inculpé pour homicide a régulièrement tendance à baisser.
J’ai situé le scénario aux Etats-Unis, mais j’ai modifié les personnages, les parents de l’enfant assassiné, ceux des deux meurtriers, les avocats des deux parties, les juges, les politiciens… Ça a créé une onde de choc qui a affecté de nombreuses vies, tout en soulevant de nombreuses questions de société. Dans l’affaire Bulger, on a donné de nouvelles identités aux meurtriers quand on les a libérés le jour de leurs dix-huit ans. Je crois qu’une loi a été votée pour interdire de divulguer leurs nouvelles identités et l’endroit où on les avait envoyés, mais la presse était déterminée à obtenir ces informations. Pour moi, c’était vraiment une bonne histoire. J’ai deux personnages, le film commence le jour de leur remise en liberté. Ils ont de nouvelles identités. Ils sont envoyés dans deux endroits différents du pays, ils ne peuvent pas se parler. Nous les suivons, des flashbacks nous montrent le meurtre, nous voyons ce qu’ils ressentent à ce propos. Dans cette histoire, on pose toujours la question de savoir s’ils vont réussir à s’amender et à commencer une nouvelle vie. Il s’agit donc d’une histoire qui traite du crime, à de nombreux niveaux.
Dans Fou à Tuer, il y a une scène entre le Dr. Gunther (Klaus Kinski) et Josef Steiner (Kenneth Robert Shippy) où une habile inversion des rôles s’opère : Gunther devient presque touchant et Steiner devient le tortionnaire. Etant donné l’arrière-plan historique du film (l’Holocauste), cela peut sembler choquant. Comment avez-vous géré cet aspect, sachant que le choix d’utiliser le passé nazi vous a été imposé ?
Je me suis simplement inspiré des célèbres chasseurs de nazis qui étaient déterminés à traquer ces gens. C’est parodique. Le personnage de Kinski n’est pas un nazi, c’est un docteur qui, par le biais des journaux de son père, devient obsédé par cette histoire, et devient donc nazi lui-même. Il existait bien des chasseurs de nazis, mais Steiner est surtout décidé à venger la mort de son frère. Ce n’est donc pas un aspect que j’ai développé consciemment ; j’ai juste voulu montrer qu’il était déterminé à obtenir la justice.
Mais c’est tout de même un personnage assez perturbé (celui de Steiner)…
En effet. Je vais vous dire, cette scène était assez compliquée à tourner… Kinski pleurait vraiment, et il n’allait pas me laisser faire une deuxième prise. Il fallait tout capter dès la première prise.
Lui avez-vous demandé de pleurer ?
Oui. Je lui ai dit : « Essaie d’être aussi émouvant que possible ». Je pense que si vous demandez à un acteur de pleurer, il risque de se bloquer. Nous avons tourné la scène, la caméra s’est approchée jusqu’au gros plan, et il s’est mis à pleurer pile à ce moment. J’étais stupéfait. Plus tard, l’acteur qui jouait Steiner est venu me voir pour me dire : « Je sais comment il a fait. Je sais comment il a pleuré, je l’ai vu.
– Ah bon ? Comment il a fait ?
– Juste avant la scène, il a levé le bras et s’est gratté les globes oculaires ! »
Comment aidez-vous vos acteurs à jouer des personnages de psychopathes ?
Je vais vous donner un exemple dans Tourist Trap. Quand j’ai fait Tourist Trap, je ne connaissais rien à la direction d’acteurs. Traditionnellement, dans les écoles de cinéma, la section « théâtre » et la section « cinéma » ne communiquent pas. Ça commence un peu à changer. Quand j’étais à l’école, les gens de la section « théâtre » ne laissaient pas leurs acteurs jouer dans des films. Je ne savais pas du tout travailler avec un acteur. L’actrice qui joue Molly, le personnage qui survit à la toute fin du film – elle s’appelle Jocelyn Jones, c’est la fille du célèbre comédien Henry Jones –, était une actrice expérimentée, elle m’a beaucoup appris pendant le tournage. Dans le scénario, il était écrit : « A la toute fin, le personnage de Molly part en voiture, une expression de folie sur le visage ». Je discutais avec Jocelyn, et je lui ai dit : « Je veux que tu prennes le visage d’une folle ». Elle m’a répondu : « On ne peut pas jouer la folie. Voilà ce que je vais faire : j’aurai huit ans, et je serai en route pour un goûter d’anniversaire ». C’est ainsi qu’elle a pris cette sorte d’expression joyeuse, et c’était parfait. C’est donc quelque chose qu’on peut obtenir en demandant à l’acteur d’incarner quelque chose qui lui est familier. La folie… Brad Pitt, dans… Comment s’appelle ce film, déjà ?
L’Armée des Douze Singes de Terry Gilliam ?
C’est ça. Il joue le rôle d’un fou échappé de l’asile, et il joue ça comme on l’a tellement vu dans les mauvais films, quand les acteurs caricaturent une émotion…
Pour en revenir à la question de l’arrière-plan historique de Fou à Tuer, vous avez également employé une complainte juive lors des confessions de Gunther, et pour le dernier plan, qui montre la table où sont posés le pistolet et la balle, mêlant ainsi la souffrance des Juifs à la mort de Gunther.
Ce n’était pas dans le scénario. Le plan, lui, était dans le scénario. Cette chanson est venue d’une conversation avec Pino Donaggio qui a suggéré cette idée. Il a écrit la musique du film et un collègue à lui a écrit cette complainte juive. Nous avons engagé une petite fille de douze ans qui est venue enregistrer en studio. J’ai trouvé ça très puissant. On l’entend à plusieurs reprises dans le film.
Vous vous êtes servi du genre fantastique pour vous montrer critique et subversif. A l’intérieur de ce genre, vous avez abordé des problèmes majeurs tels que la filiation, la religion, l’histoire (l’Ouest américain et la Guerre de Sécession dans Tourist Trap, les crimes nazis dans Fou à Tuer). Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Comment le fantastique vous a-t-il permis d’exprimer votre point de vue sur l’histoire de votre propre pays ?
A l’origine, Fou à Tuer était un film sur la Guerre du Vietnam. Dans la scène où Lori est endormie, le plan démarre sur la photo prise au Vietnam d’un général qui exécute un prisonnier. J’ai donc gardé une trace visuelle de cette idée. Je crois que nous essayons d’être politiques dans tout ce que nous faisons. Je suis enseignant maintenant, et nous n’avons pas le droit d’être ouvertement politiques dans les cours. Par contre, de manière dissimulée… L’été, je donne un cours sur le documentaire, et je suis très libéral (1). Quand je choisis de montrer telle ou telle œuvre, je fais un choix d’ordre politique. Je crois qu’en tant qu’artistes, nous essayons d’exprimer ce que nous ressentons à propos du monde, et de montrer au public notre propre point de vue sur les choses.
Les liens entre le père et le fils semblent beaucoup vous importer. C’est quelque chose de tout à fait original dans un genre qui a tendance à privilégier les rapports entre la mère et le fils, comme et depuis Psychose par exemple. J’ajouterais que les pères que vous mettez en scène ont tendance à vampiriser leur fils.
La Main des Ténèbres commence par un monologue. Dans ce film, le père meurt et se retrouve en enfer. Il parvient à faire entrer son fils dans l’Autre monde pour prendre sa place sur terre. La voix off au début du film, c’est moi qui parle directement à mon père, qui a divorcé et nous a quittés ma mère et moi quand j’avais un an. Je ne l’ai jamais revu depuis, et je n’ai jamais eu la moindre nouvelle. Dans le film, le fils revient et lui demande : « Comment peut-on avoir un enfant pour l’abandonner ensuite ? » Je suis donc certain que mon travail comporte un certain ressentiment dû à l’abandon du fils par le père.
Dans vos films, le personnage du fils est comparable à une marionnette qu’on peut manipuler, comme dans Puppet Masters.
Dans Puppet Masters, une des marionnettes s’appelle « Blade ». Elle ne vous rappelle personne ? Ce visage, c’est Klaus Kinski. Nous avons sculpté le visage, et les cheveux sont identiques à ceux de Kinski.
Certains de vos personnages se comportent en réalisateurs, dans le sens où ils filment les gens et leur donnent du texte (The Seduction), ou les dirigent comme s’ils étaient des animaux (Fou à Tuer) ou des poupées (Tourist Trap). Que voulez-vous dire par là ? Les cinéastes sont-ils mentalement dérangés ?
Je pense qu’il s’agit d’une observation tout à fait exacte. Je pense en effet que les cinéastes sont des voyeurs, ce qui n’est pas nécessairement négatif. A vrai dire, le réalisateur est obligé d’exercer un contrôle sur le processus de création de son film. C’est l’inverse au théâtre, le travail du metteur en scène consiste à donner confiance à ses comédiens, de sorte que le soir de la première, la pièce appartienne aux acteurs. C’est là qu’il exerce son contrôle. Dans le cinéma, c’est l’inverse. D’un plan à l’autre, le réalisateur sait toujours ce qu’il va se passer, mais pas l’acteur. Il ne s’agit pas d’exercer un quelconque pouvoir sur l’acteur, on a juste besoin de s’assurer qu’on va rester dans les temps. Du coup, on se retrouve à tout contrôler, ou du moins on en donne l’impression.
Les cinéastes, comme les psychopathes que vous mettez en scène, seraient-ils des « maîtres de l’illusion » ?
À mon avis, il s’agit d’un des fondamentaux du genre, particulièrement dans les films d’horreur, où le méchant est un fou, parce que la folie est effrayante en ce sens qu’elle est imprévisible. Nous avons tendance à graviter autour de ce genre de personnages parce qu’ils sont susceptibles d’être plus effrayants ; on ne sait jamais ce qu’ils vont faire. C’est intéressant, cette histoire d’illusion… Je ne sais pas trop d’où ça vient, en ce qui me concerne. Nous sommes peut-être toujours des enfants qui aimons regarder des tours de magie. C’est assez fascinant, vous savez.
Pourquoi tournez-vous toujours en intérieur, à l’exception de The Arrival et du Royaume secret ? Vos films tournent toujours autour d’un seul lieu. Pour quelle raison ?
C’est parfois absolument indépendant de ma volonté, et Fou à Tuer en est le meilleur exemple. Le projet a dû son existence au fait que nous disposions de ce lieu, et j’ai écrit l’histoire en fonction de l’endroit. Je n’ai pas écrit The Arrival. J’étais seulement le réalisateur, c’est le producteur qui l’a écrit. Pour la plupart de mes films, il s’agissait de questions de production. Pour Fou à Tuer, il y avait un décor. Pour Catacombs, nous avons tourné dans les studios De Laurentiis à Rome, et du fait de la production, nous devions tourner au moins la moitié du film sur une scène, parce que nous disposions de tous ces artisans qui construisaient des décors et ce genre de choses. Nous disposions d’un monastère pour dix jours, et du studio pour dix autres jours où nous avions construit les catacombes. Quand j’écris une histoire, je sais que je vais devoir en tourner une partie en studio, parce que c’est là que la compagnie qui m’engage doit tourner le film. Pour les deux films d’enfants que j’ai tournés à Bucarest, Le Royaume secret et Search for the Jewel of Polaris : Mysterious Museum, c’est la même histoire. Nous avions un studio en construction à Bucarest, et nous avons utilisé de nombreux studios de film en film. Nous avons tourné cette série de films pour enfants en Roumanie parce que c’était très bon marché, et que les histoires se ressemblaient beaucoup. Il s’agissait toujours de trois frères et sœurs, et le plus petit finissait par entraîner l’aîné dans ses problèmes. Ça se passe toujours dans une ville américaine, mais quelque chose de magique se produit, et ils se retrouvent… en Roumanie. Ils sont expédiés dans le passé, au 16ème siècle, ou, à cause d’un orage, dans le Royaume secret. Il s’agit simplement de prétextes pour pouvoir tourner en Roumanie, où on trouve tous ces châteaux et ces paysages magnifiques. Ainsi, on pouvait tourner des films historiques à peu de frais, et il fallait donc inventer une histoire qui réponde à ces contraintes économiques. Malheureusement, il s’agit plus d’économie que d’inspiration.
Vous avez étudié avec Buñuel et Jodorowsky. Que vous ont-ils appris ? Dans quelle mesure ont-ils influencé votre cinéma ?
Peut-être mon côté réaliste magique… J’ai fait mon premier cycle à Mexico, pendant deux ans. Jodorowsky et Buñuel étaient tous deux surréalistes, et Mexico est connu pour le « réalisme magique ». On ne peut pas directement les comparer, mais ils m’ont tous les deux fasciné d’une manière particulière, surtout pour leur apport au réalisme magique. Quand j’étais à la fac à Mexico, Jodorowsky avait fait un film, mais il n’avait pas encore réalisé El Topo. Quand je l’ai rencontré, il faisait du théâtre surréaliste, principalement des pièces anti-américaines (rires). Vous savez, j’y allais simplement pour regarder, et… je n’avais jamais rien vu de tel. Et plus tard, quand j’ai vu El Topo, cela a été une grande expérience. C’était un personnage extraordinaire.
Buñuel était le parrain de ma femme, je le connaissais donc socialement, il a passé mes premiers films dans son cinéma Salla Buñuel à Mexico, et a essayé de les diffuser à la télévision. Avant de rencontrer ma femme, je ne le connaissais pas vraiment, je ne connaissais pas son œuvre, je n’avais vu aucun de ses films. C’est plus tard, après notre rencontre, qu’il a fait ses descriptions de la bourgeoisie, et ses merveilleux films français.
Pratiquement tous vos films deviennent de plus en plus surréalistes à mesure que l’histoire se développe, et parallèlement, vos personnages principaux deviennent de plus en plus fous. Comment arrivez-vous à atteindre ces points culminants sans tomber dans le ridicule ? Employez-vous des outils visuels ou narratifs ?
C’est une très bonne question. J’ignore si d’autres trouvent que j’y suis arrivé, et je pense qu’un grand nombre de gens considèrent que j’ai échoué…
Dans Tourist Trap et Fou à Tuer, vous y êtes parvenu (2).
Je pense que j’y suis mieux arrivé dans Tourist Trap que dans Fou à Tuer. Je trouve que la fin de Fou à Tuer n’est pas assez forte. Je ne devrais pas descendre mes propres films, mais encore une fois, en ce qui me concerne, je trouve que la fin de Tourist Trap fonctionne mieux, qu’elle atteint cette sorte de folie que vous évoquiez au moment où le personnage de Jerry entre dans la pièce et se transforme subitement en mannequin. Pour moi, Fou à Tuer n’atteint pas ce niveau, à mon grand regret. Je crois que c’est une question de chance. J’ai essayé de faire ce que vous avez décrit. En tant que cinéaste, nous avons ce genre d’ambition, et parfois, quand tout s’agence, ça marche, et d’autres fois non.
Il n’y a pas de recette…
Roman Polanski parle du fait de faire des grands films. Selon lui, faire un grand film – il a fait beaucoup de bons films, et je trouve qu’il a fait un grand film – est une question de chance. C’est une question de chance parce qu’il faut le bon scénario, avec les bons comédiens, le bon budget, et ensuite tout doit fonctionner ensemble.
De nombreux réalisateurs ont fait beaucoup de bons films, et un seul grand film.
Je dirais que Jean Renoir est une exception, puisqu’il a constamment fait de grands films… John Ford également. Mais il s’agit de réalisateurs légendaires, le niveau de leur travail était tellement élevé. Je pense tout de même qu’il faut beaucoup de chance pour que tout se mette en place et donne un grand film.
Dans vos films, c’est souvent une femme qui est à l’origine des problèmes. C’est à cause d’une femme que le personnage joué par Chuck Connors tue son frère dans Tourist Trap ; c’est le personnage joué par Laura Schaefer qui réveille le mal dans Catacombs, etc. Etes-vous d’accord avec cette interprétation ?
Vous avez manifestement vu les films en question, je ne peux donc pas nier les faits… Je suppose que je me suis rendu coupable dans mes premiers films d’avoir suivi un schéma américain particulièrement à la mode à l’époque, qui consistait à mettre un personnage féminin en danger. C’est un cliché, un piège dans lequel je suis tombé. Il est également possible que n’ayant pas eu de père, je cherche à voir le monde à travers une figure maternelle ou féminine. Je n’ai jamais suivi de psychanalyse, c’est quelque chose que je n’ai pas vraiment approfondi.
Parlez-nous du tournage de The Arrival. Qui est Kevin Daniel Ljoka ? Dans ce film, il est acteur, producteur et scénariste, mais il n’a jamais fait rien d’autre dans le cinéma.
(rires) C’était un homme d’affaires comme son père. Il a repris ses affaires. Il avait beaucoup d’argent, mais il voulait écrire. Il a écrit plusieurs scénarios, dont celui de The Arrival, et il connaissait tous les films d’horreur et les réalisateurs de films d’horreur de l’époque. Il m’a donc engagé pour réaliser son film.
Il a fini par se faire engager comme scénariste, mais je crois qu’aucun film n’en est sorti, c’est pourquoi si vous cherchez sur Imdb (3) vous ne trouverez rien ; les projets vendus mais pas réalisés n’y sont pas répertoriés. De toute façon, il n’avait pas besoin de ça pour gagner sa vie. De par son père, il avait l’argent pour produire le film, alors nous l’avons fait.
Avez-vous aimé travailler avec lui ?
Beaucoup. Il était très drôle, très joyeux, très généreux. Il m’a emmené au Festival de Cannes, où nous sommes restés un mois. Travailler avec lui a été très amusant.
Dans The Arrival, on retrouve votre obsession du rapport père-fils dont nous avons parlé tout à l’heure, et pourtant vous n’avez pas écrit ce scénario.
J’ai retravaillé le scénario avec lui, mais l’idée était de lui, et il y avait un scénario complet quand j’ai intégré le projet. Nous l’avons simplement affiné. Il y a des choses que nous avons enlevées et que j’aurais aimé garder.
Parlez-nous de votre collaboration avec Lalo Schifrin, Pino Donnaggio et Richard Band.
Tout d’abord, laissez-moi vous raconter comment Pino Donnaggio est devenu compositeur de musiques de films. C’est une histoire vraie. Son premier film était Ne Vous Retournez Pas, un grand film. Pino est né et a grandi à Burano, près de Venise et, à ce jour, il vit encore là-bas. Il a suivi des études de musique classique, il a appris le violon, puis il est devenu auteur-compositeur. Il a écrit des chansons très connues, comme « You Don’t Have To Say You Love Me », enregistrée par Elvis Presley et beaucoup d’autres. Il s’agit d’une des chansons les plus enregistrées. Le tournage de Ne Vous Retournez Pas se déroulait à Venise. Pino revenait de tournée et, alors qu’il se promenait, le producteur associé l’a vu sur un pont, et a eu une sorte de vision prémonitoire : ce type, c’était le compositeur du film. Un parfait inconnu ! Il s’est approché et lui a demandé : « Vous connaissez quelque chose à la musique ? » Et Pino a répondu : « Et bien oui, je suis chanteur. » Et l’autre a répliqué : « Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes censé être compositeur ». On lui a donc montré la scène d’amour du film, avec le montage parallèle, et il a écrit la musique qu’on entend dans le film. Il a écrit la mélodie puis l’a jouée, et ils lui ont dit : « Tu es notre compositeur ». C’était son premier film. Si c’est un bon compositeur pour le cinéma, c’est notamment parce qu’en tant que compositeur de chansons, il écrit de bonnes mélodies. J’étais donc très excité de pouvoir travailler avec lui. Quand j’ai fait Tourist Trap, je n’avais jamais travaillé avec un compositeur, même si j’avais collaboré avec un étudiant en musique sur A Spider Will Kill You. Mais lui, il avait fait Carrie, vous comprenez… Il m’a appris à travailler avec un compositeur. J’ai fait deux autres films avec lui (4).
Lalo Schiffrin est un très bon compositeur. Quand Pino Donnaggio est devenu trop cher pour nous, nous avons eu la chance d’avoir Lalo Schifrin. En d’autres termes, Pino avait l’habitude de travailler sur des films à gros budget, et nous n’avions pas de budget. D’ailleurs, Lalo Schifrin avait lui aussi travaillé sur des films bien plus coûteux. Je crois qu’il l’a fait pour l’argent. Nous travaillons tous pour gagner notre vie, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais je crois que le film (5) n’était pas à son niveau. Pour le dire autrement, en tant que compositeur, on est au niveau du film, on ne peut pas être meilleur que le film pour lequel on compose. Mais il a fait du bon boulot. Seulement, ma collaboration avec lui n’a pas été aussi créative qu’avec Pino.
Quant à Richard Band, c’est un artisan. Cela s’accordait bien avec le niveau du film, financièrement parlant. Quand nous avons fait Puppet Masters, il nous était pratiquement impossible de nous payer un orchestre, où que ce soit. A l’époque, on allait déjà en Bulgarie pour trouver des orchestres abordables. Un petit budget ne permettait pas de payer un orchestre américain, il fallait donc chercher ailleurs. Richard fait partie de ces compositeurs qui travaillent exclusivement sur des machines, et c’est quelque chose qu’il fait très bien.
Comment Charles Band travaille-t-il ? Qu’est-ce qui le différencie des autres producteurs avec lesquels vous avez collaboré, comme Yablans ?
Ça me fait plaisir de répondre à cette question. J’ai fait beaucoup de films avec Charles Band, et c’était merveilleux de travailler pour lui parce qu’il ne vous posait pas de problème. Il n’interférait jamais. Il engageait quelqu’un parce qu’il aimait son travail. Bien sûr, il venait jeter un œil aux premiers montages pour donner son avis, mais les autres films d’Empire lui prenaient tout son temps. Si ça se passait bien avec lui, si vous faisiez du bon travail, alors il vous laissait une autonomie totale en tant que réalisateur. Avec Irwin Yablans et Bruce Cohn Curtis, c’était exactement l’inverse. Ce sont tous deux des personnalités envahissantes. La seule raison pour laquelle j’ai pu terminer le film, c’est qu’ils se disputaient en permanence, l’un essayant de dominer l’autre, vous voyez… Sur The Seduction, j’ai eu moins de travail que sur n’importe lequel de mes autres films parce que l’idée même que j’avais vendue à Irwin était complètement différente. A l’origine, c’était bien plus simple. Je m’étais inspiré d’un véritable meurtre. Je l’avais appelé « The Romance », et ça parlait d’une institutrice harcelée par un inconnu – l’histoire venait directement des journaux. Elle avait dû déménager, changer de nom, rompre toutes ses relations avec ses amis et sa famille… mais il finissait toujours par la retrouver. Il a même passé un an en prison, et il continuait à la harceler depuis la prison. Désespérée, elle s’était rendue à la police et leur avait demandé : « Ecoutez, sachant qu’il a fait de la prison, vous ne pouvez pas faire quelque chose ? » Et les policiers lui avaient répondu : « La seule chose à faire, c’est de le faire assassiner ». C’était dans les journaux. Et ils avaient ajouté : « Si vous voulez, nous pouvons vous conseiller quelqu’un ». C’était donc mon histoire, et Irwin en a fait quelque chose de bien plus commercial, en faisant de la victime une présentatrice de télé. Je voulais Theresa Russell, qu’ils ne connaissaient pas, et ils voulaient Morgan Fairchild, que je ne connaissais pas. Nous ne faisions pas le même film.
Pourquoi Theresa Russell ? Parce que vous aimiez les films de Nicholas Roeg ?
Oui. Et puis Theresa Russell est une véritable actrice, pas Morgan Fairchild.
Comment expliquez-vous la relation particulière que vous avez entretenue avec Charles Band quand il vous produisait au sein de Empire et de Full Moon ?
D’une certaine manière, c’est un producteur très sous-estimé. A la tête d’Empire, il faisait 25-30 films par an. En tant que scénariste et réalisateur, c’était merveilleux de travailler pour lui parce que pendant toute la période d’Empire, les films étaient financés et distribués à l’avance. Quand on arrivait avec une idée ou une histoire, on savait que son film allait voir le jour. On ne sentait pas la pression d’un studio ou d’un réseau derrière soi, il y avait très peu d’interférences, juste un homme. Bien sûr, des producteurs veillaient à ce que les plannings soient respectés. Charles Band travaillait en permanence, il avait toujours un film à produire. C’étaient toujours des productions bien huilées à l’exception de Fou à tuer (6).
Qu’enseignez-vous à l’université ? Quels sont vos sujets ?
J’enseigne la production. Je suis professeur en master. J’ai deux classes de production dans lesquelles nous réalisons des courts métrages, et j’enseigne la mise en scène. Comme les cours de production s’arrêtent l’été, je donne un cours sur les films d’horreur, un cours sur le cinéma indépendant, et un cours sur le documentaire.
Pourquoi Please Kill Mr Kinski est-il le seul film que vous ayez monté ?
Parce que je crois que quand on fait un film, il vaut mieux trouver quelqu’un d’autre pour le monter, quelqu’un qui n’a pas subi l’influence du tournage. En tant que réalisateur, on traverse toutes les épreuves de la production et du tournage, et telle ou telle séquence peut évoquer une journée difficile, alors que quelqu’un qui n’a pas vécu ces moments aura un regard plus juste. Please Kill Mr Kinski est un tout petit film, et j’ai tout fait moi-même, c’est-à-dire que j’ai littéralement installé la caméra pour parler face à elle, et j’avais un petit moniteur à côté, et parfois j’oubliais que c’était la caméra que j’étais censé regarder, et non pas le moniteur. J’ai tourné ça en une journée, et le montage m’a pris quelques jours.
Vous vous êtes filmé d’une manière un peu schizophrène.
Heureux de vous l’entendre dire. J’ai envoyé ce film à de nombreux festivals. Un festival de films organisé par une université l’a refusé, et ils m’ont même envoyé une critique. C’est le seul festival qui ait répondu : « Nous n’allons pas passer votre film, et voici pourquoi. » Ils ont dit qu’il y avait trop de coupures. Je suis allé à un autre festival dans le Maryland. Ils disposaient de chauffeurs qui allaient chercher les réalisateurs à l’hôtel. Je discutais avec mon chauffeur, et il m’a dit : « J’ai vu Please Kill Mr Kinski, et vous savez ce qui m’a plu ? À chaque fois que vous coupez et que vous tournez la tête, on sait que quelque chose va se passer ». Cela m’a donné raison.
Sur quel projet travaillez-vous en ce moment, à part Little Monsters dont vous avez déjà parlé ? Pourriez-vous nous parler de Nightmare Carnival ?
En fait, j’ai profité de mon séjour ici pour tourner un film, dont je vais vous parler. Je me rends à Singapour en mars en tant qu’artiste invité, pour trois semaines. Je vais faire un court métrage avec eux. J’ai dû trouver un projet à réaliser, et j’ai pensé à un film que je voulais faire à Las Vegas. Ça s’appelle Wedding Day, et ça se passe à Las Vegas, Paris et Singapour. Dans chacun de ces lieux, il y a une jeune femme dans sa robe de mariée, et quelque chose de terrible se produit. Nous avons tourné toute la journée d’hier et toute la journée d’aujourd’hui à Paris.
Las Vegas est la capitale mondiale des mariages. Nous sommes dans une chapelle, et nous voyons une jeune femme dans sa robe de mariée, c’est le tout premier plan, elle sort en courant, en larmes, et elle est suivie par un homme dans un taxi qui se trouve être son témoin. Elle était devant l’autel quand son fiancé a appelé pour dire qu’il ne viendrait pas. Elle décide donc de descendre le boulevard. Il s’agissait d’un mariage à la Elvis, alors elle décide de se trouver un mari pour avoir son mariage à la Elvis. Son témoin essaie de l’arrêter, il l’apprécie peu, mais ils finissent par se plaire l’un l’autre.
À Paris, la première image, que nous avons tournée le matin, montre la mariée vêtue de sa robe et de son voile, avec la Tour Eiffel en arrière-plan, et elle dit : « C’est le plus beau jour de ma vie, c’est mon mariage ». Nous la suivons dans les rues, les passants la dévisagent à cause de sa robe et de son voile, puis elle prend le métro – nous avons tourné devant Notre-Dame, et dans le métro – et elle finit par arriver devant un cimetière. Elle reste devant l’entrée du cimetière, elle n’arrive pas à entrer, puis elle fait demi-tour et part en courant. Elle entre dans un parc où elle s’assied, et une femme s’approche d’elle. Elle est là, assise dans sa robe de mariée, et cette femme s’assied à côté d’elle et lui demande : « C’est votre mariage ? » Et elle répond : « Non », alors qu’elle porte cette belle robe… Elle explique que quatre ans plus tôt, à la même date, elle devait se marier, mais son fiancé est mort trois jours avant. Le jour de son enterrement, elle portait sa robe de mariée, et tout le monde l’a prise pour une folle. Depuis, elle revient chaque année, vêtue de sa robe de mariée. Elles ont donc cette petite conversation, et elle ajoute : « Chaque année j’ai de plus en plus de mal à me rappeler son visage, c’est pourquoi je n’ai pas pu y aller, et que je me suis assise là : j’essaie de me souvenir de son visage, parce que si j’y vais pour déposer des fleurs et que je ne m’en souviens pas, il va s’en rendre compte ». Et l’autre femme la dissuade : « Vous êtes trop jeune, c’est bien d’oublier son visage, ça vous permettra de rencontrer quelqu’un d’autre ». Le dernier plan la montre qui dépose ses fleurs, qui enlève sa robe et l’abandonne sur place, et qui s’en va.
Dans l’histoire de Singapour, il s’agit d’une mariée et d’une amie qui sont en retard pour le mariage. Son amie essaie de la dissuader de se marier : « Il n’est pas fait pour toi. Tu es belle, tu as tout pour toi, et lui, qu’est-ce qu’il a ? » Et elle répond : « Il m’aime ». Bref. Il s’agit de trois histoires, et c’est ce que je fais en ce moment. Un court métrage, Wedding Day. Nous avons tourné en français, et la partie à Singapour sera en chinois. C’était une expérience très intéressante ; j’ai écrit le scénario en anglais, et on me l’a traduit. La première tâche a donc été d’obtenir une bonne traduction, vous connaissez le problème. Il s’agissait d’une histoire écrite en américain, et j’ai beaucoup appris en travaillant avec les acteurs. Dans mon scénario, un personnage faisait quelque chose de typiquement américain, comme quand la femme plus âgée met sa main sur la joue de la fille, et que cette dernière, émue, passe ses bras autour de son cou et se serre contre elle. Très justement, l’actrice m’a dit : « C’est une manière très américaine d’exprimer une émotion, nous ne ferions pas ça ». Et je lui ai répondu : « Pourtant vous vous embrassez sur les joues en permanence ! » Bref. Je vais leur donner des instructions par écrit, et ils vont monter le film ici. C’est mon chef-opérateur qui va le monter.
Vous ne serez pas présent lors du montage ?
Non, nous allons faire ça à distance. Mais même pendant le tournage, je devais faire confiance à mon traducteur, pas tant pour le jeu des acteurs, que j’arrivais à ressentir, que pour les nuances du langage — C’est à se demander comment Clint Eastwood a réussi à tourner tout un film en japonais (Lettres d’Iwo Jima) — Il faut un interprète, vous comprenez. Je lui demandais : « C’était comment ? », et il me répondait : « Un poil trop amer. Tu veux de l’amertume ou de la tristesse ? ». Ça s’est avéré fascinant, de tourner dans une langue que je ne parlais pas.
Mais de manière générale, est-ce que vous assistez au montage ?
Oui. Je procède toujours de la même manière : je regarde tous les rush du jour avec le monteur, et je lui donne mes préférences. Pour ce film, je vais dérusher plan par plan, et je choisirai ceux qui me plaisent. Par contre, concernant les scènes dialoguées pour lesquelles nous avons fait plusieurs prises, je ne pourrai pas choisir. Je n’avais jamais fait ça auparavant, c’est tout nouveau pour moi. Mais c’est très amusant. Nous avons tourné dans toute la ville, Paris est une ville tellement belle.
Et Nightmare Carnival ?
C’est un scénario écrit par un producteur qui m’a contacté ; il cherchait un réalisateur pour le projet. Il est en train de chercher à le financer, le projet n’est pas encore lancé.
C’est sur Imdb…
C’est sûrement pour donner de la consistance au projet, de manière à attirer les investisseurs.
Entretien réalisé par Derek Woolfenden et Marc Ulrich le samedi 27 janvier 2007 dans la salle Jean Epstein de la Cinémathèque française de Bercy. Traduction de Marc Ulrich. Remerciements à Élodie Dufour, Fred Savioz et Chaab Mahmoud de la Cinémathèque française de Bercy.
Notes
(1) Dans le sens américain du terme (NdT.)
(2) Pour Tourist Trap, la réussite « surréaliste » finale pourrait être la mise en pratique du cinéma de Buñuel surtout quand ce dernier déclare : « Les rêves sont une prolongation de la réalité, de l’état de veille. Dans un film, ils n’ont de valeur que si vous n’annoncez pas : « Ceci est un rêve », parce qu’alors le public se dit : « Ah, c’est un rêve, alors c’est sans importance ». Cela déçoit le public. Et le film perd de son mystère, de son pouvoir d’inquiéter » (Entretiens tirés des Cahiers du cinéma n°464, février 1993).
(3) Site de cinéma sur internet avec des fiches techniques assez complètes des films aux techniciens.
(4) Pino Donaggio a également signé les bandes originales des films Fou à tuer et Catacombs.
(5) Il s’agit de The Seduction.
(6) Problèmes de tournage liés à la personnalité de Klaus Kinski dont Schmoeller a réalisé un excellent court-métrage Please Kill Mr Kinski. Ce dernier est à la fois un défouloir jouissif pour le réalisateur vis-à-vis de son chemin de croix causé par l’acteur pour terminer son film, mais aussi un hommage des plus honnêtes et des plus touchants d’un réalisateur à son acteur malgré tous les conflits possibles…
LORD OF ILLUSIONS
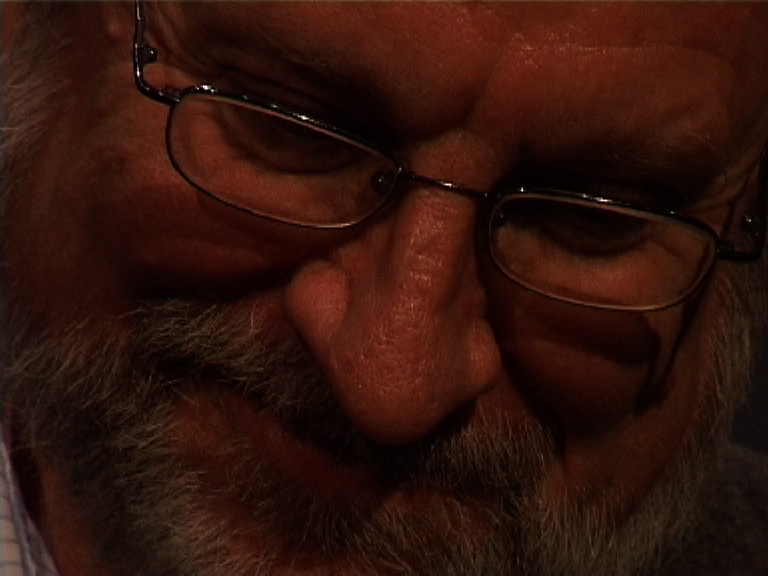
© Derek Woolfenden
« Souvenez-vous, c’était la fin des années 70, le fantastique et l’épouvante cinématographique s’imposaient progressivement comme un des genres les plus riches du cinéma américain et comme une ouverture inespérée, pas seulement sur l’imaginaire, mais sur une liberté de représentation qui allait contribuer à une transformation salutaire, fertile et critique.
« On découvre en France le 30 avril 1980, un film qui s’appelle prosaïquement Le Piège, mais dont le titre original est Tourist Trap. Au premier abord, une variation sur cette nouvelle horreur rurale inaugurée par le séminal Massacre à la tronçonneuse. Mais Tourist Trap avait quelque chose en plus, que la volonté de représenter une nouvelle et talentueuse variation sur la dégénérescence de l’Amérique profonde. L’atmosphère angoissante du film était rehaussée par la présence d’un motif qui plonge très loin dans l’histoire de l’art fantastique, celui du pantin, de la poupée et de l’effigie presque humaine, une des clefs de ce que Freud avait désigné comme participant de l’Unheilmliche, cette « inquiétante étrangeté », cette peur de voir l’inanimé s’animer, cette irruption du monde psychique dans la réalité objective. Tout cela a contribué au charme vénéneux de Tourist Trap. Sept ans plus tard sortait en France Fou à tuer – Crawlspace – sorte de huis clos obsédant où le génial Klaus Kinski semblait revenir de loin, d’un cinéma impur, d’un cinéma du samedi soir qui savait flatter la mauvaise pulsion, un film où l’Histoire catastrophique du 20è siècle entrait en résonance avec le délire d’un psychopathe. Ses deux pères étaient signés David Schmoeller. Il est né en 1947 à Louisville dans le Kentucky. Il a signé peu de films comme réalisateur, a beaucoup travaillé avec le producteur Charles Band, a écrit de nombreux scénarios dont ceux de la série des Puppet Master – encore le motif des pantins – dont il a réalisé le premier épisode. Il a également travaillé pour la télévision. On dit qu’il enseigne aujourd’hui le cinéma à l’Université de Las Vegas. Il nous a fait l’honneur d’être présent ce soir, mesdames et messieurs, David Schmoeller ! » (Allocution de Jean-François Rauger pour introduire la séance bis consacrée au cinéaste David Schmoeller dans la salle Henri Langlois de la Cinémathèque française de Bercy le vendredi 26 janvier 2007)

L’élaboration du film d’horreur est souvent liée aux motifs ou attachée aux lieux du quotidien. L’horreur vient toujours de la famille, du foyer, de la filiation. Ou sinon, cette élaboration sur nos peurs les plus primaires et profondes est liée aux projections d’un personnage à un autre ou d’une personne qui rêve de quelqu’un d’autre et lui donne ainsi vie. David Schmoeller a travaillé ces deux aspects du film d’horreur conjointement, mais surtout les interactions très fortes entre une image et celui qui la façonne. De Dieu au Christ (Catacombs), du fan Pygmalion à Galatée ou à l’image qu’il a plus ou moins créée ou à laquelle il a insufflé vie et personnalité (The Seduction), du marionnettiste à ses poupées (Puppet Master), du simple père à son fils dont il convoite la jeunesse (La Main des ténèbres et The Arrival dans une certaine mesure).
« (…) les Grecs veulent croire que les enfants sont semblables au père. C’est ce que pense Hésiode, c’est ce que pense Aristote, c’est ce que pensent beaucoup d’autres, que le ventre féminin est comme la matière, la glaise dans laquelle a été pétri ce mannequin » (Pandora, la première femme de Jean-Pierre Vernant).
Nous allons tenter de voir comment David Schmoeller, à travers sa filmographie (sélective), éprouve des sujets difficiles grâce au film de genre fantastique. Comme la filiation (The Arrival, La Main des ténèbres), par exemple, mais aussi le désir (sexuel souvent) qui dépossède l’être de sa conscience et de son libre arbitre (La Main des ténèbres), ou encore notre sacro-sainte appartenance aux traditions judéo-chrétiennes et à une Histoire prête à refaire surface ou à se répéter (Tourist Trap, Fou à tuer, Catacombs, Puppet Master). Et enfin les sentiments affectifs qui transcendent notre raison, mais que la science-fiction permet de renouveler (corrélation entre The Arrival et Starman de John Carpenter) en leur donnant toute leur juste démesure.
« Les amoureux et les fous ont la cervelle si effervescente, la fantaisie si inventive qu’ils conçoivent beaucoup plus de choses que la froide raison n’en peut comprendre » (Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare).
Possession, dépendance… En effet, les sentiments humains forts ont leur référent fantastique dans le vampirisme, le vaudou, les sciences occultes… Et David Schmoeller, d’une toute autre manière que Wes Craven ou John Carpenter, n’a eu de cesse de travailler les thèmes fantastiques liés finalement à notre quotidien, à notre mode de vie des plus répressifs. Se dégage un paradoxe intéressant chez ce modeste et honnête artisan de série B : sa fascination pour le surréalisme, ou ce qui relève de la fantasmagorie, va de pair avec une mise en scène rigoureuse, une exécution assez précise et froide. Ce qui confère à son imaginaire fantastique une dimension « réaliste » !
« Chaque fois que j’ai accepté un film, c’était avec une réécriture du scénario à la clé. Le matériau de base ne m’intéressait pas, je le trouvais soit quelconque, soit uniquement horrifique et sans aucune histoire derrière. Vous savez, je ne suis pas un réalisateur de films d’horreur au départ, mon inspiration est plus proche de l’univers dépeint dans La Quatrième Dimension. J’ai toujours eu une imagination nimbée d’étrange, de bizarre, mais pas d’horreur pure. J’ai eu la chance d’assister, lors de mes études, à des cours avec de grands noms comme Buñuel ou Jodorowsky, et c’est de ces personnes-là que je me sens le plus proche dans ma conception du fantastique. Inclure des éléments inquiétants et décalés à mes histoires a toujours fait partie de moi. Il est certain que lorsque j’acceptais un scénario versant trop dans l’horreur, je tentais de le modifier vers une sensibilité plus proche du malaise que du dégoût pur. J’apprécie le gore ou la violence extrême à condition qu’elle soit amenée logiquement dans l’histoire. » (« Interview carrière » de David Schmoeller par Mad Movies, n°174, avril 2005).
Tourist Trap (1979)
« Or, la tuberculose que j’ai vécue est, à très peu de chose près, la tuberculose de la Montagne magique : les deux moments se confondaient, également éloignés de mon propre présent. Je me suis alors aperçu avec stupéfaction (seules les évidences peuvent stupéfier) que mon propre corps était historique. En un sens, mon corps est contemporain de Hans Castorp, le héros de La Montagne magique ; mon corps, qui n’était pas encore né, avait déjà vingt ans en 1907, année où Hans pénétra et s’installa dans le pays d’en haut, mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l’âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché. Si donc je veux vivre, je dois oublier que mon corps est historique, je dois me jeter dans l’illusion que je suis contemporain des jeunes corps présents, et non de mon propre corps, passé » (Roland Barthes, Leçon).
Véritable mise en abîme du « slashe (1) », genre alors à ses prémices (Black Christmas, Halloween, Alone in the dark, Terreur sur la ligne, Vendredi 13…) dans la mesure où quatre jeunes adultes s’égarent avant de se retrouver aux prises avec leurs « doubles ». Des marionnettes et des mannequins de cire animés par le tenancier d’un vieux musée (Chuck Connors) grâce à ses pouvoirs en télékinésie. Ces « doubles » (ce sont des images comme la plastique de ses jeunes acteurs en témoigne avec Tanya Roberts en tête) narrent l’Histoire des Etats-Unis : des mannequins de célébrités historiques qui menacent, via la télékinésie, de venir dévorer ces enfants de cette génération sur laquelle l’Histoire ne semble avoir plus de prises à force de s’exporter (la Guerre du Viêt-Nam). Du sujet même du film à sa facture, toutes les thématiques majeures des films d’épouvante sont ici présentes. Du thème de la maison hantée (le musée) aux mannequins de cire (Masques de Cire de Curtiz à Crime au musée des horreurs d’Arthur Crabtree), du cow boy dégénéré (Massacre à la tronçonneuse, Mondwest) à l’homme impuissant dévoré par ses démons internes et sexuels (Psychose) qui s’expriment par ses pouvoirs en télékinésie (Carrie).
« La force éjaculatrice de l’œil » (Notes sur le cinématographe, Robert Bresson)
Avec Tourist Trap, Schmoeller dresse tout un panorama de l’horreur américaine, archétypes psychanalytiques et mythes confondus (la filiation, la castration, le transfert / Chronos mangeant ses enfants, Pygmalion, Pandora) à la propre genèse de son cinéma peuplé de personnages menacés d’être de simples coquilles que la « mauvaise pulsion » va vouloir habiter. Ce film s’inscrit également dans la lignée des histoires de Herschell Gordon Lewis et celles télévisuelles de La Quatrième Dimension (2) qui mettaient en scène, le premier avec des effets artisanaux, le corps dans sa représentation la plus schizophrénique et primale, c’est-à-dire de son cliché social et « figuratif » à son caractère organique et monstrueux. La Quatrième Dimension procédait de la même manière que les fables, par ses histoires, au glissement perceptif sur le corps à son enfermement décisif d’où le personnage principal et le spectateur se retrouvent prisonniers.
The Seduction (1982) :
« (…) contrairement aux hommes qui d’une certaine façon comme les dieux sont là depuis toujours, ils n’ont pas de naissance, ils sont sortis de la terre à l’origine, elle (Pandora) au contraire est un produit artificiel. Pandora est l’œuvre de la techne, de « l’art » de Héphaïstos qui l’a fabriquée comme on fabrique une statue.
Et par conséquent, sa place, sa fonction pose le problème de savoir ce que sont ces images, ces imitations. Quel est le rapport entre une déesse, sa statue, et Pandora ? C’est-à-dire qu’il y a, dans la nature même de Pandora, une sorte de question qui est posée : qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux ? Comment se fait-il qu’il peut y avoir une apparence qui saute aux yeux, et qu’en même temps cette apparence soit contraire à la réalité de la chose que vous voyez ? Et cela, c’est une question que Pandora pose, si je puis dire, par sa nature d’être fabriqué, mais c’est un problème aussi que les sophistes, les présocratiques, et toute la philosophie grecque va se poser. Qu’est-ce que c’est que le vrai ? Qu’est-ce qui est illusoire ? Qu’est-ce qui est apparent ? Qu’est-ce qu’imiter ? Bref, dans cette narration compliquée, amusante je crois, on voit qu’il peut y avoir dans un récit mythique, par-delà le divertissement, un problème affronté sans être jamais explicitement posé : « Nous les hommes, qui sommes-nous ? Et pourquoi ne peut-on pas être des hommes s’il n’y a pas aussi de femmes avec nous ? » (Pandora, la première femme de Jean-Pierre Vernant).
Ce film est ouvertement un hommage à Psychose (Alfred Hitchcock, 1960) de la situation scénique au caractère sexuel de son protagoniste.
En résumé, Derek (Andrew Stevens) est un jeune photographe qui donne vie à une image aseptisée (une présentatrice du journal télévisé (3) interprétée par Morgan Fairchild) en lui injectant un caractère organique par la peur (harcèlement et menaces) et par un rapport forcé à l’Autre (4) ! La fonction narrative de Derek est donc de désarticuler un automate.
Tout est codifié dans ce film ; le fantasme, le désir (qu’incarnent Derek) en devient subversif Dans une scène-clef du film, le traitement de l’orgasme sexuel coïncide avec la pénétration d’un couteau dans le dos ; le meurtre vient censurer l’orgasme ou s’y substituer. Et l’audace érotique est permise grâce au personnage de Derek qui détourne l’attention du spectateur par ses déviances sexuelles (scopophilie et meurtre).
Comme tout bon film des années 80 qui se respecte, The Seduction est une épure formelle et narrative dont le canevas est bourré de clins d’œil ou de références à des films contemporains. The Seduction est un parfait produit hybride qui se cherche dans un zapping des thématiques en vogue dans les thrillers américains et post hitchcokien (5) des années 80.
Le film s’inspire, au-delà de quelques clins d’oeils, de l’épure narrative et formelle presque conceptuelle de La nuit des masques (Halloween, 1978) de John Carpenter et rappelle Someone’s Watching Me (1978), un téléfilm réalisé également par John Carpenter avec Lauren Hutton. Mais aussi l’érotisme du remake de La Féline par Paul Schrader (Cat People, 1982). Les thématiques narratives du moment s’y trouvent donc également : la violence de la libido de l’homme sur la femme de plus en plus inaccessible et picturale de Lipstick (Lamont Johnson, 1976), Star 80 (Bob Fosse, 1983), ou encore Special effects de Larry Cohen (6) (1984). Le rapport atrophié et existentiel du fan et de son modèle et les échanges tordus de l’un à l’autre (Targets de Peter Bogdanovich en 1968, Fondu au noir de Vernon Zimmerman en 1980). Et enfin, le traitement de la photo comme médium inextricablement lié à la mort (Les yeux de Laura Mars d’Irvin Kershner en 1978, Maniac de William Lustig en 1980, Réincarnations de Gary Sherman en 1981).
« L’agalma est cet objet dont le sujet croit que son désir le vise, et où il porte à son extrême la méconnaissance de l’objet comme cause du désir. Telle est la frénésie d’Alcibiade. D’où le renvoi que lui fait Socrate – « Occupe-toi de ton âme », ce qui veut dire : « Connais que ce que tu poursuis n’est rien d’autre que ce dont Platon fera plus tard ton âme, à savoir ton image. Aperçois-toi que la fonction de cet objet n’est pas de visée, mais de cause mortelle, et fais ton deuil de cet objet. Il n’est que ton image. Alors tu connaîtras les voies de ton désir. Car, moi, Socrate, qui ne sait rien, la seule chose que je connais, c’est la fonction de l’Éros » » (Des noms-du-père de Jacques Lacan).
La fin du film anticipe sur ses propres incohérences narratives (dues aux « passages obligés » que la production américaine affilie souvent à un genre) et cela grâce au prétexte d’un duel westernien que les brisures glace et la présence de l’eau perturbée par le va-et-vient des protagonistes – via une piscine – vont venir provoquer pour notifier le caractère artificiel du film et créer une originale mise en abîme (7). L’iconographie des armes y est d’ailleurs révélatrice et déterminante : l’arme à feu, utilisée à la fin du film contre Derek, devient une prolongation féminine qui, dans son tir, est liée au cri. Le personnage de Julie (jouée par Wendy Smith Howard proche du personnage de Barbara Bel Geddes dans Sueurs Froides) l’atteste dans le final et renvoie à ces harpies vengeresses et justicières que sont Margaux Hemingway dans Lipstick et Zoë Lund dans L’ange de la vengeance d’Abel Ferrara (Ms 45, 1981). L’arme blanche est associée à l’homme, c’est le sexe aiguisé de celui-ci qu’il affûte à coup de branlette, mais aussi le double substitutif génital de l’appareil photo télescopique (8).
Nous le verrons aussi par la suite, mais chez Schmoeller, le psychopathe est toujours un spectateur atrophié et déviant qui a aussi des similitudes scéniques et médiumniques avec le réalisateur tel un alter ego. Ainsi l’attestent son obsession thématique de la filiation et les particularités narratives qu’il insuffle au psychopathe via la maîtrise de celui-ci dans l’illusion. Cette dernière est manifeste dans un pouvoir en télékinésie (Tourist Trap), par un médium comme l’appareil photo (The Seduction), dans l’arsenal technique meurtrier et scientifique (Fou à tuer), dans les croyances ou connaissances pour les sciences occultes qui permettent la possession ou le contrôle d’autres corps (l’animisme dans Puppet Master, le vaudou dans La Main des ténèbres, l’intelligence extraterrestre dans The Arrival).
Fou à tuer (9) (Crawlspace, 1986)
« J’ai tué au nom de la science. Maintenant je tue parce que je me suis adonné au crime ! ».
« Tuer, c’est mon héroïne, mon opium, mon idée fixe… » (Fou à tuer, David Schmoeller)
Film conceptuel grâce à ses contraintes économiques, avec une unité de lieu et de temps très confine (10). Un propriétaire, une poignée de locataires, quelques personnages secondaires papillonnant autour de la propriété et un arrière-fond historique oppressant puisqu’il s’agit du fantôme du père de Kinski qui obsède ce dernier via un journal intime de crimes nazis commis durant la seconde guerre mondiale.
Derrière une série b économe, un huis clos qui réinvestit les horreurs criminelles bureaucratiques à travers un tenancier dont les dispositifs criminels servent à décrire un monde contemporain qui a renouvelé, modernisé ces pratiques scientifiques et totalitaires. Fou à tuer serait la version horrifique de Porcherie (1969) de Pasolini sur la subsistance nazi dans nos sociétés occidentales et bourgeoises contemporaines. La même année que Fou à tuer sortait Démons 2 (le premier opus date de 1985). Même recherche formelle dans le caractère minimal des unités temps et lieu et dimension conceptuelle et épurée de l’horreur d’une toute autre manière que Black Christmas de Bob Clark (1974) et La Nuit des masques de John Carpenter (1978).
Fou à tuer est peut-être le film le plus « réaliste » des films de Schmoeller dans la mesure où ce dernier n’utilise pas les dimensions fantastiques déclinées pour chacun de ses films : le vaudou pour La Main des ténèbres, la télékinésie pour Tourist Trap, la présence extraterrestre pour The Arrival, l’animisme pour Puppet Master, les extensions fantasmagoriques liées principalement au Nouveau Testament pour Catacombs. Schmoeller se concentre sur des facteurs plus quotidiens, les pulsions primaires du simple voyeurisme à la folie pure. Ainsi, Kinski, de sa folie à sa démence, renoue avec la figure du vampire, figure qu’il connaît parfaitement puisqu’il incarna Nosferatu dans le remake d’Herzog (1979).
Mais la réussite du film tient du personnage tragique de Karl Gunther qu’incarne Klaus Kinski, véritable automate et pantin que son père et l’Histoire articulent à leur gré. En effet, les confidences intimes du père et du fils se mélangent dans leur goût pour les sévices et les meurtres cruels (à noter comment Gunther préserve de ses victimes uniquement un organe ou un membre corporel qui les détermine : un œil, un doigt, une langue…). Ces meurtres exercent l’imagination perverse et commune du père au fils à tel point que le personnage joué par Kinski se dérègle. La routine quotidienne implacable de ce personnage s’ébranle et son laboratoire de recherche, que représente cet immeuble avec tous ces cobayes que sont les locataires dont l’animal attribué est certainement le rat, devient concentrationnaire ! À noter que le regard du voyeur est comparable à un rat (ici le substitut de la chauve-souris pour le vampire), c’est-à-dire qu’il peut s’immiscer partout, via l’hégémonie visuelle de nos sociétés actuelles à observer, analyser, surveiller, répertorier, disséquer tous les gestes, des plus triviaux et quotidiens aux plus spectaculaires.
Quelques années après, Ferrara réalisait The Addiction (11) où il accola également Histoire et vampirisme, programme déjà en œuvre dans la série B comme l’ont déjà attesté les grands classiques de l’horreur américaine vis-à-vis de la Guerre au Viêt-Nam (La Nuit des morts-vivants et Massacre à la tronçonneuse pour ne citer qu’eux).
David Schmoeller, avec Fou à tuer, réfléchit sur l’immoralité liée intimement et de manière interdépendante à l’homme civilisé, du rapport social de ce dernier à celui sexuel !
« Je suis mon seul Juge, mon seul Dieu, mon seul exécuteur, Hein Gunter » (Fou à tuer).
Des projections d’images nazies et d’Hitler finissent par le posséder et investir toute sa personnalité à la fin du film. Fou à tuer devient alors un essai, une réflexion sur la question du Mal, non pas comme Absolu négatif mais comme un principe de contamination. Schmoeller rejoint ici DePalma qui relie filiation et contamination et concourt à l’héritage mythologique gréco-romain dans ces tragédies familiales dont la plus célèbre demeure les Atrides… En effet, Schmoeller, comme Aldrich (12), éclaire l’œuvre hitchcockienne sous le prisme critique de l’Histoire (Fou à tuer reprend, via Karl Gunther, le personnage de Norman Bates de Psychose, mais lui confère une dimension historique et allégorique).
Le père de Gunther n’est pas simplement un officier nazi ou un scientifique psychopathe, c’est simplement l’Histoire dans ce qu’elle a de plus terrible et implacable, à savoir qu’elle se transmet et se répète inlassablement (cet aspect du film rappelle Shining de Kubrick, mais ceci est une autre histoire…).
« Quelques années plus tard, j’ai reçu un coup de fil. M. Kinski était mort. Ils (les journalistes) me citaient dans sa nécro, confirmant que Kinski était odieux avec les réalisateurs. Au début, je me suis senti très mal. Quand quelqu’un meurt, on s’attend à le voir couvert d’éloges. Et moi je lui crachais dessus. Puis je me suis souvenu à quel point il avait été dégueulasse avec moi. C’était l’ironie du sort : c’était ma revanche. Mais vous savez ce que je regrette ? Je regrette que dans sa nécrologie, on ne m’aie pas cité disant à quel point c’était un acteur merveilleux, à quel point c’était beau de le regarder. Il était vraiment beau à regarder. Klaus Kinski ! » (Please Kill Mr Kinski, David Schmoeller dans son propre rôle).
Catacombs (1988) :
« Et Satan dit à l’homme d’Église :
Que feras-tu demain si tu acceptes
que je disparaisse aujourd’hui ?
Quel sacerdoce poursuivras-tu
si mon nom disparaît ? » »
(Citation de Khalil Gibran en exergue
du film Messe noire d’Eric Weston, 1981).
Un démon est fait prisonnier dans un monastère jusqu’au jour où une jeune femme vient y séjourner pour ses recherches universitaires 400 ans après. Le sujet de Catacombs, ainsi rapidement installé, permet à David Schmoeller une certaine irrévérence ludique vis-à-vis de la religion chrétienne. Des personnages de prêtres atypiques (13) aux motifs même du film liés à l’arsenal religieux, tout y passe ! Les prêtres sont décrits soit comme des aliénés d’un asile psychiatrique, soit comme des personnes parfaitement normales (l’un adore le chewing gum américain, l’autre mange du « snicker » pendant qu’il prie, certains matent avec lubricité la jeune fille qui vient étudier chez eux, un autre écoute le walk man…), ce qui a pour effet de totalement désacraliser leur vocation.
« N’employons la force que pour les idoles ; il ne faut que des ridicules pour ceux qui les servent : les sarcasmes de Julien nuisirent plus à la religion chrétienne que tous les supplices de Néron. » (La Philosophie dans le boudoir, Sade).
Catacombs est donc passionnant dans les circulations entre motifs païens et motifs christiques. La culture païenne et religieuse s’interpénètrent sans fin tout le long du film pour faire de celui-ci un inventaire irrévérencieux de toutes ces hybridations sacrilèges.
Catacombs est un habile film fantastique qui détourne tous les motifs ou clichés liés à la Bible en faveur de ceux propres à la mythologie païenne des vampires ! Catacombs dépeint le mysticisme religieux et ses déviances : une imagerie romantique gothique et la dimension superstitieuse, comme extension et interprétation religieuse, qui s’y rattache. Il faut dire que c’est la dimension ésotérique de la religion chrétienne qui se prête le mieux au surréalisme qu’affectionne Schmoeller, via les cinéastes Buñuel et Jodorowsky qu’il a eu comme maîtres spirituels.
Les exemples prolifèrent : le dédoublement d’un prêtre qui se voit mort (dans une idée qui pourrait être tirée d’un film expressionniste allemand ou du film de Dreyer, Vampyr), un sablier qui se remplit de sang (se substituant ainsi au sable allégorique), une fleur dont les pétales se rougissent de sang, l’utilisation au montage de l’image arrière qui provoque l’ensevelissement d’un prêtre encore vivant !…
« Ce qui est étrange dans Catacombs, c’est que ce n’est pas un film sur la religion mais sur le Mal, car ce n’est pas le Christ que l’on voie, mais bien le Diable dans des situations propres à l’Enfant Roi. J’ai uniquement voulu faire un film sur le Mal qui peut investir quiconque, même le meilleur des hommes. Je pense effectivement que c’est Catacombs qui recèle mes meilleurs travaux. Et en même temps, il reflète beaucoup de mes idées sur toutes les formes de religion. J’ai retravaillé ce qui n’était au départ qu’un banal script de film de monstres pour arriver à un résultat plus riche et ambitieux, un peu blasphématoire certes, mais ça avec le fantastique, c’est tout à fait normal. » (Interview carrière de David Schmoeller par Mad Movies, n°174, avril 2005).
Le film prolonge les préoccupations critiques de Fou à tuer en choisissant cette fois-ci un autre lieu « concentrationnaire » : les catacombes. Lieu, non seulement scénique dans le caractère ostentatoire qui le définit, mais surtout historique dans la mesure où les bases fondatrices de la Chrétienté y reposent.
« Les Catacombes sont les dernières traces visibles de la Chrétienté primitive, c’est ici même qu’on avait coutume de placer le corps des martyrs qui mouraient pour défendre leur foi » (Catacombs, David Schmoeller)
Une nouvelle fois, la série B lui permet d’exposer son raisonnement critique vis-à-vis des miroirs aux alouettes que l’homme s’est confectionné vis-à-vis de sa propre Histoire et des religions qui l’ont traversé, omettant ou marginalisant ses épisodes clés pour ne pas ébranler une quelconque foi. Trois idées critiques géniales se disséminent le long du film.
La première idée critique est le montage parallèle entre le discours répressif, inquisiteur et réactionnaire de Frère Marinus (Jeremy West) qui ne supporte pas l’arrivée d’une jeune étudiante en visite dans son monastère et la vision subjective du Démon qui circule dans les catacombes. Le discours oral et répressif de ce dernier, donné à une assemblée de Frères dociles, excite le Démon. La morale extrémiste de l’un anime et nourrit l’autre. Cette idée critique était déjà en œuvre dans l’adaptation très réussie du Dr Jekyll et Mr Hyde (1931) par Rouben Mamoulian d’après Robert Louis Stevenson. En effet, la société répressive anglaise tant sur le plan intellectuel (et scientifique dépourvu d’audace et d’imagination) que moral (le caractère conservateur du père de la fiancée du protagoniste) réveille la libido que réprimait le Docteur Jekyll toute la première moitié du film avant de s’incarner en Mr Hyde.
« L’ignorance et la peur, leur direz-vous encore, voilà les deux bases de toutes les religions. L’incertitude où l’homme se trouve par rapport à son Dieu est précisément le motif qui l’attache à sa religion. L’homme a peur dans les ténèbres, tant au physique qu’au moral ; la peur devient habituelle en lui et se change en besoin : il croirait qu’il lui manque quelque chose s’il n’avait plus rien à espérer ou à craindre. » (La Philosophie dans le boudoir, Sade).
La deuxième idée critique repose essentiellement sur une scène clef, celle de la confession d’un prêtre agonisant à un jeune prêtre. Non seulement, la scène est naturellement subversive dans la teneur de la confession, mais l’analogie qui s’y trouve est assez belle. Le vieux Frère Terrel (Feodor Chaliapin Jr.) regrette l’amour terrestre avec les femmes qu’il a avorté par vocation. Il se souvient qu’il avait 16 ans et connaissait une jeune femme du nom de Dolores qui voulait le détourner de sa vocation (14) :
« Elle décrivait l’amour physique comme un état d’euphorie. On devient comme un seul corps ondulant dans une communion avec… seule âme… dans la chaleur physique… caractère religieux… Quel dommage d’avoir manqué cela. Je n’ai pas eu une telle expérience avec Dieu et regrette cet amour-là avec Dolores. »
« Moi, Lucifer, le Porte-Lumière, qui désire votre bonheur, qui souffre de vos souffrances. Regardez la nouvelle étoile du matin qui annonce le retour du soleil ! C’est mon astre à moi, surmonté d’un miroir qui reflète la lumière de la Vérité. Ses rayons, dans la plénitude des temps, guideront certains bergers de certain désert vers une crèche où naîtra mon fils, le rédempteur du monde.
Pour cet arbre-là, dès que vous en mangerez vous serez conscients du bien et du mal. Vous saurez alors que la vie est un mal ; que vous n’êtes pas des dieux, que le Malin vous a frappés de cécité, et que votre existence ne se déroule que pour faire servir de risée aux dieux. Mangez-en et vous posséderez le don de la délivrance des douleurs, la joie de la mort ! »
(Coram Populo, De Creatione Et Sententia, Vera Mundi, Mystère, August Strindberg)
La troisième et dernière idée critique du film réside dans une idée figurative très forte. Le Diable prend possession du corps du Christ en animant sa statuaire au centre d’une chapelle. Le Christ devient une entité maléfique qui descend de sa croix avant de se servir de ses clous comme armes blanches (15). La croix devient même un instrument païen dans son analogie avec le pieu, objet propre à la mythologie romanesque et horrifique des vampires.
Les ironies subversives s’étendent ainsi grâce au fétichisme que la série b affectionne à l’égard des motifs et s’adaptent parfaitement sur ce que religion, superstition et cultes païens ont ceci de commun : le quelconque pouvoir imaginable conféré aux objets (le sceau béni par exemple dans Catacombs) ! Ce qui raccorde le Fantastique au caractère sacré et religieux, c’est le fétichisme lié aux accessoires dans ce que les deux parties leur confèrent !
Puppet Master (1989)
« J’ai d’emblée vu en la marionnette une figure hautement métaphysique. Tout d’abord, j’étais fasciné de voir un objet fabriqué de mes propres mains m’échapper. Dès que je mettais ma main dans la marionnette pour l’animer, le personnage se mettait à vivre de manière quasi autonome. J’assistais au déploiement d’une personnalité inconnue, comme si la poupée se servait de ma voix et de mes mains pour prendre une identité qui lui était déjà propre. Au lieu d’être un créateur, il me semblait faire office de serviteur.
Finalement, j’avais l’impression d’être dirigé, manipulé par la poupée ! Cette relation si profonde avec les marionnettes a fait naître le désir de devenir moi-même une marionnette, autrement dit un acteur de théâtre. » (Alexandro Jodorowsky, Le théâtre de la guérison).
En 1939, dans un grand hôtel perché au-dessus de la mer, un vieux marionnettiste réunit tous ses pantins, doués d’une véritable vie, pour les cacher dans sa grande valise avant d’emmurer celle-ci. Deux nazis débarquent dans l’hôtel, et c’est au moment de rentrer dans la chambre du vieillard, que ce dernier finit par se suicider.
De nos jours, un groupe de médiums (16) invités par un certain Neil Gallagher (Jimmie F. Skaggs) se rendent à ce fameux hôtel, mais leur hôte vient malheureusement de décéder sur place ! Sceptiques et méfiants, les médiums restent dans la bâtisse et semblent guetter une présence… »
Dès le générique du film, on entre dans le regard de la poupée « Blade » comme on entre dans le regard de la citrouille d’Halloween dans le générique de début du film de Carpenter. D’emblée, le film est perçu du point de vue d’une poupée. En effet de 1939 à 1990, à Bodega Bay, les poupées resteront intactes. Thématique contemporaine et américaine empruntée aux cultures liées au vaudou (Indiana Jones et le Temple maudit, Les Envoûtés) et que l’on retrouve dans la série B plus modeste (Jeu d’enfant de Tom Holland en 1988, Dolls de Stuart Gordon en 1987). Puppet Master questionne modestement le rapport de l’être humain qu’il a avec le Temps, et une nouvelle fois dans la filmographie de Schmoeller, l’Histoire. En effet, le marionnettiste cache ses « enfants » (les poupées) dans le mur avec la même logique de préservation que les animaux pour préserver l’espèce ou dans la même lignée que les assoiffés d’immortalité qui sont prêts à se laisser conserver dans la glace pour défier le Temps et échapper à leur quotidien. On pourrait même aller plus loin, le marionnettiste préserve ces poupées comme autant de points de vues possibles et amovibles comme l’attestent le générique de début et les multiples visions subjectives prêtées à ces poupées. Un point de vue historique, un témoignage, ces poupées sont des vestiges, des antiquités porteuses d’histoire, mais malgré le fait qu’elles sont pourvues de vie, elle sont dépourvues de libre arbitre. Ce sont des agents animés par les désirs de celui qui les possède ! Les poupées revêtent donc ce sceau tragique d’appartenir et d’obéir à celui qui les trouvera et qui aura la connaissance de leur « mode d’emploi ».
« Chacun de nous possèdent des pouvoirs psychiques inhabituels. Votre mari nous a amenés à nous rencontrer il y a plusieurs années pour que nous l’aidions dans ses recherches. Frank et lui commencèrent à étudier des traités d’occultisme datant de l’Antiquité égyptienne. Ils établirent la preuve que certains anciens avaient découvert un moyen d’insuffler la vie à des figurines inanimées. Le procédé fut conservé secrètement par un petit nombre de prêtres initiés à la magie » (Puppet Master).
Ce qui terrifie naturellement avec les poupées, c’est d’un côté, elles représentent la structure schématique de la physiologie humaine, mais de l’autre, et malgré leur côté amovible, sont condamnées à une attente terrible que vient définir et rappeler leur statut d’objet (et nous rappeler une condition humaine (17) non admissible, non avouable ?). Dans les films d’horreur, elles sont la parfaite incarnation métaphysique de l’homme et son rapport au Temps (l’objet bien entretenu survit au vivant) en plus du caractère hybride et monstrueux entre le vivant (représentation humaine, donc du vivant) et la mort (l’objet). Enfin, la poupée est le parfait fantasme de ce que l’humain peut projeter dans un objet pour refouler la mort jusqu’à s’y incarner, mais aussi le fétiche le plus représentatif de son enfance !
L’homme est un corps inanimé à qui l’on a donné vie comme une marionnette via le personnage de Neil qui est bien mort, mais animé comme les poupées grâce à ses connaissances occultes. Pour Schmoeller, l’homme est une coquille vide, un réceptacle que l’acteur va venir habiter, animer et régler son personnage comme on ajuste un instrument à cordes. De ce point de vue, Puppet Master est une habile anamorphose de la représentation du corps au cinéma, véritable sujet des films d’horreur des années 80 qui ne revisitent pas seulement les mythes fondateurs du Fantastique pour impressionner avec de nouvelles technologies, mais pour en épuiser toutes les symboliques possibles et imaginables empruntées aussi bien à la littérature fantastique qu’aux mythologies, aux séries télévisées ou aux bandes dessinées pop des années 60 (Stuart Gordon, Joe Dante, George A. Romero).
« Fie, fie, you counterfeit, you puppet you ! » (Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare).
Un nouveau paradoxe pour le réalisateur grâce à Puppet Master : pour être vivant, il faut être mort ! Le personnage de Neil Gallagher l’atteste et fusionne le mythe du vampire avec l’arriviste prêt à tout pour arriver à ses fins comme ces anti-héros du cinéma américain qui martyrisaient des femmes esseulées dans les films noirs des années 40 (Hantise de Cukor, L’Héritière de Wyler, Soupçons d’Hitchcock…). Le cinéaste se permet même un hommage à Freaks (1932) de Tod Browning dans son final en substituant les monstres de foire aux marionnettes. La solidarité des marionnettes entre elles vis-à-vis des humains qui outrepassent l’opportunité de leur pouvoir interdépendant d’elles.
« Ainsi va le monde : quand les dieux s’amusent, les mortels en abusent » (Coram Populo, De Creatione Et Sententia, Vera Mundi, Mystère, August Strindberg).
The Arrival (1991)
The Arrival est un bon exemple de ce que permet le cinéma Fantastique : conférer une dimension réaliste à des maladies psychiques comme la schizophrénie par exemple, et par l’entremise de la SF et grâce à elle. Les années 80 sont une période bénigne pour les série B de SF et les thématiques sociales de la réalité contemporaine qui viennent s’y immiscer.
L’industrialisation du corps dans Terminator (James Cameron, 1984) et son « devenir produit » contre une définition des sentiments amoureux et affectifs qui relient définitivement les hommes et les femmes, et ces derniers avec leur environnement naturel, mais menacés par la nature hostile et agressive de l’homme civilisé dans Starman (John Carpenter, 1984). La violence urbaine et le corps dérisoire de l’espèce humaine traité comme une coquille menacée de se faire habiter aussi bien par des corps étrangers que par des pensées extrémistes dans The Hidden (Jack Sholder, 1987), The Borrower (John McNaughton, 1991). Enfin, le racisme dans The Brother from Another Planet (John Sayles, 1984), Enemy Mine (Wolfgang Petersen, 1985) et Futur Immédiat, Los Angeles 1991 (Graham Baker, 1988).
À la suite de la chute d’une météorite dans son patelin, Max Page, un vieil homme devient de plus en plus jeune, mais est sujet à une soif de sang incontrôlable dont les victimes sont les femmes en période de menstruation ! Pourtant, à mesure qu’il rajeunit, Max Page tombe amoureux d’une jeune infirmière, laquelle semble échapper aux pulsions meurtrières de celui-ci.
Le personnage central du film, Max Page (interprété par Robert Sampson puis Joseph Culp), est peut-être la figure la plus emblématique du cinéma de David Schmoeller. Max Page est un corps possédé, vampirisé par une force extraterrestre. Il est cette marionnette proche des préoccupations thématiques majeures de son auteur comme du cinéma fantastique de Body Snatchers (les trois films, successivement de Siegel, Kaufman et Ferrara) ou de The Thing (John Carpenter) concernant l’horreur de l’uniformité, du refus de la différence et de l’abolition de toute forme et expression individuelle. Bienvenue dans l’horreur du même ! Bienvenue dans la mode qui fait « führer » ! Max Page est à la fois le père et son enfant dans la mesure où il réinvestit l’âge de son fils de telle sorte qu’il évince ce personnage pourtant bien plus présent que lui au début du film ! Larry Cohen s’était également penché sur la question avec The Stuff (1985) ou Les Enfants de Salem (18) (1987) sur le caractère répressif d’une même consommation qu’on nous impose ou d’un mode de vie aux règles strictes qui conditionnent l’individu pour abolir toute sa personnalité.
« Puisque nous rêvons notre vie, autant l’interpréter et découvrir ce qu’elle cherche à nous dire, les messages qu’elle veut nous transmettre, jusqu’à la transformer en rêve lucide. Une fois parvenus à la lucidité, libre à nous d’agir sur la réalité, en sachant que si nous cherchons seulement à assouvir nos désirs égoïstes, nous serons emportés, perdrons tout détachement, tout contrôle et donc la possibilité d’un acte véritable. Pour pouvoir s’amuser à agir, dans le rêve nocturne comme dans ce rêve diurne que nous appelons notre vie, il faut être de moins en moins impliqué. » (Alexandro Jodorowsky, Le théâtre de la guérison).
The Arrival est à la fois un film que traite frontalement du fantasme sénile d’un vieillard sur une jeune fille, mais c’est aussi et surtout une vision existentielle de la plaie béante à l’intérieur de chaque homme. Les films fantastiques n’auront de cesse de développer cette perspective : l’homme n’est qu’une simple coquille vulnérable soit par ses désirs (Lifeforce de Tobe Hooper, 1985), soit par les désirs des autres et de ce fait – fondamentalement et tragiquement – manipulable (via la force extraterrestre) de l’intérieur (son corps physiologique) à l’extérieur (le corps social).
« Je ne voulais faire de mal à personne. Je voulais juste survivre » (The Arrival).
La Main des ténèbres (Netherworld, 1992)
« Entrer dans les difficultés d’une personne, c’est entrer dans sa famille, pénétrer l’atmosphère psychologique de son milieu familial. Nous sommes tous marqués, pour ne pas dire contaminés, par l’univers psychomental des nôtres. C’est ainsi que nombre de gens plaquent sur leur être une personnalité qui n’est pas la leur mais qu’ils ont empruntée à un ou plusieurs membres de leur environnement affectif. Naître dans une famille, c’est, pour ainsi dire, être possédé. » (Alexandro Jodorowsky, Le théâtre de la guérison).
Corey (Michael Bendetti), un jeune homme, part à l’origine de son père Noah Thornton (Robert Sampson, déjà vu dans The Arrival) en venant s’installer dans sa propriété en Louisiane. Mais il découvre que celui-ci, de son vivant, était lié à un culte secret où l’âme humaine pouvait avoir un prix, celui de s’incarner dans un oiseau pour expier sa désobéissance à une certaine Delores. Suivant la lecture des mémoires de son père, Corey Thornton découvre qu’il l’aurait fréquentée avant sa mort convoitant les pouvoirs de celle-ci dans la vie éternelle !
David Schmoeller est de plus en plus attiré par les espaces « délirants » comme l’atteste l’ouverture de La Main des ténèbres. On est dans un « saloon » en Louisiane qui accueille dans son sous-sol les clients pour d’éventuelles passes avec des prostituées du nom de Marilyn ou Marie Madeleine ! Le saloon s’apparente également à un lieu vaudou, que ce soit les couleurs outrancières des néons, des effluves d’alcools ou du bestiaire qui y rôdent. Et le sous-sol renvoie à une antre surréaliste, des personnages (on y trouve l’ogre, la sorcière, la vamp, le « joker », le nain…) aux effets de montages même du film ainsi que ceux figuratifs (une femme se retourne de sa glace et devient vieille contrairement à son reflet). Ensuite, le film exploite les potentialités fantastiques des traditions vaudous (comme dans L’Emprise des Ténèbres de Craven en 1988), des pouvoirs régénérateurs peu communs au priapisme, de l’importance de l’âme (à défaut d’argent si le client n’en a pas) à la possession du corps et à son éventuelle transformation (en oiseau).
On est au croisement de plusieurs « mythologies », les questions de vie éternelle du vaudou aux vampires, l’omniprésence d’un père « patriarcale », autoritaire, castrateur et tyrannique propre aux religions judéo-chrétiennes ou aux mythologies grecques et romaines (d’Abraham et Isaac à Jésus-Christ, Cronos mangeant ses enfants…) et enfin à la mythologie cinématographique comme l’atteste la présence symbolique des oiseaux de Psychose qui ne sont pas ici empaillés du reste (l’expression littérale de « plumer quelqu’un » semble y être adaptée !).
Dans La Main des ténèbres, David Schmoeller aborde la question du père avec beaucoup plus d’angoisse et de gravité que dans ses autres opus. Elle y est abordée comme une castration, une possession vampirique et, par extension, contribue à une relecture biblique des plus subversives comme quoi le Christ n’est autre qu’un être qui a été possédé, absorbé, vampirisé par son propre Père, Dieu !
« Le Christ a donné sa vie sans rien dire pour son père. Pourquoi te plains-tu ? » (La Main des ténèbres)
Film produit par son fidèle acolyte Charles Band (19), La Main des ténèbres concourt à ces productions qui se jouent des frontières entre adultes et enfants. En effet, les films d’Empire Pictures (Ghoulies, Trancers, Re-Animator, Fou à tuer, From Beyond, Dolls, Catacombs) présentent une narration abordable compréhensible pour les plus jeunes, mais aussi une réelle violence s’en dégage par l’intermédiaire d’artifices gores ou autres effets techniques, des éclairages au montage des films. Dans Dolls de Stuart Gordon, production d’Empire Pictures antérieure à Puppet Master, un fabricant de jouets artisanaux sermonnera le père fouettard d’une petite fille avant de le transformer définitivement en pantin ! Il lui dira « Être parents, c’est un privilège, ce n’est pas un droit ! ». Pas de rédemption ici. Si les adultes sont corrompus, ils n’auront pas d’issue. Même la compassion de leurs enfants ne pourra rien y changer. Comme pour les productions de Roger Corman, ces films jouissent d’une réelle désinvolture permise grâce aux restreintes économiques et n’en sont pas moins décomplexés face aux sujets abordés n’hésitant pas à superposer une narration simpliste à des effets ou idées plus ou moins violents ou critiques.
Le désir sexuel dans ces productions n’est pas mis à l’écart non plus. Il est notifié par le cadre fantastique qui vient relever son importance, l’éprouver, mais aussi déjouer les bases et fondements de notre morale dans une logique purement ludique et subversive !
Le Royaume secret (The Secret Kingdom, 1998)
Film destiné à un jeune public, Le Royaume secret, derrière une vulgarisation narrative, technique et économe de son sujet, esquisse le rapport qu’entretiennent les Américains avec leur Histoire. Un jeune adolescent de classe moyenne américaine « sans histoires » se fait téléporter avec sa sœur dans un monde imaginaire, miniature et parallèle au monde réel, mais accessible depuis un court-circuit provoqué par la foudre un soir. Ce monde imaginaire devenu perceptible par le monde réel se trouve être sous le lavabo de la cuisine de cette petite famille livrée à elle-même, les parents s’étant absentés temporairement. Impuissant, le petit frère va suivre les aventures de ses aînés et reproduire les actions de ces derniers grâce à ses jouets.
On pourrait croire à un sujet de Joe Dante, mais il n’y a pas de subversion, tout est vulgarisation pour enfants. La seule chose vraiment intéressante repose sur cette famille américaine dépourvue d’histoires et d’Histoire, via le pays et le « monde réel » qu’ils incarnent, avant de se téléporter dans un pays dont l’Histoire est omniprésente, voire même conséquente et interdépendante d’une certaine dictature. En deux mots, cette dernière s’exprimera dans des idées comme celles-ci : parler du monde extérieur est un blasphème et tout le monde doit être matriculé.
« Cependant, si l’on considère un instant la plus sûre des sciences humaines, à savoir l’Histoire, comment ne pas reconnaître qu’elle a un rapport continu avec le fantasme ? C’est ce que Michelet avait compris : l’Histoire, c’est en fin de compte l’Histoire du lieu fantasmatique par excellence, à savoir le corps humain ; c’est en partant de ce fantasme, lié chez lui à la résurrection lyrique des corps passés, que Michelet a pu faire de l’Histoire une immense anthropologie. La science peut donc naître du fantasme. C’est à un fantasme, dit ou non dit, que le professeur doit annuellement revenir, au moment de décider du sens de son voyage ; de la sorte il dévie de la place où on l’attend, qui est la place du Père, toujours mort, comme on le sait ; car seul le fils a des fantasmes, seul le fils est vivant » (Leçon, Roland Barthes).
David Schmoeller fait parti de ces artisans symptomatiques qui oeuvraient modestement dans les années 80 et qui, malgré des contraintes économiques frustrantes, continuèrent inlassablement de développer leurs obsessions à la fois personnelles et critiques. C’est dans le Fantastique que ce réalisateur discret s’est imposé même si celui-ci n’y revendique pas particulièrement ses aspirations (20) ambitieuses. Mais grâce à sa présence dans le genre, il a démontré que la série B est riche par ce qu’elle entremêle de mythes, cultes et histoires pris en charge par une savante « vulgarisation » culturelle. Cette dernière, à n’en pas douter, est permise par des cinéastes qui ne revendiquent aucun génie ostentatoire, mais qui servent une histoire du mieux qu’ils le peuvent et cela, bien souvent, contre vents et marées. Il serait temps que la critique s’y intéresse aujourd’hui sans dédain. La série B devrait même être un véritable manuel pour que la critique sorte de ses gonds. En effet, on oublie trop souvent que le cinéma est un artisanat précieux. Ses contraintes de temps et d’argent ont parfois contribué à créer des perles rares défiant toutes définitions classiques, pédantes et pompeuses du cinéma qui se mêle de plus en plus aux anecdotes médiatiques, aux reconnaissances individuelles éphémères ou aux classifications universitaires définitives. N’oubliez jamais, les films sont comme les pantins des films de David Schmoeller ; ils nous survivent et peuvent très bien se passer de nous !
« Les meilleures dans le genre (on peut substituer ici les pièces de théâtre en question avec les films) ne sont que des ombres ; et les pires ne sont pas pires si l’imagination les corrige (21) » (Le songe d’une nuit d’été, William Shakespeare).
Derek Woolfenden.

© Derek Woolfenden
NOTES
(1) « Slasher-movie » est défini par le site de « nanarland » comme « film où un tueur (masqué ou non) plus ou moins psychopathe massacre des ados d’humeur festive (ex : Halloween, Vendredi 13, Scream) ».
(2) Série télévisée américaine de science-fiction créée en 1959 par Rod Serling.
(3) Il est également question d’une présentatrice de Journal Télévisé dans Hurlements de Joe Dante (The Howling, 1981) et Terreur à l’hôpital central de Jean-Claude Lord (Visiting Hours, 1982).
(4) Le personnage de Derek synthétise également la réalité extérieure et sociale que la présentatrice traite seulement en surface par l’énumération de faits qu’elle fait pour la télévision. En effet, une affaire criminelle hante en arrière fond le film, c’est celle des « Sweet heart murders ». Comme pour L’Angoisse du gardien de but au moment du penalty (1971) de Wim Wenders, l’affaire policière reste en suspens ! Ce qui est assez original pour un film américain de genre : éviter le poncif final de régler tous les problèmes grâce à la scène de bravoure finale !
(5) Le postulat voyeur étendu sur tout un film rappelle Sueurs Froides ou Fenêtre sur cour.
(6) Brian De Palma se souviendra de ce type de production propres à The Seduction avec le caractère décoratif outrancier et le porno soft volontairement grossier de Body Double (1984).
(7) 48 heures de plus (1990) de Walter Hill, à travers sa surenchère d’explosions de vitres et de pénétrations infinies de vitres et d’écrans, dénonçait son caractère préfabriqué tout en cherchant à renouveler le genre.
(8) La symbolique « fétichiste » des accessoires cinématographiques renvoie au Voyeur (1960) de Michael Powell.
(9) À noter que David Schmoeller bénéficiera de Sergio Salvati, le chef opérateur des principales réussites de Lucio Fulci. Il sera également au générique des deux films suivants : Catacombs et Puppet Master.
(10) On retrouve ces recherches formelles également dans certains films italiens contemporains et notamment chez Lamberto Bava (Démons I et 2) ou Michele Soavi (Bloody Bird).
(11) À noter que The Addiction de Ferrara s’inspire, ou du moins est très proche, du film australien Soif de sang (Thirst) de Rod Hardy (1979).
(12) Le Démon des femmes est une relecture personnelle de Sueurs froides d’Hitchcock qui en dégage les préoccupations critiques.
(13) Cela pourrait être la version masculine du film Dans les ténèbres (1983) de Pedro Almodovar qui se passe dans un couvent.
(14) Plus loin dans le film, Schmoeller osera une nouvelle analogie entre sexe et Dieu. Elizabeth (Laura Schaefer), possédée par le Mal, met sa main sur la tunique du Christ de manière explicite !
(15) On retrouve cette idée visuelle dans Messe Noire (1981) de Eric Weston, dans Satan’s Little Helper (2004) de Jeff Lieberman, et aussi Carrie (1976) de Brian De Palma, mais dans une autre mesure.
(16) On reconnaîtra parmi eux la jolie actrice d’Inferno (1980) de Dario Argento, Irene Miracle.
(17) « (…) l’homme a un côté prométhéen : à l’avance il sait qu’il peut lui arriver des choses, il sait très bien à l’avance qu’il mourra, il ne sait pas quand, il ne sait pas comment. À l’avance il sait que les dangers le menacent, il les craint, mais il ne peut pas les voir, il ne peut pas les entendre. Donc l’homme prométhéen sait que les choses vont arriver. Mais en même temps, nous avons l’autre côté épiméthéen dont nous sommes aussi solidaires. C’est-à-dire qu’on n’est vraiment fixé sur les choses que quand c’est trop tard pour trouver un moyen d’y remédier. Prométhéen et épiméthéen, ça veut dire que nous vivons toujours sur le mode de l’attente et d’une prévision qui n’est pas une vraie prévision, qui n’est pas un vrai savoir » (Pandora, la première femme, Jean-Pierre Vernant).
(18) Dans ces deux films, Larry Cohen avait réussi à créer un protagoniste idéal à ses investigations satiriques qu’interprétait son irrésistible alter ego et trop méconnu Michael Moriarty.
(19) À eux deux, ils forment un duo aussi incontournable que certains réalisateurs avec leur acteur (Larry Cohen/Michael Moriarty, Scorsese/De Niro), avec leur compositeur (Leone/Morricone, Cronenberg/Shore, De Palma/Donaggio) ou encore avec leur scénariste (Fulci/Sacchetti).
(20) Lire l’interview de David Schmoeller sur ce même site que j’ai réalisé avec Marco Ulrich, le samedi 27 janvier 2007 dans la salle Jean Epstein de la Cinémathèque française de Bercy.
(21) « The best in this kind are but shadows : and the worst are no worse, if imagination amend them ».

