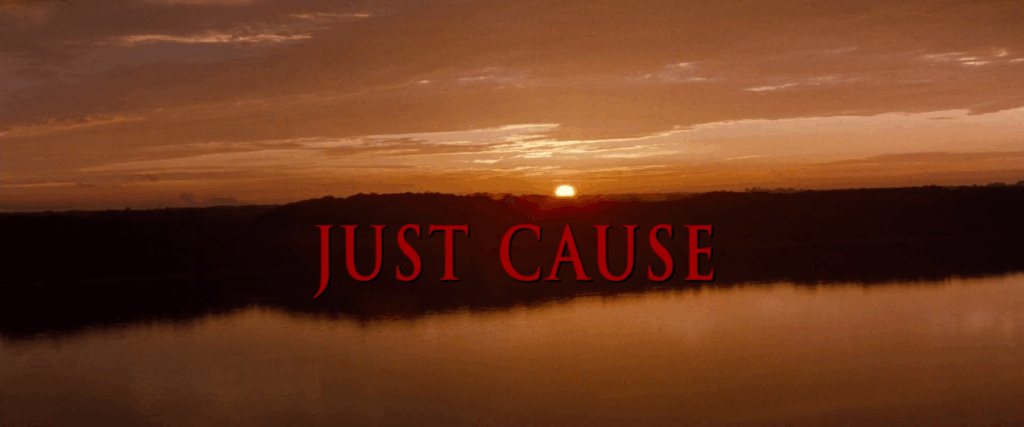
Paul Armstrong (Sean Connery), honorable professeur de droit de Harvard, farouchement opposé à la peine capitale, est contacté par une vieille femme noire de condition modeste qui l’implore d’assurer la défense de son petit-fils, Bobby Earl Ferguson (Blair Underwood), condamné à mort pour le viol et l’assassinat d’une fillette de 11 ans.
Il semblerait que Juste Cause fasse partie de ces films qui veulent participer à l’imaginaire collectif d’une justice expéditive défendant la peine capitale, et ce malgré une première partie trompeuse lorgnant plutôt du côté de certaines productions contemporaines avec Sean Penn (La Dernière Marche, 1995) ou Clint Eastwood (Jugé coupable, 1999). Autant un film comme Juste Cause est abject dans la démonstration grossière et narrative pour appuyer sa propagande nauséabonde, autant, même lui, pourtant, demeure passionnant, voire fascinant dans sa propension sans limites à vouloir désespérément croire à cette justice fascisante, et presque systématiquement avec une mauvaise foi crasse. C’est donc bien le cas de Juste Cause dans lequel s’était embourbé un Sean Connery vieillissant, mais toujours fringant. Il est difficile de défendre un film qui promeut la peine capitale, mais quand son réalisateur libère tous les artifices à sa disposition pour y parvenir, il faut en collecter tous les symptômes comme autant de lapsus tristement révélateurs de la société américaine d’alors, et d’aujourd’hui aussi, à en juger avec l’instrumentalisation médiatique du meurtre de Iryna Zarutska en août 2025 par un SDF racisé. Ainsi, dans un poste FB consacré à ce drame récent on pouvait lire la sentence de Adam Smith, philosophe et économiste écossais du 18e siècle : « La miséricorde envers les coupables est une cruauté envers les innocents » (La Théorie des sentiments moraux, 1759), sous-entendant la volonté d’épancher sa haine de la part du poste en question envers le meurtrier de la jeune femme.

« Il est toujours difficile de condamner un homme, alors qu’il est commode et satisfaisant de liquider un monstre. » (Robert Badinter, L’Exécution)
Avec le teen movie Gossip (Davis Guggenheim, 2000), on retrouvera cette morale réactionnaire où le zèle des citoyens américains s’avère bien pire et bien plus criminel encore que le criminel avéré du film qu’ils sont censés neutralisé. En somme, selon une doxa américaine non verbalisée mais prégnante dans beaucoup de films, tous les moyens sont bons pour arrêter un criminel, quitte même à devenir soi-même criminel pour y arriver !
« Je les ai vus, certains n’hésitent pas à former des monstres. Ils les conçoivent, les désignent. Ils sourient parfois d’un sourire terrible dans lequel l’autre, l’homme menotté dans le box, celui près duquel je me suis si souvent tenu, est pris au filet d’un travail incroyable de projection. (…). La justice est un spectacle, elle est une chose publique, cette exhibition me gêne. » (Thierry Illouz, Même les monstres)
Autant le talent de Sidney Lumet était de souscrire au doute et défendre une justice qui pouvait le prendre en compte quitte à se faire contaminée (Douze hommes en colère, 1957), autant l’intérêt d’un film comme Juste Cause repose sur la collecte d’indices invraisemblables pour correspondre au déni du moindre doute propre aux pires conservateurs et réactionnaires américains. A moins de libérer un coupable, et en dépit des pires atrocités commises… Juste Cause alimente le fantasme morbide de l’américain moyen voulant se libérer d’une justice s’étant appropriée sa propre vengeance personnelle et sa propre opinion sur la justice. Juste Cause ne cherche pas à soulever le défi ludique et sportif d’un coupable devenu concept, voire dialectique pour pousser le protagoniste vertueux dans ses retranchements moraux souvent contradictoires, voire mensongers que ce soit L’Invraisemblable Vérité (Fritz Lang, 1956) et, bien plus tard, Peur Primale (Gregory Hoblit, 1996), L’avocat du diable (Sidney Lumet, 1993), La Faille (Gregory Hoblit, 2007) ou Les Nerfs à vif (Jack Lee Thompson, 1962) et son remake (Martin Scorsese, 1991)…
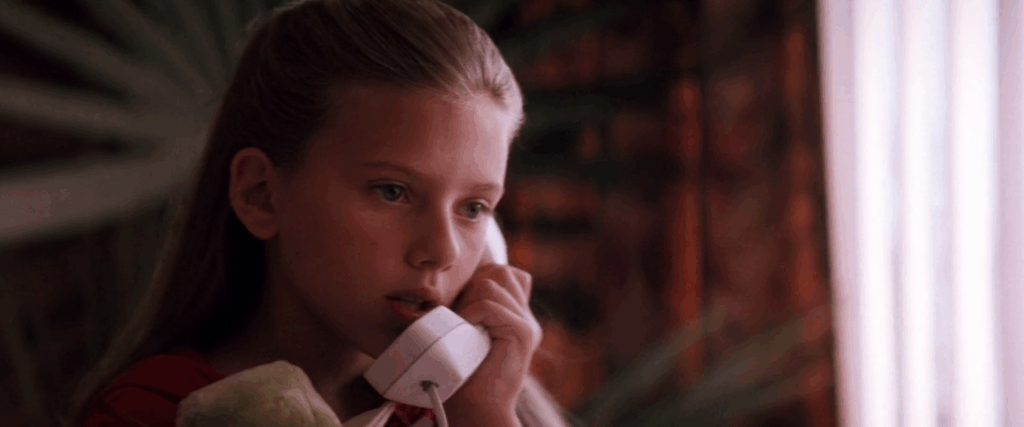
« L’accusé est un criminel ou fortement soupçonné de l’être. A ce titre, il est hors de la société des autres hommes. Ceux qui le jugent instinctivement éprouvent qu’il est d’une autre race qu’eux. Il y a ainsi sous-jacente, dans une audience d’assises, une sorte de racisme judiciaire, inconscient, inavouable, omniprésent qui fait qu’il y a d’un côté les honnêtes gens, et d’abord ceux qui jugent, et de l’autre côté le sacrilège, celui qui a violé les interdits. » (Robert Badinter, L’Exécution)
Juste cause est donc un film qui témoigne de cette croyance américaine ne pouvant supporter le moindre doute et dont le réel intérêt repose, in extrémis, sur le personnage de Tanny Brown (Laurence Fishburne). Policier noir américain déchiré entre sa douleur intime de n’avoir pu empêcher la mort d’une petite fille et l’image du noir américain déjà condamné par le regard condescendant et arrogant d’un intellectuel blanc enseignant et avocat émérites d’origine écossaise (Sean Connery). Ce dernier croit défendre un innocent alors qu’il ne fait que défendre et libérer un coupable, et ce bien en dépit des nombreux avertissements de Tanny Brown à se faire entendre et comprendre pour le convaincre de ne surtout pas le libérer.
Mais voilà ce que nous nous hasarderons à répondre à ce film, et à tant d’autres de cette décennie 90 et outre-Atlantique :
« Dans le doute, il vaut mieux se hasarder à sauver dix coupables plutôt que de condamner un innocent. » (Voltaire)
Derek Woolfenden, 2024

