Ou la mélancolie amoureuse… :

Nicole Bonnet (Audrey Hepburn), la fille du riche faussaire Charles Bonnet (Hugh Griffith) s’associe à un cambrioleur, Simon Dermott (Peter O’Toole), pour voler la Vénus de Cellini, une sculpture familiale exposée sous haute surveillance dans un musée parisien, et qui n’est autre qu’une contrefaçon. Cette copie est promise à une expertise qui pourrait incriminer le père de Nicole…


Derrière la comédie sophistiquée, dont les jeux maniérés des comédiens est en parfait accord avec la mode hollywoodienne du moment (l’Actors Studio a le vent en poupe), bien différente de l’hystérie à laquelle d’autres se livrent (voir une icône populaire comme Louis de Funès), se cache une critique acerbe du monde de l’art et de la culture, dominé par des amateurs, des « spécialistes » ne sachant plus distinguer une œuvre de sa copie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Bardot, avec sa violence corporelle et son jeu provoquant, creva l’écran de son temps. Bardot puait le naturel, contrairement à Hepburn, icône d’un genre opposé, qui sentait bon la sophistication. Ainsi, tout au long du film, Hepburn défile pour Givenchy (qui confectionna ses costumes). Chacune des séquences la donne à voir habillée avec goût et raffinement, comme c’est quasiment le cas dans tous ses films (de Vacances romaines à My Fair Lady). Mais ici, Wyler et Hepburn semblent s’en amuser, et pas forcément avec la tendresse attendue. Le film ne fait-il pas allusion au caractère artificiel et clinquant de son époque, et ce avec la complicité de son égérie, dont la grand-mère et sosie fut le modèle de la sculpture factice ? Et le personnage qu’interprète Eli Wallach, en traitant Nicole comme un objet à vendre, ne serait-il pas la cible de cette critique ? Son personnage condense tout le sexisme de l’époque, qui transforme les œuvres d’art et les femmes en porte-manteaux, en objets d’apparat. Le film pousse même plus loin la dénonciation acerbe de son temps.
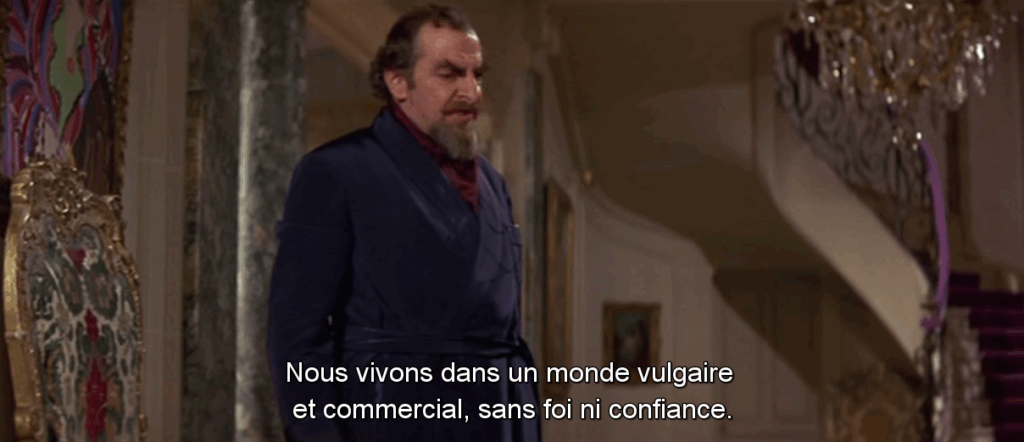
Charles Bonnet, le faussaire du film, est au fond un véritable artiste, aussi bien dans ses facéties orgueilleuses (Picasso était bien connu pour ses frasques, que l’opinion publique, au nom de son « génie » médiatisé, lui pardonnait) que dans sa conscience de la société dans laquelle il vit, quelque peu désabusée par moments, toujours brillante (« Nous vivons dans un monde vulgaire et commercial, sans foi ni confiance. »). Mais s’il est artiste, c’est avant tout parce qu’il est criminel (« Que Dieu bénisse les criminels ! ») ; c’est un homme de talent qui, par ses contrefaçons, se joue d’une société marchande et hypocrite. Ses œuvres-copies viennent titiller les jugements tout faits ; elles requièrent des yeux de spectateurs passionnés, avisés et exigeants !

« Toutes les formes de spectacles feront relâche afin que se dissipe l’engourdissement occasionné par notre état de spectateurs passifs. D’autre part, le travail aliénatoire étant aboli, le spectacle de simple divertissement n’aura plus de justification. » (L’An 01, Gébé, 1973)
L’artiste, selon Wyler, aurait donc pris à son compte cette image bohémienne de criminel social, à force d’être déconsidéré par la loi du marché. Cette dernière le préférerait mort afin de mieux spéculer sur son cadavre, comme ce fut le cas pour Van Gogh, cité à bon escient par notre cher artiste pamphlétaire et polémique. Wyler interroge, volontairement ou non, l’art pop et les artistes qui l’incarnaient (Andy Warhol et la célébrité « à la chaîne », Roy Lichtenstein…). Rappelons aussi que l’édition posthume de L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique de Walter Benjamin date de 1955… : « Devant l’appareil enregistreur, l’interprète sait qu’en dernier ressort c’est au public qu’il a affaire : au public des acheteurs qui forment le marché. » (L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin, 1955)



Déjà, avec The Collector, Wyler étudiait les dérives d’une société traumatisée par la Seconde Guerre mondiale, et d’une culture qu’on indexe, qu’on range et qu’on classe sans aucune sensibilité. Déjà, l’œuvre avait une valeur marchande, et plus une valeur sensible. Freddie Clegg (Terence Stamp), un employé de banque timide qui collectionne les papillons, gagne une forte somme d’argent à une loterie sportive et s’achète une propriété isolée dans la campagne anglaise dont il aménage la cave. Il enlève Miranda (Samantha Eggar) et l’y séquestre, s’occupant d’elle avec une attention toute particulière…

Wyler signait avec The Collector un huis-clos oppressant – genre alors en vogue (voir The Servant, Le Limier) – tout en surfant sur la nouvelle vague des comportements déviants que Psychose (1960) d’Alfred Hitchcock avait inaugurée. C’est l’âge d’or des personnalités atypiques du septième art : The Sniper de Dmytryk, The Sadist de Landis, Le Voyeur de Powell, La Force des Ténèbres de Reisz, Le Tueur de Boston de Kroll, L’Étrangleur de Boston de Fleischer… Clegg est enfermé dans une vision réductrice d’un monde, qu’il ne perçoit que dramatiquement, et qu’au premier degré. Il est condamné à une ignorance que la pénurie culturelle de sa classe sociale n’a pas pu combler. Miranda, quant à elle, est pétrie de préjugés, son éducation bourgeoise et sa bonne morale puritaine l’empêchant tragiquement d’anticiper le pire, à force de compassion naïve éprouvée envers son geôlier. The Collector devient aussi une réflexion ironique et cauchemardesque sur la vie de couple : l’amour y est carcéral ou anxiogène (de Portier de nuit de Liliana Cavani à Star 80 de Bob Fosse). The Collector ou le déroulement méthodique et cruel d’un dessein malade, initié par un accident social, soit cette trop grande somme d’argent gagnée brutalement. « ‘La Puissance corrompt’, disait toujours un de mes maîtres d’école. Et l’argent, c’est la Puissance » (John Fowles, The Collector, 1963)

Mais revenons à Comment gagner un million de dollars, réalisé juste après The Collector (1965). Il faut voir comment le spectre hitchcockien plane sur le film : la vente aux enchères qui ouvre le film renvoie à une séquence de La Mort aux trousses, qui dépeint avec cynisme le marché de l’art, tandis qu’Hepburn surprend chez elle un indésirable, en pleine nuit, alors qu’elle lisait précisément un livre sur Hitchcock. Ici aussi, la romance clinquante a quelque chose de mortifère (de La main au collet d’Hitchcock à Mulholland Drive de Lynch). Enfin, le périple amoureux des deux aventuriers s’articule sur un canevas typiquement hitchcockien -canevas dont s’était déjà inspiré Donen avec Charade ou Arabesque. D’ailleurs, Cary Grant (dans La mort aux trousses) comme Audrey Hepburn (dans le film de Wyler) n’ont de cesse de minimiser, de remettre en question leur célébrité. Ironiquement, nombreux dialogues font de l’Amérique la terre de pacotille à éviter, l’exil en toc à fuir, alors que Paris, en dépit des tartuffes qui y vivent, se présente comme la véritable « dolce vita » et dernière terre de résistance, malgré le caractère tapageur et zélé du milieu représenté…
« C’est dur de lutter pour ne pas trahir ses sentiments. » (Chef de Réseau d’André De Toth)

Pour rendre le film lui-même factice, Wyler ne lésine pas sur les citations : Hepburn lit Hitchcock, elle se rend place Vendôme (un écho à Ariane de Billy Wilder)… Le véritable enjeu du film, cependant, est certainement dans cette idée que le sentiment amoureux transfigure le regard. Simon (le choix de Peter O’Toole pour ses yeux bleus fluorescents n’est pas innocent…) reconnaît les traits d’Hepburn dans la sculpture de Cellini, et réussit donc à percer à jour la supercherie. Wyler, ici, semble nous dire que les vrais amateurs d’art font confiance à leur instinct passionné, plus qu’à leur porte-monnaie, ou qu’aux étiquettes. Quand le regard amoureux cible l’objet de son désir, il est capable d’en déchiffrer et d’en décoder toutes les pliures, tous les recoins. Dans toute romance hollywoodienne, le baiser est un réel enjeu (Pandora, Elle et lui, Désir, Rivière sans retour, Les Enchaînés) et, dans Comment voler un million de dollars, il est magnifique dans la mesure où il s’agit d’une « reconnaissance ». Mais nous n’en dirons pas plus…

« Il est bien clair, par conséquent, que la nature qui parle à la caméra n’est pas la même que celle qui parle aux yeux. Elle est autre surtout parce que, à l’espace où domine la conscience de l’homme, elle substitue un espace où règne l’inconscient. (…). Pour la première fois, elle (la caméra) nous ouvre l’accès à l’inconscient visuel, comme la psychanalyse nous ouvre l’accès à l’inconscient pulsionnel » (L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin, 1955).
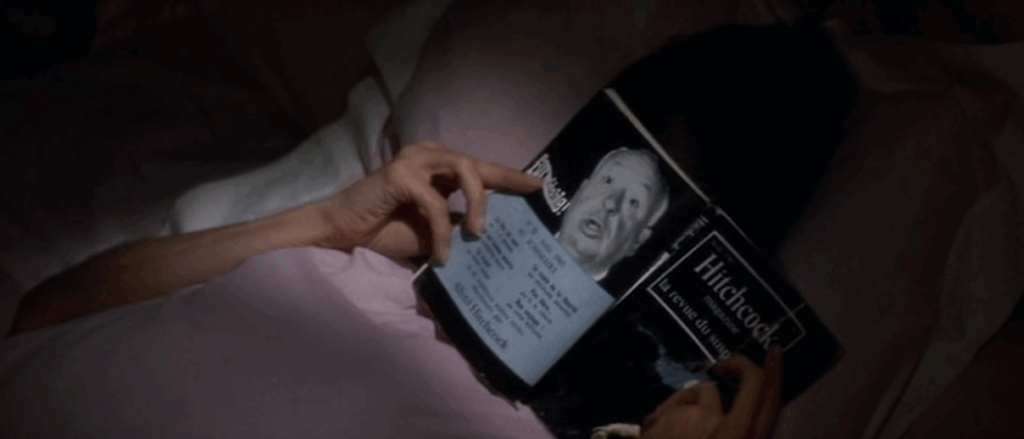
Le film de Wyler, via l’atmosphère quelque peu désabusée qui s’en dégage, rejoint ces films mélancoliques (pour ne pas dire dépressifs) des années 60, mais non dénués d’une certaine étrangeté : Voyage à deux (Stanley Donen), Diamants sur canapé (Blake Edwards), The Happy Ending (Richard Brooks), Strangers when we meet (Richard Quine)… Ces derniers préparèrent peut-être (et involontairement !) la folie furieuse des années 70 et leur irrévérence ostentatoire, voire libertaire ! Rappelez-vous d’Au service secret de sa majesté de Peter Hunt… Même James Bond tombait amoureux et le jeu absent de son interprète, George Lazenby, n’en était que plus attachant puisqu’il transformait son personnage « traditionnellement » actif en un pantin passif, médusé par Diana Rigg, qui devient, non sans malice, l’objet de son regard puis de son cœur. À l’image de la chanson de Frankie Vallie & The Four Seasons, Can’t Take My Eyes Off You (1967), il ne peut détacher ses yeux d’elle.

« – Nos sentiments personnels prennent le dessus.
– Est-ce un péché ? Est-ce un crime ?
– Pour nous… oui. » (Chef de Réseau d’André de Toth)
Derek Woolfenden
(sous le pseudonyme de Takezo Ichikawa dans un fanzine paru en décembre 2020)

